|
Journal Indépendant et Militant
|
http://lejim.physicman.net/spip
|
|
Editorial n°13
Luttes dans le monde / La lutte ne connaît pas les frontières
mardi, 12 octobre 2010
/ Fiona Wallers
|
Solidarité. C’est l’un des principes inscrits dans la charte de notre journal. Au fil de nos articles, les lecteurs auront compris que, si nous ne pouvons pas seuls changer le monde, nous prétendons contribuer à sa meilleure compréhension, en mettant à disposition de chacun-e les informations nécessaires à un positionnement, et à une action solidaire.
Mais il faut bien le dire : jusqu’ici, les articles du JIM ont souvent traité de sujets qui nous sont, peu ou prou, familiers ou proches [1]. Est-ce que la solidarité a des frontières ?
Bien sûr que non.
Notre journal s’inscrit naturellement dans le contexte militant d’aujourd’hui. Les luttes sont multiples, les engagements limités. Beaucoup [2] invoquent un changement radical des implications : moins de grandes idéologies, plus d’actions concrètes ; moins de mobilisations de masse, plus de démarches individuelles et de proximité.
Mais ce fameux « think global, act local » [3], comment le comprendre ? Est-ce qu’il est juste une invitation à faire pousser ses salades bio ? Nous pensons que non ; nous sommes convaincu-e-s que la solidarité pour celles et ceux qui luttent pour l’égalité et la liberté [4] vaut pour toutes et tous, et qu’elle est toujours possible. Regardons les nouvelles formes de lutte « transnationale » : des militants de tous pays peuvent se rejoindre pour manifester contre un sommet de la finance mondiale. Les Forums mondiaux avaient inauguré de façon éclatante ces nouvelles manières de se rassembler pour militer. Récupérés d’avance, ces mouvements dits « altermondialistes » ? Réservés à une élite ? Il fut un temps, pas si éloigné, où les militants s’engageaient dans les brigades internationales ; dans les années ’70, d’autres rejoignaient les groupes de lutte armée de par le monde.
Dans le contexte actuel, manifester sa solidarité et sa résistance prend des formes multiples, qui ne reconnaissent que la légitimité de l’action décidée, en dehors des systèmes d’ordre imposés par les pouvoirs dominants. C’est l’expérience du No Border, qui vient de se tenir à Bruxelles. Parti de la contestation face à l’injustice des frontières, le No Border devient un laboratoire des méthodes de lutte, exportables partout.
L’interview de Davide, elle, témoigne d’une implication militante extrême : accompagner la caravane autonome des associations locales pour briser l’encerclement dans lequel se retrouvent des populations de l’Etat mexicain d’Oaxaca. Lors d’une première caravane, les attaques des groupes paramilitaires avaient fait deux morts parmi les participants, une militante mexicaine et un observateur finlandais. Quelques mois plus tard, une seconde caravane démarre. L’objectif reste le même : briser l’isolement, faire connaître les exactions des paramilitaires, la complicité du gouvernement, la volonté des populations en lutte. [5]

De ces expériences autonomes et révolutionnaires, la presse majoritaire - et majoritairement capitaliste - ne rend pas compte. Nous avons choisi de donner la parole à une militante vénézuélienne, Antenea Jimenez, qui témoigne d’une forme d’organisation communautaire : la comuna. Basée sur la production au niveau local, elle fonctionne grâce à la participation politique des communautés. Le chemin reste long : la construction du socialisme par la base prend de l’énergie et du temps. Les populations ne sont cependant pas découragées ; elles espèrent plutôt que leur mode de fonctionnement populaire fasse tâche d’huile, et gagne les autres niveaux de pouvoir…
On peut être totalement d’accord ou pas, le front commun dans la lutte paie. Antanea le disait bien : Un autre succès important, c’est que les gens parlent du socialisme. Peut-être n’en parlent-ils pas de manière scientifique, comme sur ce que Marx ou Lénine disaient. Mais ils en parlent familièrement. Le renouvellement de nos schémas de lutte est obligatoire. Les distances géographiques ou idéologiques peuvent s’effacer dans un combat commun, pour autant que le but soit le même. Car la répression, elle, ne connaît aucune frontière.
Mais si certaines « frontières », certains territoires sont communs, la distance entre deux peuples peut tout de même être immense. Le texte de Yossi Bartal, des Anarchistes contre le mur, exprime les difficultés de mise en commun pour les exploités en Palestine occupée. L’exclusion s’étend, par la nature-même de l’Etat sioniste, à toute les populations, palestinienne ou israélienne. Soumises au diktat d’un pouvoir colonial et raciste, mais aussi autoritaire et conservateur, la nécessité de se battre ensemble est incontournable. En citant Yossi Bartal, notre plus grande épreuve est de trouver comment éviter que ces contradictions ne nous empêchent de poursuivre notre combat, et d’apprendre à en tirer des leçons qui nous permettrons d’avoir une meilleure compréhension de la lutte contre le capitalisme globalisé.

Act local… tout près de chez nous… des frontières presque communes, en plein « centre » du monde globalisé [6] : la crise grecque a monopolisé pendant des mois l’intérêt des chaînes de médias, généralistes ou spécialisés. Aucune perspective n’a été avancée, ou si peu. La société grecque était en ébullition depuis 2008, elle nous renvoyait déjà l’image de nos « démocraties » européennes, minées par les privatisations et le capitalisme. Les solutions proposées, et applaudies par le gotha européen et économique, ne remettent pas en question l’architecture d’un système intégré dans l’exploitation économique mondiale. Ce n’est pas à nous de payer leurs crises ! était l’un des slogans utilisés lors des manifestations. A deux, Eponine Cynides et Léandre Nicolas ont rédigé une sorte de « ligne du temps expliquée » des évènements de 2009 en Grèce. « Expliquée » non pas à travers le prisme dominant, mais à travers les convictions d’une partie de la population qui s’appauvrit et qui souffre. Une population exploitée qui en a marre. Dans un second article, de jeunes Grecs brossent un portrait de la situation économique grecque, en déconstruisant les principaux mythes utilisés pour parvenir à imposer le dogme néo-libéral.
Cette doctrine nous est imposée tous les jours, à tou-te-s, partout dans le monde. La "démocratie" capitaliste est le nœud de la nouvelle colonisation mondiale... Qui a cependant des conséquences : le rassemblement des exploités pour réclamer leurs droits démocratiques. La lutte de classes ne connaît pas non plus les frontières. Et elle a besoin d’énergies.
Merci à Christine, Eponine et Léandre, Jeffery et Susan, Yossi, et à tou-te-s celles et ceux qui ont participé à ce numéro.
Fiona Wallers, pour l’équipe du JIM
Bannière : Ode
[1] Dans nos numéros précédents, certains articles ont abordé des aspects très internationaux. Voir les textes sur le "nouvel ordre mondial" et des Etats victimes des préceptes ultra-libéraux ; l’image de São Paulo, paradis du libéralisme effréné, mais aussi, déjà, sur la Grèce et les révoltes populaires de 2008.
[2] Voir à ce propos les travaux de Jacques Ion : L’Engagement au pluriel, 2001, ou Le militantisme en mouvement, interview réalisée par M. Ravaud, 2006.
[3] Penser global, agir local ; expression attribuée à l’économiste René Dubos, qualifiant au départ une économie respectueuse de l’environnement. Par extension, cette expression devient un symbole des nouvelles façons de penser le monde : l’état de la planète dépend de ce que nous faisons près de chez nous, pas nécessairement en relation avec des organismes institutionnels.
[4] Voir la Charte du JIM.
[5] Au moment de publier cette interview réalisée par Christine Oisel, nous apprenons que la population dans cette comuna vient d’être durement réprimée, et que l’organisation communautaire et autonome a été totalement détruite par les forces répressives.
[6] Immanuel Wallerstein, sociologue américain, décrit, dans son ouvrage The Modern World System, le "système monde", dans lequel le captalisme s’étend à la planète. Son extension partage les pays en trois groupes : le centre, la semi-périphérie, et la périphérie. Ces Etats restent cependant intimement liés par le système d’exploitation capitaliste.
|
Le JIM nouveau est arrivé !
dimanche, 12 septembre 2010
/ JIM
|
Si nous avons mis un peu de temps à rentrer de “vacances”, ce n’est pas parce que nous nous prélassions sur une plage au soleil, les doigts de pieds en éventail en train de siroter des cocktails (même pas Molotov). Non, c’est parce que nous travaillions d’arrache-pied à préparer ce numéro du JIM de la rentrée.
Nous en avons donc profité pour vous concocter un nouvel habillage du site que nous espérons plus clair et plus pratique. Vous pourrez le découvrir dès le 14 septembre. Son principe reste le même : des numéros contenant des articles qui seront publiés au fur et à mesure du mois qui s’écoule ; des brèves pour réagir à chaud sur l’actualité ; un agenda des manifestations et actions diverses.
Quelques éléments nouveaux cependant : une nouvelle rubrique “A lire !” mettra en avant un article d’actualité “hors-numéro” ; vous pourrez également retrouver en première page nos passages sur l’antenne de Radio Panik (105.4 FM) ; enfin, à l’attention de nos lecteurs non-francophones, nous avons développé l’internalisation du site en permettant de changer la langue de navigation. Par ailleurs, nous allons également publier des articles dans des langues autres que le français, généralement avec leur traduction française.
De l’internationalisation à l’internationalisme, il n’y a qu’un pas à franchir. Et justement, le thème de ce premier numéro de la rentrée sera consacré aux Luttes dans le monde.
Ce sera l’occasion de publier notre première traduction en français d’une interview (parue en anglais) d’une militante vénézuélienne qui nous parlera du rôle des Communes dans le processus bolivarien au Venezuela.
En Amérique latine encore, nous reviendrons sur la sanglante agression d’une caravane solidaire par des paramilitaires dans la commune de San Juan Copala au Mexique.
Plus près de chez nous, nous examinerons, presque deux ans après les manifestations de décembre 2008 [1], les mouvements de résistances populaires aux plans d’”austérité” exigés par les institutions financières et les marchés. A ce propos, alors que se profilent de sérieuses menaces sur les pensions en Belgique, deux manifestations de rentrée sont organisées. L’une, le 15 septembre pour une revalorisation publique des pensions et l’autre, européenne, le 29 septembre pour refuser l’austérité.
Nous irons aussi au Proche-Orient, voir comment les Anarchistes contre le Mur luttent toutes les semaines aux côtés des Palestiniens contre la construction du mur d’annexion israélien.
Bref, rendez-vous le 15 septembre pour découvrir ces articles et encore bien d’autres...
Et pour “lancer” ce numéro, nous serons les invités de Radio Panik, le mercredi 15 septembre entre 19 et 20h !
L’équipe du JIM
Nous avons rencontré Antenea Jimenez, une ancienne militante du
mouvement étudiant travaillant maintenant au sein d’un réseau national
d’activistes qui essaient de construire et fortifier les comunas. Les
comunas sont des organisations communautaires encouragées depuis 2006
par le gouvernement Chávez pour consolider une nouvelle forme d’État
basée sur la production au niveau local. Antenea nous parle ici des
importantes avancées de ce processus, ainsi que des défis majeurs qui
restent à affronter pour construire une nouvelle forme de pouvoir
populaire depuis la base.
[Interview initialement parue dans The Bullet no 368, 13 juin 2010]
S&W : Peux-tu nous parler du quartier où tu vis et de la Comuna ?
AJ : J’habite dans un quartier au Nord de Caracas [1]
et je travaille au sein d’un réseau national qui construit des comunas.
En ce moment, nous sommes actifs dans sept États ; la plupart des
comunas se trouvent en dehors de Caracas.
Nous travaillons avec ces comunas pour construire un espace politique
dans une perspective participative. C’est une nouvelle expérience au
Vénézuéla. Par dessus tout, la comuna est un espace politique, pas comme
un État ou une paroisse ; elle est créée par les habitants pour les habitants.

Pour le moment, il y en a beaucoup en construction dans les milieux
ruraux, où elles sont les plus fortes. Chacune a sa propre réalité qui
dépend d’une culture politique et de la forme de production dans un lieu
spécifique. Par exemple, sur la zone côtière, la communauté est vouée à
la pêche, alors qu’à la campagne, la production est basée sur l’exploitation de la terre.
Nous travaillons pour découvrir quels éléments et quels principes
réunissent ces différentes expériences, quels éléments sont les mêmes
en dépit du fait que les méthodes de production et les cultures peuvent
être différentes. Nous organisons des réunions nationales où les comunas
du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest peuvent partager leurs
expériences et apprendre les unes des autres - dans les erreurs autant
que dans les réussites.
S&W : Quel est l’objectif principal des comunas ?
AJ : Il y a plusieurs objectifs, et ils prennent plusieurs formes. Avant
l’existence des comunas, il y avait plein de types d’organisations
communautaires auxquelles les gens participaient pour trouver des
solutions à leurs problèmes, comme les associations de voisins, le
gouvernement municipal, etc. L’objectif des comunas est de se construire sur base de ces processus et de les consolider en prenant pour principe d’organisation le territoire sur lequel ils vivent.
Pour nous, la comuna est un espace territorial, mais aussi un espace
politique dont l’objectif est de construire le socialisme de manière
permanente, un espace politique où les gens prennent en charge leur
propre éducation et leur formation politique. Nous leur apprenons la
"convivencia" et nous élaborons un plan pour un territoire particulier. Ce
qui est nouveau dans ce processus, c’est que les gens aussi participent
à l’élaboration de ce plan.
Ils sont très créatifs ; les plus avancés travaillent avec les
autres voisins dans ce processus de création d’un espace permanent de
formation. Les fonctionnaires qui travaillent pour l’État et qui
sont venus visiter ces espaces ont rapidement appris que les gens élaboraient leur propre plan pour eux-mêmes.
Certaines sont évidemment plus avancées que d’autres. Il est bien plus
difficile de construire une comuna en milieu urbain, par exemple, parce
que les habitants n’ont aucune expérience des [différentes formes] de
production ; par exemple, ils n’ont pas l’expérience des relations
sociales [non-capitalistes] en rapport au territoire, à la terre.
Il y a une dynamique urbaine qui est très capitaliste. mais dans les
milieux ruraux, ils ont gardé beaucoup d’éléments de ce qui est "à
nous", de nos ancêtres, des communautés indigènes, des communautés
afro-vénézuéliennes. Ces valeurs sont toujours présentes. C’est pour ça
que c’est plus facile là qu’en ville. Et alors qu’il y a moins de gens à
la campagne, la qualité des compañeros est très grande. Parfois, il n’y
a pas une seule personne qui n’ait voté pour Chávez ; c’est bien moins
fréquent dans les zones urbaines.
S&W : Peux-tu décrire ta formation politique personnelle ? Comment es-tu devenue impliquée dans les comunas ?
AJ : J’étais une activiste étudiante à l’Université. J’étais active dans les mouvements politiques avant Chávez, mais il n’y avait aucune relation entre les mouvements sociaux et les partis politiques. En 1992, lorsque Chávez a été libéré de prison, les choses ont commencé à changer. Nous avions toujours été impliqués dans les racines du mouvement populaire ; il y avait peu d’espace politique dans lesquels participer avant [sa libération], et donc nous militions dans notre quartier, dans notre organisation populaire, dans notre groupe culturel.
Mais à partir du moment où Chávez a été libéré [et a commencé à construire un mouvement politique en vue des élections de 1998], les choses ont changé. Je me suis impliquée ; il était de notre responsabilité d’aider à la construction du processus et du mouvement à Caracas. J’étais impliquée dans la Coordination Populaire de Caracas, et ensuite dans l’initiative de la création des comunas. Maintenant, nous sommes un groupe qui travaille sur les comunas.
Il y a beaucoup d’idées différentes sur les comunas, par exemple, entre notre réseau d’activistes et ce que Chávez a suggéré. Il y a différentes idées. Nous les construisons à partir du peuple, pas du gouvernement. Nous avions obtenu des avancées extraordinaires ; mais les avancées les plus fortes sont venues lorsque les gens étaient convaincus que c’était le chemin à suivre, lorsqu’ils étaient devenus actifs dans leur propre quartier.
S&W : Comment fonctionnent-elles ?
AJ : Historiquement il y avait des organisations diverses qui se rassemblaient pour résoudre les problèmes des quartiers. Notre idée était de réunir ces organisations pour qu’elles commencent à participer sur des sujets concrets. Nous organisons des ateliers. Mettons qu’une communauté n’a pas d’accès à l’eau. Nous organiserons une réunion sur l’eau. Les gens disent : "Ah, voilà, nous pouvons résoudre nos propres problèmes."
Nous cherchons une solution socialiste au problème. Pas juste engager une compagnie privée pour arranger quelque chose, mais travailler avec le gouvernement et la population pour résoudre le problème. En travaillant d’abord sur les besoins de base des gens, nous cherchons à les motiver à participer. Nous travaillons aussi avec eux pour penser plus sur le futur, comment nous pouvons améliorer les choses sur le long terme.
Pas à pas, nous travaillons ensemble pour résoudre des choses simples, comme le fait de vivre en communauté. Des choses qui ne réclament que des normes, un petit effort qui nous permette de vivre mieux ensemble. La communauté peut décider que "l’on ne peut pas boire dans les rues", par exemple. D’autres personnes peuvent constater ces petits changements et rejoindre le combat, encouragés par les résultats. Ils voient qu’une organisation collective est possible.
Il y a un réseau de promoteurs des comunas qui les coordonne, mais la participation des gens est fondamentale. Il y a des gens de tous les genres qui participent aux comunas : des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui s’en foutent. Les gens s’impliquent via un problème qui les touche, eux et leurs familles, l’école par exemple, parce qu’elle concerne leurs enfants.
Tout le monde n’est pas socialiste. En réalité, une minorité des participants des comunas sont socialistes. Nous devons répondre aux préoccupations de chacun. Cela ne peut se faire que par la pratique et c’est de cette manière que les gens s’impliquent.
S&W : Peux-tu nous parler de certains des problèmes principaux que vous affrontez pour construire le socialisme depuis les quartiers jusqu’aux niveaux les plus élevés ?
AJ : Il y a un facteur qui ralentit notre travail, c’est la dynamique électorale, qui est éreintante. Étant constamment en campagne, nous ne pouvons pas consolider le processus organique au niveau des quartiers. Il est difficile de gérer les problèmes dans la communauté lorsqu’on doit se concentrer sur des sujets comme l’assemblée constituante, puis le référendum, ensuite les élections générales, et après les élctions présidentielles, puis celles des gouverneurs, etc. Pour le moment, nous sommes en campagne pour les conseillers municipaux. Cette dynamique électorale constante affaiblit le processus organique au niveau local parce qu’elle nous distrait des préoccupations quotidiennes auxquelles la population dans les quartier est confrontée.
S&W : Quelles sont les principales préoccupations dans la zone nord de Caracas où tu vis ?
AJ : Le principal problème, par ici, c’est l’urbanisation non-planifiée. La plus grande partie des terrains sont dans les mains d’une très petite bourgeoisie et donc les gens les plus pauvres doivent construire leurs maisons sur des flancs de collines près du canyon, des espaces qui étaient originellement laissés vacants [en raison des conditions précaires]. Il y a 29 rivières dans la région de Caracas, et chaque fois qu’il pleut un peu fort, les gens qui vivent dans ces régions courent de grands risques. Leurs maisons sont emportées. Beaucoup meurent. Par exemple, en 1999, il y a eu un désastre au cours duquel beaucoup de gens ont été tués. Les habitants veulent une résolution de ce problème.
L’autre sujet est la sécurité physique ou l’insécurité. Il est difficile de trouver un endroit pour se rencontrer, parce que les gens ont peur. C’est un vrai problème. Mais l’opposition de droite et les médias ont exagéré sur le sujet et en ont fait LE problème dans les quartiers. Je pense qu’il y a des problèmes plus sérieux. La sécurité est le problème de l’opposition, la presse en parle, donc il y a débat sur ce sujet.
S&W : Dans quelle mesure la qualité de vie des gens a-t-elle changé depuis le début de la révolution bolivarienne ?
AJ : L’un des changements principaux, on le trouve dans l’éducation avec les missions, la Mission Sucre, par exemple. Aujourd’hui, toute personne qui veut aller à l’université peut y aller. Avant, seuls 7% des étudiants à l’UCV étaient des gens comme moi. Et peut-être que 2% seulement des étudiants à la Simón Bolivar étaient pauvres. Maintenant tout le monde étudie le soir. En fait, parfois, il est difficile de trouver le temps de se retrouver parce que tout le monde étudie ! On ne peut tenir de réunions que pendant les week-ends.
Une autre chose fondamentale qui a changé, c’est qu’avant 1998, il n’y avait pas de débat politique dans les quartiers. Je faisais partie d’une petite avant-garde qui résistait à cela, qui essayait de susciter le débat politique à l’université. Dans les années 80, il n’y avait que les étudiants pour se mobiliser, aller dans les rues. Mais maintenant, les gens parlent de politique partout, dans le bus et dans les bars. C’est rare que deux personnes buvant de la bière ne parlent pas de politique.
Un autre succès important, c’est que les gens parlent du socialisme. Peut-être n’en parlent-ils pas de manière scientifique, comme sur ce que Marx ou Lénine disaient. Mais ils en parlent familièrement. Il y a toujours un peu de peur, mais bien moins qu’avant. Par exemple, une fois, nous avons projeté un film sur le socialisme dans un quartier dans les années 80’ et 90’. Les gens répétaient mécaniquement ce qu’ils avaient entendu dans la presse, que les socialistes allaient les torturer et qu’ils étaient tous des dictateurs. Maintenant, ils associent le socialisme à la démocratie. Et donc, c’est le concept même de démocratie qui a changé. Si Chávez était assassiné, ce qui est une possibilité réelle parce qu’il y a déjà eu beaucoup de plans pour le tuer, ce serait la guerre civile.
Mais qu’importe le futur, les avancées de la démocratie participatives sont irréversibles. Impossible de revenir à la démocratie représentative. Un autre type de gauche peut apparaître, mais maintenant les gens devront toujours participer ; la démocratie participative est une part fondamentale de cette révolution. Les gens comprennent son importance, la demandent et veulent la faire.
Et ils voient la différence dans le fonctionnement de la politique. Avant, la réalité politique se concentrait sur ce qui se passait à Miraflores [le palais présidentiel]. Maintenant, il y a beaucoup d’activité politique, il y a des mouvements sociaux importants. Maintenant, il y a des choses possibles, de l’espoir. Maintenant, la démocratie, c’est plus que d’attendre tous les cinq ans pour voter. Nous avons sept millions de personnes qui militent dans le Parti Socialiste Unifié du Vénézuéla [PSUV]. Des millions de personnes participent aux conseils communaux.
Cela ne signifie pas que tout le monde a développé une conscience ou une expérience politique ; c’est encore un processus en transit. Mais il ne peut pas y avoir de parti révolutionnaire sans militants révolutionnaires. Et l’engagement à la formation de révolutionnaires est encore sous-développé.
Nous avons encore des problèmes dans le processus bolivarien. Il y a eu d’importants progrès économiques. Moins de chômage, par exemple, un salaire minimum plus élevé, de meilleures pensions, mais il y a toujours un bas niveau de conscience politique. Les gens doivent encore se familiariser avec les théories politiques et économiques, si nous voulons aller de l’avant, comme à Cuba, où, en moyenne, les gens savent ce qu’il se passe dans le pays ou dans le monde. À Cuba, il y a un haut niveau de conscience politique. Le niveau de conscience [révolutionnaire] est encore en déficit au Vénézuéla. C’est dangereux pour la révolution. Nous avons fait beaucoup, mais il y a encore un long chemin à parcourir.
Susan Spronk et Jeffery R. Webber
Traduction de l’anglais par Hélène Châtelain
Susan Spronk enseigne à la School of International Development and
Global Studies à l’université d’Ottawa. Elle est aussi assistante de
recherche auprès du Municipal Services Project et a publié plusieurs
articles sur la formation de classe et sur les politiques de l’eau en
Bolivie.
Jeffery R. Webber enseigne les sciences politiques à l’Université de
Regina. Il est l’auteur de Red October : Left-Indigenous Struggles in
Modern Bolivia, Brill, 2010 et de Rebellion to Reform in Bolivia : Class
Struggle, Indigenous Liberation and the Politics of Evo Morales,
Haymarket, 2011.
[1] [NdT] La capitale du Vénézuéla.
Ceci est la deuxième partie de l’interview d’Antenea Jimenez. La première partie, parue le 15 septembre, est disponible ici.
Nous avons rencontré Antenea Jimenez, une ancienne militante du
mouvement étudiant travaillant maintenant au sein d’un réseau national d’activistes qui essaient de construire et fortifier les comunas. Les comunas sont des organisations communautaires encouragées depuis 2006 par le gouvernement Chávez pour consolider une nouvelle forme d’État basée sur la production au niveau local. Antenea nous parle ici des importantes avancées de ce processus, ainsi que des défis majeurs qui restent à affronter pour construire une nouvelle forme de pouvoir populaire depuis la base.
S&W : Quel sens la démocratie participative prend-elle dans les comunas ?
Il y a un dicton ici qui suggère que la démocratie participative ne concerne pas ce que nous faisons, mais comment nous allons le faire. Cela signifie que nous allons construire tous ensemble ce que nous voulons faire, nous décidons ce que à quoi nous voulons contribuer, les projets qui vont améliorer nos vies.

La participation doit valoir pour chacun, quel que soit son lien avec le gouvernement, contre le gouvernement, à gauche ou à droite. La seule autorité ici, c’est l’assemblée des citoyens. C’est l’assemblée, pas le groupe élu... Non, c’est l’assemblée qui décide du plan commun dans chaque comuna.
Lorsque nous débattons, nous essayons de trouver un consensus, et si nous n’y arrivons pas, nous continuons à débattre. Lorsqu’il n’y a pas d’accord, nous décomposons le sujet petit morceau par petit morceau pour trouver des accords sur les plus petits éléments. La participation, pour nous, se trouve dans la formulation des politiques ; Nous participons aussi à l’exécution du projet. Par exemple, une communauté veut un aqueduc. L’État dit "Ok, voilà l’argent. Maintenant, construisez-le, utilisez les fonds."
Mais nous ne participons pas à la formulation de la politique nationale, pas directement. La politique des ministres n’est pas décidée de manière participative. Nous avons dit "Mais nous devrions y participer !" Nous participons au niveau local, mais le socialisme n’est pas quelque chose qui se passe uniquement au niveau local. Nous devons mettre sur pied ensemble un réseau qui rassemble les espaces locaux, les territoires et les comunas, parce que les niveaux national et international ont un impact sur ce qui nous arrive au niveau local. Nous ne pouvons pas juste être une comuna socialiste, une petite île dans une mer du capitalisme. Après tout, avec qui allons-nous avoir des échanges ?
Il y a un ministère du pouvoir populaire pour les Comunas et la Protection Sociale mais il n’y a pas de mécanismes participatifs pour mettre en place sa politique. Actuellement, cela fonctionne avec les communautés indigènes. Il y a un ministère des Affaires Indigènes et les communautés y participent et y décident. Ils ont un conseil national qui forge la politique. Nous avons avancé une proposition pour avoir plus de contrôle sur le ministère des Comunas, mais elle n’a pas encore été approuvée. Il y a beaucoup de résistance.
Vous devez comprendre une chose. Les comunas sont un espace de pouvoir. Il y a des comunas qui disposent de plus de ressources que certains exécutifs municipaux. Et donc, ce sont des espaces de pouvoir ; la majorité des comunas font formellement partie du PSUV, mais souvent, les élus chavistes aux niveaux locaux ne veulent pas vraiement partager le pouvoir. Et donc, il peut y avoir des confrontations entre les comunas et les maires et gouverneurs chavistes. Bien que nous nous retrouvions tous bras dessus bras dessous sur la même photo avec Chávez, en pratique, il y a une réelle confrontation. Les gouverneurs ne comprennent pas cette dynamique parce qu’ils ne veulent pas perdre de pouvoir.
Les gouverneurs et les maires pensent qu’ils vont construire le socialisme depuis leurs juridictions, à partir de leur direction. Mais nous, nous disons que si un État communal ne naît pas, le socialisme ne sera pas possible. Pour l’instant, il n’y a pas de comuna socialiste parfaite, où tout est débattu, où il y aurait un plan alternatif, socialiste, économique, où les professeurs seraient également de la comuna, donnant cours aux jeunes. Ça pourrait bien être possible un jour, mais pas tant qu’il y aura un autre niveau de gouvernement qui décidera du budget global. Le projet est de connecter toutes les comunas au niveau national ; pour l’instant, ce n’est pas viable parce que dans la plupart des endroits, nous ne participons même pas aux décisions sur le budget municipal. Nous participons à de petits projets, et le gouvernement local continue indépendamment comme si nous n’étions pas dans une transition socialiste.
Je ne connais que deux cas isolés où [la participation de la comuna dans un budget participatif communal] a effectivement lieu : dans la ville de Torres, dans l’État de Lara et dans la ville de Bolívar, dans l’État de Fálcon. Et ceci a eu lieu parce que les camarades [les maires] sont vraiment de gauche. La majorité des gouverneurs ne sont pas vraiment de gauche. Dans la plupart des cas, l’État est un État bourgeois et s’approprier cet État est le noeud d’un conflit continu. Cela prend beaucoup d’énergie politique. Le président est conscient de ces contradictions, mais je ne pense pas qu’il ait trouvé un moyen de dépasser le problème. Ce n’est pas simple. D’un côté vous avez des gens qui sont organisés et font des propositions, et de l’autre des gens du même parti qui consolident l’État bourgeois.
S&W : Quel est le rôle des femmes dans les comunas ?
La majorité des personnes qui participent aux comunas sont des femmes. Je pense que lorsque nous parlons des avancées du processus, ceci est l’un des plus importants. Pour l’instant, il y a une forte participation des femmes au niveau de la base, mais ça s’arrête là. Lorsque le temps est aux élections, pour s’emparer des responsabilités les plus importantes, les hommes sont candidats.
La président a mis en place plusieurs initiatives pour contrer cette tendance, et il y a eu beaucoup d’avancées. Dans le parti, par exemple, 50% des candidats doivent être des femmes. Et lorsque vous allez dans les communautés, la majorité des personnes qui participent sont des femmes, et la majorité des personnes qui étudient dans les missions également. Historiquement, au Vénézuéla et en Amérique Latine, les sociétés sont très sexistes et il a souvent été difficile pour les femmes ne fût-ce que pour quitter la maison. Avant que Chávez arrive aux affaires, la participation des femmes était rarissime. Les femmes de la gauche -de l’avant-garde- ont toujours participé à la vie sociale et politique. Mais maintenant, c’est plus répandu. Je pense qu’aux niveaux plus élevés du processus, beaucoup de femmes font des choses incroyables.
Il y a encore des choses qui doivent changer. Comme les lois. Par exemple, si je tombe enceinte, j’ai six mois de congé, mais mon mari n’a même pas un jour. L’une des choses que j’ai demandées, c’est l’égalité sur ce sujet. Je pense qu’on va l’obtenir.
Une autre limite, c’est que les femmes sont responsables pour les enfants au Vénézuéla. Il est difficile pour les femmes de participer dans les conseils communaux par exemple, parce qu’elles doivent laisser leurs enfants quelque part. Ça influence les décisions des femmes quant à l’idée de prendre plus de responsabilités politiques, en particulier lorsque ces responsabilités impliquent des voyages. C’est une vraie barrière, bien que le niveau de participation dans les communautés soit vraiment important.
S&W : Quelle est la vision à long terme dans la promotion de la démocratie participative depuis le bas à travers les comunas ?
AJ : Sur ce point, j’ai une position différente de celle du gouvernement. La vision qu’a le gouvernement, c’est que, hop !, je me montre dans une communauté, à partir de rien, et en trois jours, des ateliers sur la politique apparaissent. Comme je l’ai dit, déjà, le niveau de conscience politique au Vénézuéla est encore très faible.
Le processus de construction de la conscience politique, la formation, ne peut pas être instantanée. Ce n’est pas comme si vous alliez à l’école pendant une semaine et que vous y obteniez votre certificat. Ça doit être permanent. Si vous avez une équipe constituée par les mêmes personnes du conseil communal et qui poussent la conscience des gens de leur communauté, alors vous avez des facilitateurs. C’est un long processus qui consiste à apprendre à connaître les différentes catégories : anarchisme, socialisme et leurs différents courants. Ça prend au moins 15 ans. Ce n’est pas juste de la théorie ; on l’apprend aussi par la pratique. Vous apprenez par la pratique, mais aussi en lisant et en réfléchissant. Ça prend du temps de se rendre compte que certaines pratiques sociales et politiques font partie du socialisme, alors que d’autres sont propres au capitalisme.
Certains conseils communaux ont de plus hauts niveaux de formation politique que les autres. Ces organisations comprennent que le conseil communal n’est pas juste un lieu qui reçoit des ressources. Ils comprennent que le conseil est une nouvelle "association civile". C’est un espace politique et un exercice politique. Honnêtement, la majorité des conseils ne comprennent pas cela. Nous sommes encore en train de travailler avec des conseils qui fonctionnent sous la forme "Hé, on va résoudre ce problème de manière capitaliste ou de manière socialiste." Nous voulons résoudre les problèmes, mais le faire d’une nouvelle manière. Mais c’est difficile lorsque les entreprises qui fournissent les services, par exemple qui produisent les matériaux pour une maison, sont encore capitalistes. La construction de maisons est un bon exemple, parce que le problème des habitations est encore très sérieux. Peut-être pouvons-nous faire des briques, mais nous devons acheter le ciment d’une entreprise capitaliste. Et ensuite engager quelqu’un pour amener les briques... Ce n’est pas seulement le fait de résoudre le problème, mais surtout comment le résoudre... Construire le socialisme plutôt que de renforcer le capitalisme. Nous avons 500 ans de colonialisme et d’exploitation derrière nous, donc c’est un défi énorme, que de reconstruire tout le système socio-économique. Construire un nouvel État est un défi énorme.
Par exemple, dans certains cas, nous avons accru la production agricole. Mais le riz a été envoyé à une entreprise qui s’en occupe, emballe et revend dix fois le prix qu’elle nous a payé. Ça me fait rire, ça n’a aucun sens. Nous devons reprendre les plantations et les entreprises. Mais ce n’est pas facile. Les conseils communaux ne sont pas nécessairement prêts pour s’occuper de ces tâches.
Nous nous retrouvons un peu dans un cercle vicieux. La seule manière de dépasser cela serait de créer des relations entre les conseils communaux, les institutions publiques et l’État. Les conseils sont en voie de devenir plus forts, mais cela prendra encore beaucoup de temps avant de parvenir à l’étape suivante.
S&W : Quelle est l’idée à long terme ? Les comunas vont-elles exister parallèlement à l’État bourgeois ou le remplaceront-elles par de nouvelles formes d’auto-gouvernance ?
AJ : Cette question me fait réfléchir parce que le processus révolutionnaire a pris place dans bien des organisations qui se sont retrouvées bloquées sur le chemin. Le président a mentionné un jour le fait que le noyau du développement endogène n’a pas bien fonctionné. Les gens demandent souvent : "de quel type d’organisation avons-nous besoin pour obtenir ce que nous voulons ? Une comuna, une coopérative ?" Et j’explique qu’une coopérative est une entreprise en propriété sociale. La comuna, c’est autre chose. Nous faisons tout pour faire en sorte que la comuna devienne le principal instrument du changement social parce que nous sommes marxistes... C’est le seul moyen de construire le socialisme : par en bas. En outre, au Vénézuéla, il y a des expériences historiques avec les comunas. C’est la forme originale de notre organisation. Ce n’est pas étrange pour nous. Évidemment, en raison du colonialisme, tout ça a changé. Mais la forme originale de "Notre Amérique" était celle-là. C’est la forme politique à travers laquelle les gens gouvernaient collectivement leurs vies.
Nous avons également vu d’autres formes de socialisme qui ont été construits par l’État, comme l’Union Soviétique. Lorsque cet État est tombé en morceaux, tout a été détruit. Et donc, quelque chose est arrivé là. Est-ce que les gens se sentaient réellement comme une partie du processus ? Il y a eu des réussites, mais les gens n’avaient pas l’impression d’en faire partie. L’expérience de toutes ces révolutions du passé, en Russie, à Cuba, dans d’autres pays du Sud, montre que si le peuple ne participe pas vraiment, l’État bourgeois poursuit simplement sa route. Une telle conception du socialisme n’est tout simplement pas viable, parce que l’État bourgeois n’émane pas du peuple. Nous travaillons maintenant pour construire des systèmes alternatifs, comme des échanges solidaires ou du troc. L’idée est que la comuna commence aussi à gérer les stations de radio communautaires, les stations de télévision.
Nous discutons comment les comunas seront structurées. Quels seront les rapports de force, quels pouvoirs les comunas auront -judiciaires, exécutifs, etc. Tout ce qui existe pour l’instant est l’assemblée pour débattre. Mais aucune comuna authentiquement socialiste n’existe encore ; nous sommes encore en phase de construction des comunas. Nous sommes en comuna quand nous nous gouvernons nous-mêmes, quand nous n’avons pas besoin qu’un juge nous dise "cette maison n’est pas à vous." Ou bien, disons que vous vivez dans le quartier et que vous avez besoin d’une lettre qui prouve votre résidence. Vous devez aller jusqu’à une institution qui l’affirme. La comuna peut faire ça aussi. Votre voisin peut affirmer où vous vivez.
Le capitalisme a créé une couche de personnes qui sont les propriétaires de la vie des gens. Si vous n’avez pas de carte de résidence, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Pourquoi avons-nous besoin de cartes de résidence ? L’État bourgeois a créé cette classe d’administrateurs dont nous n’avons pas besoin, qui prétendent savoir des choses. Les couches populaires de la communauté, tout en bas, doivent attendre jusqu’à ce qu’ils aient résolu les problèmes. Mais la comuna peut faire toutes ces choses, décider de toutes ces choses. Avant que les Espagnols viennent, nous vivions comme ça. Mais c’est un long processus que d’élever la conscience des gens de telle sorte qu’ils prennent en charge leurs propres vies. Ce n’est pas non plus un "truc anarchiste" où chacun peut faire ce qu’il veut. Il y a des normes de vie ensemble que chacun doit respecter. Il y a des normes qui régulent le travail et qui doivent aussi être respectées. Les gens doivent respecter ces lois en conscience et non parce qu’il y a une loi qui l’impose.
En dernière instance, que le Président Chávez soit là ou non, le processus dépend du peuple. En ce moment, le processus dans son ensemble est trop dépendant du président. Il est considéré comme la garantie de ce que ce processus puisse aller de l’avant, et, pour cette raison, les réactionnaires veulent s’en débarrasser.
Si un autre gouvernement prend la place de Chàvez, il ne sera peut-être plus possible de se réunir politiquement dans les rues. Avec les gouvernements de droite du passé, il suffisait de posséder un livre de Marx, de Che Guevara ou de Fidel Castro pour être persécuté.
Susan Spronk et Jeffery R. Webber
Traduction de l’anglais par Hélène Châtelain
Susan Spronk enseigne à la School of International Development and
Global Studies à l’université d’Ottawa. Elle est aussi assistante de
recherche auprès du Municipal Services Project et a publié plusieurs
articles sur la formation de classe et sur les politiques de l’eau en
Bolivie.
Jeffery R. Webber enseigne les sciences politiques à l’Université de
Regina. Il est l’auteur de Red October : Left-Indigenous Struggles in
Modern Bolivia, Brill, 2010 et de Rebellion to Reform in Bolivia : Class
Struggle, Indigenous Liberation and the Politics of Evo Morales,
Haymarket, 2011.
En tant qu’activiste anarchiste-queer israélien, je suis souvent confronté à des questions concernant l’engagement des groupes ou individus queers dans la lutte des Palestiniens contre le régime d’apartheid israélien. Comment se peut-il que moi, en tant que queer et en tant qu’anarchiste ; je me batte pour l’établissement d’un Etat où les forces d’occupation vont juste changer de main et qui érigera des formes d’oppression anciennes et nouvelles ? Qu’avons-nous en commun avec un mouvement national qui reconstruit les mêmes idéaux nationaux que nous sommes occupés à détruire dans notre propre société ? Dans cet article, je vais essayer d’examiner ces questions et étendre ma réflexion sur le rôle de la solidarité et de la lutte commune dans une perspective anarcho-queer.
[Initialement publié en septembre 2007 dans le livre “Barrieren durchbrechen ! Israel / Palästina : Gewaltfreiheit, Kriegsdienstverweigerung, Anarchismus”, édité par Sebastian Kalicha de la maison d’édition Grasswurzelrevolution.]
La lutte contre l’occupation en tant que lutte dans notre propre société
Peut-être qu’un des points les plus importants à clarifier dans le début de ce texte est le rôle que l’occupation depuis 1967 et l’oppression de la Minorité Palestinienne depuis 1948 (Palestiniens de l’intérieur) jouent dans la société juive israélienne. L’Etat d’Israël, qui prétend être un “Etat juif et démocratique” et garantir des droits égaux pour tous ses habitants, a de grandes difficultés à maintenir ses aspirations démocratiques à la lumière de sa nature coloniale et religieuse. Il est de notoriété publique que les droits et libertés démocratiques, y compris pour les “groupes les plus privilégiés” en Israël, souffrent de cette continuelle occupation de plus de 40 ans et de la réalité sociale qui en a émergé. La nécessité d’une unité nationale face aux guerres à répétition, la militarisation rapide d’une société qui a besoin de contrôler chaque pas de 3 millions de Palestiniens, sans oublier la guerre démographique qui doit être menée contre les utérus palestiniens, tout cela laisse des marques sur les minorités en Israël et nuit à l’ensemble des luttes émancipatrices, comme celles du mouvement féministe, de la communauté LGBTQ [Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queers] , des organisations de travailleurs, des campagnes écologistes, des groupes éthiopiens et Mizrahi (juifs d’origine arabe) et bien d’autres. Dans une société en état d’urgence permanent, il est très difficile de se battre pour la justice sociale ou même d’en parler.
L’histoire du mouvement pour les droits LGBT en Israël peut servir d’exemple pour montrer les influences d’événements politiques majeurs sur une lutte spécifique pour des droits égaux. L’existence de groupes gays et lesbiens depuis les années 1970, en conjonction avec la présence de plusieurs artistes ouvertement gays, poètes et réalisateurs, a créé un petit cercle de compréhension et de tolérance pour les minorités sexuelles, mais personne ne peut ignorer que la plus grande et plus forte vague d’action politique et de succès du mouvement LGBT eut lieu dans les années 1990, particulièrement après l’élection de Rabin (et avec le grand succès électoral du parti sioniste de gauche radicale Meretz) et le début du “processus de paix” d’Oslo avec l’OLP [Organisation de Libération de la Palestine]. Aussi irréalistes et faux qu’ils aient pu être, les espoirs soulevés par le (depuis défunt) “processus de paix” dans le public israélien - espoirs pour un véritable état démocratique, pour la fin de la tutelle religieuse et la création d’un nouveau Moyen-Orient - a donné le coup de pouce dont la communauté LGBTQ avait besoin pour obtenir reconnaissance et succès juridiques. La seconde Intifada, orchestrée avec la ré-émergence du contrôle religieux, du nationalisme et du militarisme, a mis un arrêt à ces mouvements et, d’une certaine manière, a amené au grand retour en arrière et à la vague de violence homophobe, dans la rue comme dans les médias, déclenchée par la tentative d’organiser une gay pride internationale dans les rues de Jérusalem-Ouest.
Il est donc clair pour beaucoup d’activistes politiques dans les cercles progressistes que le conflit national bloque toute forme d’avancée radicale, empêche la création de coalitions, et est utilisé et régulièrement intensifié de manière à faire taire les conflits sociaux à l’intérieur d’Israël (on peut trouver un phénomène similaire à l’intérieur de la société palestinienne, où la lutte contre l’occupation israélienne est utilisée par certains groupes réactionnaires pour faire taire les critiques sociales et féministes). La première étape pour un changement radical aussi bien au plan social que féministe, dans la société israélienne doit donc être une fin de l’occupation. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ?
L’occupation ne s’arrête jamais
“Quand l’occupation s’arrêtera...” Combien de fois nous sommes nous répétés cette phrase, fantasmant sur un avenir dans le paradis que nous habiterions alors, et devenant de plus en plus cyniques et désillusionnés avec chaque année qui passe. Aujourd’hui, nous le savons bien : l’occupation ne prendra pas fin, elle est faite pour durer. Deux vérités sont présentes à mon esprit lorsque j’énonce cette affirmation : d’abord, la fin de l’occupation avec une solution à deux états basée sur les frontières de 1967 est irréaliste, ensuite, l’occupation n’est pas juste “l’occupation de 1967“, mais un problème bien plus large sous contrôle de l’Etat d’Israël. Une solution comprenant deux états nationaux coexistant côte à côte en tant qu’égaux est aujourd’hui une triste plaisanterie, et l’a peut-être toujours été. Cette solution, très défendue aujourd’hui, a été volée à ses défenseurs progressistes depuis plusieurs années (dans les années 1980, seul le parti communiste en Israël demandait “deux états pour deux peuples”) et déformée de manière à légitimer l’apartheid du 21ème siècle. Aujourd’hui nous savons à quoi ressembleront ces deux états : des bantoustans entourés de fils barbelés, encerclés par ce gigantesque camp militaire nommé Israël. L’occupation continuera simplement d’exister sous la nouvelle dénomination orwellienne de processus de paix et d’une fausse indépendance.
L’opposition à la solution à deux états n’est pas seulement basée sur le fait qu’elle est impossible à mettre en oeuvre ; mais aussi sur le fait qu’elle ignore nombres d’aspects et de problèmes existants. L’occupation de 1967 ne peut pas être comprise comme un problème externe, la lutte contre un envahisseur colonial, déconnecté des problèmes internes à Israël. L’apartheid et la politique d’occupation sont la base même de l’Etat d’Israël : le nettoyage ethnique de 800000 Palestiniens en 1948 et le refus constant d’autoriser leur retour, l’insolente discrimination et l’augmentation continue de la violence policière envers les palestiniens de l’intérieur, la nécessité de coloniser et de protéger la terre des occupants illégaux, de judaïser la périphérie, de mener la guerre démographique ; tout cela se passe en “Israël” et pas dans ce qu’il est convenu d’appeler les “territoires occupés”. L’occupation ne s’arrête pas au checkpoint, elle est tout autour de nous, il n’y a pas d’”ici” et de “là”. Israël est l’occupation.
La nécessité de la lutte commune
La lutte contre l’occupation et l’apartheid doit être menée, pas parce qu’elle est le premier pas vers la révolution ; mais simplement parce que les crimes de guerre quotidiens et les violations massives des droits humains ne devraient pas être permises, que les victimes de ces crimes soient des anarchistes révolutionnaires ou de pauvres travailleurs musulmans conservateurs. Le fait que ceux qui subissent l’oppression ne soient pas de parfaits sujets révolutionnaires (s’il existe une telle chose) ne diminue en rien mes obligations de me tenir à leurs côtés contre l’état, mon état, qui restreint leur droits fondamentaux. Ceci devrait être suffisant pour expliquer pourquoi il faut se battre sans répit contre l’occupation. Cependant, se battre contre quelque chose n’est jamais suffisant ; il faut aussi se battre pour quelque chose, pour un avenir différent, pour ce que nous pensons être la meilleure solution pour tous ; mais quelle serait-elle ?
Un des problèmes les plus importants pour la gauche radicale israélienne, particulièrement depuis le début de l’Intifada, est le travail politique commun de Palestiniens et de juifs Israéliens. Il faut le comprendre comme une réaction aux politiques racistes mises en place par Israël : séparation totale entre Israéliens et Palestiniens, que ce soit avec des murs (à l’intérieur des frontières de 1948 ou en Cisjordanie), à l’aide de checkpoints ou de routes ségrégationnistes, ou par des écoles séparées, des lois matrimoniales racistes et religieuses, et le harcèlement des personnes de “type arabe” à l’entrée de chaque centre commercial, restaurant ou boîte de nuit. Dans cette atmosphère si ouvertement raciste, l’acte le plus radical est de briser cette ségrégation en manifestant avec des Palestiniens, en vivant ensemble, en se parlant, en s’aimant et en prenant soin l’un de l’autre, et même en faisant l’amour ensemble. On ne réalise pas assez l’effet émotionnel profond et étonnant qu’à le fait pour un juif Israélien de rencontrer pour la première fois des Palestiniens en tant qu’égaux dans une lutte, ou même de devenir ami avec eux, et l’importance d’avoir de tels contacts pour remettre en question nos propres attitudes racistes et orientalistes et pour erradiquer cette théorie du “choc des civilisations”. (Je dois admettre personnellement que ce n’était parfois que grace à ma relation émotionnelle avec plusieurs amis palestiniens que je ne suis pas devenu fou face à la vague continuelle de propagande raciste et nationaliste.) Se rassembler, vivre ensemble, Ta’ayush en arabe, est à la fois notre moyen et notre fin.
La libération est un chemin
Faire tomber les barrières nationales et raciales peut sembler être le but ultime ; mais la situation est quelque peu plus complexe. Les Palestiniens, en tant que groupe ethnique souffrant d’une oppression nationale et privé de son auto-détermination et de son état, se battent contre cette oppression de la façon la plus habituelle : ils mènent un combat de libération nationale dans le but d’établir un état indépendant. Le fait que des gens obligés de vivre sous une oppression raciste ou nationaliste se confond en un groupe national comme moyen de combattre pour leurs droits, et que malheureusement, dans le même temps, presque toutes les luttes de libération nationale créent de nouveaux systèmes d’oppression, ne devrait pas nous être étranger à nous juifs israéliens.
Mais en tant qu’anarchistes, que devrions-nous faire dans ce combat ? Pour quoi sommes-nous exactement en train de nous battre, et avec qui ? Sommes-nous en train d’essayer d’être partie intégrante de ce “processus de libération nationale”, comme le sont certains activistes Israéliens de la gauche radicale, et devons-nous nous voir comme des juifs Palestiniens ? Ou bien faut-il penser que la libération nationale n’est qu’une étape à franchir, un pas en avant, et que le jour où ce combat sera victorieux (et ce que signifie la fin du combat de libération nationale en Palestine est une autre bonne question) sera aussi le jour où les masses exploitées palestiniennes commenceront la révolution sociale ensemble avec leur frères et soeurs de la classe ouvrière juive ? Ou peut-être tout ce que nous pensons et voulons est sans importance parce que nous appartenons à la société coloniale et qu’en tant que tels nous devrions seulement apporter notre solidarité inconditionnelle aux buts et aux besoins des opprimés ? Ces questions, même si elles sont posées de manière ironique, ne sont pas entièrement fausses. Une libération nationale est toujours ambigue : c’est la libération d’une oppression coloniale et dans le même temps la construction de nouveaux modèles d’oppression et d’exploitation ; et c’est exactement au sein de cette ambivalence que nous devons choisir notre chemin. Et cela se complique encore lorsqu’il s’agit non pas de renvoyer la puissance occupante dans son pays d’origine ; mais plutôt de décoloniser la société coloniale, en tenant compte des Israéliens non seulement en tant qu’oppresseurs actuels mais aussi en tant que peuple qui a droit aux mêmes droits et libertés que tous les autres peuples de la région.
La lutte commune des Palestiniens et Israéliens, comme le combat contre le mur que les AAtW [Anarchists Against the Wall - Anarchistes contre le Mur] sont en train de mener, ou les nombreuses campagnes que Ta’ayush a organisé dans les territoires occupés et dans le territoire israélien de 1948, semblent être la meilleure façon de contrer les nombreuses contradictions auxquelles il faut faire face d’une manière politiquement productive. Dans ce sens, le travail conjoint des Israéliens et des Palestiniens est sans doute l’un des buts, et probablement l’un des plus importants, de chaque campagne à laquelle nous participons, qu’il s’agisse du mur, des démolitions de maisons ou de la résistance face aux invasions de l’armée. A travers ce travail, nous déconstruisons les bases racistes de ce conflit. Un Israélien participant à une manifestation palestinienne, à ses risques et périls face à l’oppression brutale de l’armée, ne remet pas seulement en cause la compréhension de base du soldat Israélien (les soldats nous demandent très souvent, avant ou après nous avoir tiré dessus, si nous n’avons pas peur d’être tués dans les villages palestiniens par leurs habitants), mais aussi celle du fermier Palestinien qui n’a jamais rencontré d’Israélien que comme oppresseur.
Bien entendu, le rassemblement de Palestiniens et d’Israéliens n’est pas chose facile pour chacun des deux groupes. Nous devons nous souvenir que de nombreuses différences culturelles, politiques et sociales existent en parallèle avec nos positions de force au sein de ce conflit, positions que nous ne pouvons pas simplement ignorer dans l’espoir ou la croyance que nous ne sommes tous que des partenaires égaux dans un combat. La lutte pour remettre en cause et changer la culture palestinienne avec ses éléments patriarcaux, militaristes et homophobes n’est pas notre tâche mais celle de nos camarades Palestiniens auxquels nous devons offrir notre solidarité. Et ce tout d’abord en supprimant le poids de l’occupation de leurs épaules et en combattant ces mêmes éléments dans notre propre société. La libération est toujours un chemin dont le cours ne peut évoluer et s’accélérer que si l’on enlève les principaux obstacles qui se trouvent sur sa route.
La mise en place d’un futur commun pour les Israéliens et les Palestiniens, dans un présent riche de tant de conditions préalables, soulève nombre de contradictions. Notre plus grande épreuve est de trouver comment éviter que ces contradictions ne nous empêchent de poursuivre notre combat, et d’apprendre à en tirer des leçons qui nous permettrons d’avoir une meilleure compréhension de la lutte contre le capitalisme globalisé. Nous sommes sur le front géographique et idéologique de cette nouvelle guerre et nos expériences, victoires et échecs se répercuteront de par le monde.
Yossi Bartal
Traduit de l’anglais par Chris B.
Après l’élaboration de deux plans nationaux d’austérité [1], la Grèce a été contrainte d’accepter sa mise sous tutelle par le FMI [2], essentiellement, comme l’ont indiqué les autorités de l’UE et du FMI, pour recouvrer la « confiance des marchés ». Ce troisième programme d’austérité, comme ceux entérinés dans plusieurs autres pays européens [3], se base fondamentalement sur une réduction des dépenses publiques et sur une baisse des revenus des travailleurs. Au bénéfice du pays et de sa population ?
« Le gouvernement a conçu un programme crédible qui est économiquement équilibré, socialement équilibré – les groupes les plus vulnérables étant épargnés – et réalisable (…) pour – à terme – contribuer à faire repartir la croissance et l’emploi, et à rehausser les niveaux de vie » ; c’est en ces termes très élogieux que le directeur général du FMI a annoncé les mesures imposées par son institution à la Grèce [4].
Une autosatisfaction légitime ?
L’objectif annoncé de l’institution financière est de ramener le déficit public sous le seuil de 3% du PIB pour fin 2014 [5] via des mesures drastiques telles qu’une réduction considérable des dépenses publiques, la privatisation de beaucoup d’entreprises nationales [6], le gel des salaires et des pensions des fonctionnaires et retraités du secteur public ainsi que la suppression de leurs 13ème et 14ème mois, entre autres. Le relèvement de l’âge de la retraite et une hausse de la TVA (qui passe de 21 à 23%) [7] sont également d’application.

La succession de manifestations et grèves en Grèce [8] témoignent du rejet de ces mesures d’austérité imposées à la Grèce par le FMI et l’UE (ainsi que de celles imposées par les deux premiers plans d’austérité qui allaient dans le même sens).
Le peuple grec et la gauche [9] ne sont pas les seuls à rejeter les mesures du FMI. De nombreux économistes les condamnent également [10] ; l’austérité entraînera chômage et dépression qui provoqueront à leur tour une baisse de l’activité économique et de la consommation, entraînant de facto une contraction des recettes de l’Etat et, par conséquent, une diminution de sa capacité à rembourser la dette [11].
« Sacrifier la cohésion sociale à l’appétit des marchés est un crime contre la démocratie » [12]
Comme mesures alternatives, Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie [13], préconise la création par l’UE et la BC européenne d’un mécanisme d’aide aux pays membres très endettés, similaire à celui qui existe pour les banques [14] ainsi qu’une sérieuse remise en cause de la place accordée à la spéculation au détriment du travail dans nos sociétés [15].
« Aujourd’hui, les Grecs sont appelés à de très importants sacrifices, mais ces sacrifices sont vides de sens, ou plutôt, ces sacrifices risquent d’être détournés sous forme de prélèvements au bénéfice de la finance. Ce dont la Grèce et les autres pays européens ont besoin, c’est à la fois de dynamiser leurs activités productives autrement qu’en diminuant leurs coûts et de réinventer le lien social et la démocratie » [16].

Des dépenses publiques excessives ?
Le déficit public du pays n’est pas dû à un excès de dette publique mais à la pauvreté des recettes de l’Etat [17] suite à la baisse de l’activité économique (en raison de la conjoncture) et à l’incapacité de prélever assez d’impôts en raison d’une évasion fiscale considérable et d’une corruption très présente [18].
La Grèce, comme l’Espagne, le Portugal et l’Irlande sont souvent montrés du doigt comme des pays qui génèreraient des dépenses publiques colossales. Ces dernières auraient causé un déficit public élevé et une dette publique considérable, éléments qui empêcheraient la reprise économique. Or, ces pays ont, au contraire, les dépenses publiques les plus basses de l’UE des 15 et leur secteur public reste sous-développé. En outre, leur système fiscal reste peu progressif et il est caractérisé par une charge fiscale plus basse que la moyenne UE. Ces états souffrent également d’une fraude fiscale énorme et d’une redistribution très insuffisante des richesses [19], ces éléments entraînant de plus grandes inégalités de revenus [20].
A partir d’une telle situation, augmenter les recettes de l’Etat ne semble pas trop ardu ; les revenus potentiels sont à portée de main, ne manque que la volonté politique.
« IMF GO HOME » [21]
Le problème (de la Grèce comme de l’UE) n’est pas tant l’existence d’un déficit public élevé ou de sa dette que de la faible croissance économique et de l’augmentation structurelle du chômage.
Pourtant, comme dans une multitude d’autres pays européens, la recette préconisée s’attache aux indicateurs du déficit et de la dette alors que cette politique a déjà prouvé son inefficacité dans les pays en développement.
Une aide à la Grèce ?
Les prêts finalement consentis à la Grèce [22] ne lui ont pas été concédés pour l’aider mais pour prémunir les banques françaises et allemandes d’un défaut de paiement grec [23] suite à une crise que le secteur bancaire a lui-même contribué à créer [24] et dont l’endettement public est venu éviter la faillite [25] et réparer les grossières erreurs de jugement (à tout le moins) des agences de notation à la fois juges et parties de la situation [26] et sachant qu’elles sont intimement liées aux entreprises qu’elles jugent ? En premier lieu, elles sont rémunérées par les entreprises qu’elles sont chargées de noter, ensuite elles ont une activité de conseil qui consiste à aider les banques à créer des produits capables d’obtenir les meilleurs notes. La même procédure est à l’œuvre, en ce qui concerne les Etats ; avant d’emprunter, un Etat fait appel à la délivrance d’une notation par une agence (http://www.liberation.fr/economie/010168193-a-la-fois-juge-et-partie, 9/02/10) et la rémunère pour cette tâche. Depuis, les Etats-Unis ont promulgué une loi de réforme de la régulation financière (en juillet 2010) qui constitue un premier pas (encore très insuffisant) vers une possibilité de recours contre ces agences (http://www.lesoir.be/actualite/economie/2010-09-01/les-usa-accusent-moody-s-d-erreurs-dans-sa-notation-790640.php])].
« Comme Joseph Stiglitz l’a dit, avec tous les fonds dépensés pour aider les banquiers et les actionnaires, on pourrait avoir créé des banques publiques qui auraient déjà résolu les problèmes de crédit que nous connaissons (la Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Irlande) » [27]. Au lieu de cela, les banques et les agences de notation bénéficient d’une impunité quasiment totale et il revient à l’ensemble de la population de payer pour une crise créée par d’autres.
Des profits privatifs mais des pertes publiques
Quelle est donc cette règle que les Etats se laissent imposer ?
Il faudrait que les banques conservent tous les profits quand les temps leurs sont favorables et que la communauté rembourse leurs pertes dans le cas contraire ?
Le slogan « Bankers, gangsters » très présent dans les manifestations, résume bien cet état de fait.
Cette logique de privilèges des banques se perpétue pourtant ; après avoir été renflouées par des prêts publics aux taux très faibles, les Etats qui prêtent à la Grèce vont réaliser de sérieuses marges sur les prêts qu’ils lui consentent [28]. Pourquoi ce deux poids, deux mesures ?
Ce n’est pas à nous de payer leur crise ! [29]
Il est évident aux yeux de la majorité de la population que ce plan d’austérité ne vise pas au sauvetage du pays mais à celui des banques et de l’euro, c’est-à-dire celui des sphères financières et politiques au détriment d’une population de plus en plus exploitée.
Il n’est pas surprenant dès lors que la majorité des Grecs sont, actuellement, prêts à descendre manifester dans la rue contre de nouvelles mesures d’austérité [30].
Même au sein du Pasok [31], les mesures n’ont pas été faciles à accepter ; trois députés n’ont pas voté les mesures et ont été exclus du parti. Les syndicats socialistes ne font pas exception [32] à cette contestation.
Les deux grandes confédérations syndicales CGSE et ADEDY (dirigées par les socialistes) [33] ainsi que celle du PAME (communiste) [34] organisent de nombreuses journées de grèves et manifestations [35]. Objet : la dénonciation des mesures anti-sociales et l’appel à la résistance. Malheureusement, la gauche ne parvient pas à surmonter ses clivages historiques et ses dissensions internes [36] et ne bénéficie pas, comme la plupart des institutions grecques, d’une confiance importante au sein de la population. Quoi qu’il en soit, « les syndicats restent les grandes forces mobilisatrices même si beaucoup de personnes rejoignent les manifestations sans être attachées à l’un ou l’autre syndicat » [37].
La contestation regroupe des « manifestants de tous âges et de nombreuses personnes sont descendues pour la première fois dans la rue » et les grèves et manifestations s’enchaînent à un rythme rapide. En particulier, la grève du 5 mai de cette année a paralysé le pays [38] ; secteur privé et public étaient en grève qu’il s’agisse des transports, des écoles, des hôpitaux, des usines, ports, aéroports, commerces... Elle a rassemblé 300.000 manifestants.
Malgré que « la mort de trois personnes a cassé une partie de la dynamique contestataire, surtout en ce qui concerne les gens qui descendaient pour la première fois dans la rue », la grève générale du 5 mai a été suivie de beaucoup d’autres mouvements de grève et de manifestations ainsi que de témoignages de solidarité dans d’autres pays.
Le peuple grec sacrifié sur l’autel du néo-libéralisme
Le gouvernement tente d’endiguer ce mouvement de révolte de diverses manières ; par des tentatives répétées de faire porter à l’ensemble de la population la responsabilité de la situation économique actuelle [39] d’abord mais, également par une décrédibilisation des manifestants [40], de la répression policière [41] et de la désinformation [42].
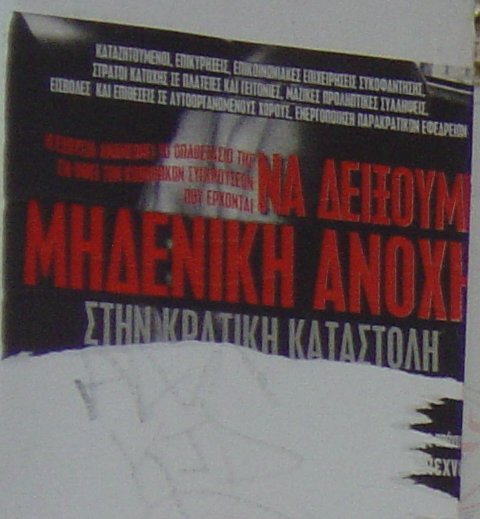
S’attaquer en premier lieu aux fonctionnaires du secteur public est également une manière de diviser la contestation, de désolidariser secteurs public et privé. « Le gouvernement s’attaque également à certaines professions privilégiées, pas très appréciées de la population (des professions fermées telles que les camionneurs, les taxis, etc… qui jouissent de privilèges hérités de la période du régime des colonels et qui, de ce fait, ne sont pas défendus par l’ensemble de la population). Et ce faisant, le gouvernement y associe d’autres professions (médecins, pharmaciens, etc…) pour généraliser la libéralisation du marché du travail ».
Enfin, comme lors de toute contestation sociale, le gouvernement tente d’user de vocabulaire adapté pour travestir la réalité [43] ; un exemple parlant est celui des privatisations, qualifiées de « mises en valeur des richesses du pays » [44].
Eponine Cynidès et Léandre Nicolas
Photographies d’Eponine Cynidès
Les passages en italique proviennent d’une interview réalisée le 28 août 2010 auprès de Yiorgos Vassalos, chercheur au « Corporate Europe Observatory » et Chloé (qui désire rester anonyme), membres de l’initiative d’organisation de la manifestation bruxelloise de solidarité aux manifestants grecs du 20 mai 2010 (jour de grève générale en Grèce) ainsi que d’Ermal Bubullima, Albanais résidant en Grèce depuis une quinzaine d’années, étudiant en Master 2 en Droits de l’homme à Strasbourg.
Leurs propos ont été recueillis par Eponine Cynidès et Léandre Nicolas.
[1] En janvier puis en mars 2010
[2] http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/04/26/l-intervention-du-fmi-une-humiliation-pour-la-grece_1342905_3214.html
[3] Italie, Portugal, Espagne, Irlande, Hongrie, Roumanie, Grande-Bretagne, Allemagne
[4] Déclaration de Dominique Strauss-Khan lors de la conférence de presse du FMI du 9 mai 2010, http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2010/pr10187f.htm
[5] http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/02/la-grece-a-conclu-un-accord-avec-l-ue-et-le-fmi-pour-assurer-sa-survie-financiere_1345610_3214.html, 02/05/10
[6] http://www.mediapart.fr/club/blog/velveth/020610/le-fmi-version-dsk-sest-il-adouci, http://www.jennar.fr/index.php/le-fmi-lomc-le-ps-et-les-privatisations/
[7] http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/02/les-principales-mesures-du-plan-d-austerite-grec_1345619_3214.html, 2/10/10
[8] http://www.challenges.fr/actualites/monde/20100216.CHA1438/chronologie_de_la_crise_financiere_grecque.htmlhttp://www.arte.tv/fr/content/tv/02__Universes/U1__Comprendre__le__monde/02-Magazines/10__ARTE_20Journal/14_20Dossiers/2010.02.16__grece/ART_20chronologie/3070054.html
[9] Le parti socialiste est au pouvoir, ce qui n’empêche pas le syndicat lié au Pasok à manifester en masse
[10] http://m.letemps.ch/Page/Uuid/8509f0e2-683b-11df-9407-53de06d380d1/Plans_daust%C3%A9rit%C3%A9_trop_brutaux_mise_en_garde_d%C3%A9conomistes, 26/05/10 ; http://actu.orange.fr/economie/nouriel-roubini-met-en-garde-contre-trop-de-mesures-d-austerite-en-europe_43429.html?bReact=true, 3/09/10 ; http://www.euractiv.fr/economie-finance/article/2010/05/26/cure-dausterite-haut-risque-en-europe_68116, 26/10/10 ; http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/13/un-plan-d-austerite-a-l-oppose-des-besoins-de-la-grece-et-de-l-europe-par-gabriel-colletis_1350560_3232.html, 13/05/10, http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/05/22/joseph-stiglitz-l-austerite-mene-au-desastre_1361520_3234
[11] Les revenus de l’Etat dépendent à la fois de sa capacité à prélever des impôts et de la croissance économique
[12] Un des slogans fréquemment utilisés lors des manifestations
[14] http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/stiglitz-prone-la-creation-d-un-mecanisme-de-soutien-financier-en-europe_2..., 2/02/10
[15] http://www.sacra-moneta.com/Crise-financiere/Le-triomphe-de-la-cupidite-de-Joseph-Stiglitz.html
[16] Gabriel Colletis, professeur à l’université Toulouse I, http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/13/un-plan-d-austerite-a-l-oppose-des-besoins-de-la-grece-et-de-l-europe-par-gabriel-colletis_1350560_3232.html, 13/05/10
[17] Selon les chiffres d’Eurostat, en 2000, les recettes fiscales de la Grèce s’élevaient à 34,6% du PIB (40,6% pour la moyenne de l’UE27) et sont tombées à 32,1% en 2007 (39,8% pour la moyenne de l’UE27), http://contreinfo.info/article.php3?id_article=3023
[18] En 2008, seulement 0,5% des Grecs ont déclaré plus de 30.000 euros de revenu. Et un million aurait payé des sommes des dessous de table pour des services public, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/le-trauma-grec_853970.html?p=2. Transparency Greece a publié une enquête accusatrice sur la corruption en Grèce entre 2007 et 2009. Le panel de 6122 personnes interrogé par Public Issue, a mentionné 599 180 actes de fraude à l’Etat et 357 719 au secteur privé. En première ligne figurent les hôpitaux (33,5 %), les services d’urbanisme (15,9 %) et les bureaux du fisc (15,7 %) le ministère des transports, la Sécurité Sociale (IKA), les préfectures et les municipalités. Pour le privé, les hôpitaux (15,9 %), les banques (10,8 %), les avocats (9 %) se placent en tête. Suivis par les garages de contrôle technique automobile [KTEO], les cliniques, les écoles de conduite, les ingénieurs civils et les plombiers. La somme moyenne des petits enveloppes (fakelakia) ou pot-de-vin s’élève à 1.355 euros dans le public, contre 1.671 euros dans le privé. En 2009, 787 millions ont été absorbé par la corruption, contre 748 en 2008 et 639 en 2007 (http://www.metiseurope.eu/gr-ce-dompter-la-col-re-olympienne_fr_70_art_28753.html).
[19] Les situations suivantes sont symptomatiques des inégalités de revenus qui ont cours dans la société grecque ; « En 2009, les armateurs grecs ont versé moins d’argent en impôts que l’argent payé par les immigrés (sous forme de taxes pour obtenir leur carte verte) » (http://www.cahiersdusocialisme.org/2010/05/07/le-desespoir-et-la-resistance-en-grece, 15/03/10), la plupart des employeurs grecs ont transféré leurs actifs dans des sociétés chypriotes (taux d’imposition de 10%) et l’église grecque (propriétaire terrien important) est exemptée d’impôts. A côté de ces situations de privilèges pratiquement illimités, le pouvoir d’achat grec ne s’élève qu’à 92% de la moyenne de la zone euro alors que les salaires n’atteignent que 70% (http://www.cahiersdusocialisme.org/2010/05/07/le-desespoir-et-la-resistance-en-grece, 15/03/10)
[20] Vicenç Navarro, professeur de sciences politiques, 11/10/10, http://www.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/dossiers/crises/article/ce-que-l-on-ne-dit-pas-sur-la?lang=fr
[21] « FMI, rentre chez toi », un des slogans fréquemment utilisés lors des manifestations
[22] L’UE et le FMI lui prêtent 110 milliards d’euros sur trois ans
[23] http://www.cahiersdusocialisme.org/2010/05/22/debat-les-mouvements-sociaux-sont-ils-solubles-dans-lausterite-1/, 22/05/10. A titre d’exemple, les banques françaises sont exposées à hauteur de 51 milliards d’euros (http://www.tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20100429.OBS3199/onze-questions-reponses-sur-la-crise-grecque.html, 29/04/10
[24] Goldman Sachs a fait du délit d’initié ; sous le gouvernement Karamanlis, la banque a d’abord aidé la Grèce à cacher l’ampleur de sa dette au reste de l’UE pour, ensuite, en profiter pour spéculer sur la baisse de la note du pays décernée par les agences de notation (http://www.marianne2.fr/Dette-grecque-Goldman-Sachs-revoila-les-banksters_a185141.html, 16/02/10)
[25] Paul De Grauwe, professeur d’économie à la KUL Leven, http://econet.blogs.lalibre.be/archive/2010/07/20/paul-de-grauwe-fustige-la-panique-des-marches-et-les-politiq.htm
[26] Actuellement, trois agences dominent le marché (Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch représentent 80% du marché). L’absence de véritable remise en cause des agences de notation est assez surprenante, surtout après leur non-anticipation de la crise des subprimes. En accordant la meilleure note (AAA) à des produits financiers très risqués et en ne commençant à les dégrader que six mois après le début de la crise, les agences ont permis à ces produits financiers d’être dispersés dans tout le système. Peut-on faire confiance à ces agences sachant que la crise des subprimes n’était pas la première situation lors de laquelle elles n’ont pas joué leur rôle d’information des marchés sur les risques auxquels ils étaient exposés. La situation s’était, en effet, déjà présentée lors des crises de la dette en Amérique latine et en Asie et dans les cas des faillites d’Enron (2001) et Worldcom (2002), (http://www.lemonde.fr/economie/chat/2010/01/27/les-agences-de-notation-ont-elles-trop-de-pouvoir_1297252_3234.html, 28/04/10 et http://www.lexpress.fr/actualite/economie/agences-de-notation-juges-et-parties_8903...), 06/05/10
[27] Vicenç Navarro, professeur de sciences politiques, 11/10/10, http://www.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/dossiers/crises/article/ce-que-l-on-ne-dit-pas-sur-la?lang=fr
[28] La France va emprunter à environ 3% et prêter à 5%, la différence devrait rapporter 150 millions d’euros. http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20100429.OBS3199/onze-questions-reponses-sur-la-crise-grecque.html
[29] Un des slogans fréquemment utilisés lors des manifestations
[30] Selon un sondage réalisé le samedi 1er mai 2010, http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/02/la-grece-a-conclu-un-accord-avec-l-ue-et-le-fmi-pour-assurer-sa-survie-financiere_1345610_3214.html, 5/05/10
[31] Le parti socialiste, au pouvoir
[33] La CGSE, la confédération générale des travailleurs grecs, structurée en 70 fédérations professionnelles, représente les salariés du secteur privé (un million d’adhérents) et l’ADEDY, qui regroupe 46 fédérations, représente les agents publics (300.000 membres), http://www.metiseurope.eu/gr-ce-dompter-la-col-re-olympienne_fr_70_art_28753.html
[35] http://www.regards.fr/article/?id=4526, 14/07/10
[36] La confédération a du mal à coordonner les 70 fédérations professionnelles existantes, bien plus nombreuses que ce qui existe dans les pays européens. De plus, les fédérations ont peu de prise sur les 2 500 syndicats. En outre, tous les courants politiques sont représentés en tant que tels dans les confédérations syndicales. Ainsi le PASOK socialiste détient 21 sièges sur 45 au sein de la GSEE, le centre droit en a 11, le PC 10, les radicaux de gauche 2, la droite 1. Les relations avec les partis sont donc complexes, chacun tentant d’influencer l’autre. En interne, les débats sont fortement politisés et reflètent ceux des partis politiques. Cette proximité entre syndicalistes et politiques ne favorise pas une forte autonomie du syndicalisme et une image positive dans l’opinion (http://www.clesdusocial.com/mois-social/mois-social-10/05-europe-monde/grece-la-regulation-sociale.htm, 5/05/10). En outre, « Il est courant que les présidents de la CGSE deviennent ministres par la suite » et les deux grands syndicats sont plutôt « poussés par leur base pour organiser des mouvements de contestation »
[37] Les phrases en italique, ci-après, proviennent d’une interview réalisée le 28 août 2010 auprès de Yiorgos Vassalos, chercheur au « Corporate Europe Observatory » et Chloé (qui désire rester anonyme), membres de l’initiative d’organisation de la manifestation bruxelloise de solidarité aux manifestants grecs du 20 mai 2010 (jour de grève générale en Grèce) ainsi que d’Ermal Bubullima, Albanais résidant en Grèce depuis une quinzaine d’années, étudiant en Master 2 en Droits de l’homme à Strasbourg. Leurs propos ont été recueillis par Eponine Cynidès et Léandre Nicolas
[38] http://www.lahaine.org/index.php?p=45546, El pueblo de Grecia lucha por la Humanidad, 18/05/10
[39] Lorsque le gouvernement parle de responsabilité collective, il évoque principalement l’aversion de la population grecque à s’acquitter de ses impôts. Ce qu’il oublie de souligner, ce faisant, c’est que cette aversion est due à la politique et au comportement des gouvernements grecs successifs. « Des scandales de corruption ont touché les deux grands partis, il n’est pas possible de restaurer la confiance ». Par ailleurs, « La convergence des intérêts des élites politiques grecques avec les élites économiques des pays investisseurs entraîne un sentiment d’injustice de la part des petites et moyennes entreprises ». En outre, la pauvreté de la qualité de l’offre de services publics vient s’ajouter à ces éléments : « Pourquoi payer des taxes quand on ne reçoit pas grand-chose en échange ? »
[40] La manifestation devant le parlement, à Athènes, a été perturbée par une infiltration par l’extrême-droite, on a pu reconnaître des policiers en civil parmi eux (http://www.lahaine.org/index.php?p=45546, El pueblo de Grecia lucha por la Humanidad, 18/05/10)
[41] « Il se passe beaucoup de choses dans le quartier d’Exarchia (quartier de gauche d’Athènes et de l’école polytechnique). Après des événements contestataires, la police fait des descentes dans les bars et chez les gens également. Ils débarquent dans des centres culturels, dans des réseaux solidaires pour les immigrés et mettent l’endroit à sac ».
[42] A titre d’exemple, le ministre grec des Affaires sociales a déclaré que l’âge de la retraite était de 53 ans en Grèce. Selon les statistiques d’Eurostat, l’âge légal de la retraite en Grèce est pourtant de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Et l’âge moyen de sortie du marché du travail était de 61ans pour les femmes et 62,5 ans pour les hommes en 2005 (http://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/desintox-les-grecs-et-la-retraite-74461)
[43] Le premier ministre Papandreou a parlé à maintes reprises d’une nouvelle « odyssée » à entreprendre pour la population grecque. Le détricotage des acquis sociaux, un voyage plus ou moins mouvementé et rempli d’aventures singulières (http://fr.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9e) ?
[44] Le gouvernement accélère les procédures de mise en valeur des biens publics, http://www.amb-grece.fr/actualites/declarations_gouvernementales.htm, 3/06/10
Après l’élaboration de deux plans nationaux d’austérité [1], la Grèce a été contrainte d’accepter sa mise sous tutelle par le FMI [2], essentiellement, comme l’ont indiqué les autorités de l’UE et du FMI, pour recouvrer la « confiance des marchés ». Ce troisième programme d’austérité, comme ceux entérinés dans plusieurs autres pays européens [3], se base fondamentalement sur une réduction des dépenses publiques et sur une baisse des revenus des travailleurs. Au bénéfice du pays et de sa population ?
Voici la deuxième partie d’un article consacré aux politiques d’austérité en Grèce et aux luttes qui en découlent. Vous pouvez retrouver la première partie ici.
Explosion sociale latente
Contrairement aux mouvements actuels de contestation en Grèce (essentiellement encadrés par les syndicats), le 6 décembre 2008, les émeutes s’étaient déclenchées de façon immédiate et spontanée un peu partout dans le pays [4]. D’abord dirigées contre les forces de l’ordre, elles s’étaient généralisées, en quelques jours, à l’ensemble des symboles de l’Etat (bâtiments publics, etc…).
Contrairement à la contestation actuelle, qui reste canalisée pour le moment, on peut parler d’ « action collective insurrectionnelle », c’est-à-dire d’une explosion synonyme de remise en cause violente et soudaine des valeurs établies [5]. Un cas de répression policière meurtrière a rapidement engendré une diffusion de l’action insurrectionnelle à l’ensemble de la société.
Cette insurrection a échappé au contrôle de l’Etat ainsi que des partis de l’opposition car il s’agissait d’une véritable explosion sociale. « La révolte de décembre touche à un noyau plus fondamental de l’Etat. L’insurrection survient parce l’Etat réprime et exploite, pas parce qu’il promeut une loi particulière » [6]. Elles témoignaient d’un « profond malaise » d’une frange importante de la population grecque à l’égard de la politique de ses dirigeants.
« Ces événements ont engendré une prise de conscience d’un grand nombre de personnes [7] » et des couches de la population, généralement absentes des manifestations sont descendues dans la rue. Des parents et grands-parents ont même accompagné leurs jeunes dans la rue [8].
Perspectives
Contrairement aux émeutes qui ont débuté en décembre 2008, « le mouvement étudiant est plutôt dormant pour le moment. Il y a des participations d’étudiants aux manifestations, bien sûr, mais il y a peu d’organisation d’assemblées et elles sont peu actives ». Cet élément préfigure un potentiel d’accroissement de la contestation actuelle surtout au vu des événements de 2008 où les étudiants ont joué un rôle important dans la révolte et sa propagation. La mémoire collective n’a pas non plus oublié la révolte de l’école polytechnique d’Athènes et le rôle décisif joué par les étudiants dans la chute du régime des colonels [9].
Actuellement, le taux de chômage des jeunes en Grèce s’élève déjà à près de 30% [10]. Le mesures d’austérité vont aggraver cette situation qui est déjà socialement explosive.
De plus, au fur et à mesure de la mise en œuvre des diverses mesures du plan du FMI relatives aux privatisations [11], on peut s’attendre à des mouvements de contestation sectoriels qui vont nourrir et amplifier la révolte. « Les syndicats du Pasok contrôlent le secteur de l’électricité. On peut s’attendre à de très grands mouvements de grève contre la privatisation prévue, mouvements qui toucheront l’ensemble de la population (par l’intermédiaire des prévisions de hausses des prix). Les syndicats refusent de privatiser les mines de lignite et le secteur hydro-électrique et menacent de couper l’électricité « jusqu’à ce que le dernier d’entre eux soit mis en prison » » [12]
D’autres moments particuliers sont également susceptibles de ranimer la colère du peuple grec ; en particulier, « La manifestation du 17 novembre à Athènes risque d’être très animée ! ». Traditionnellement, le 17 novembre [13], chaque année depuis la chute de la junte militaire, des manifestants se rendent devant l’ambassade des Etats-Unis en réaction au soutien du pays à la dictature [14]. On peut s’attendre à des manifestations d’une ampleur sans précédent cette année, le FMI étant une institution associée sans équivoque à l’impérialisme étasunien au sein de la population grecque. Sans compter que cette commémoration suivra de peu l’exposition internationale de Thessalonique du 7 septembre, moment de l’annonce des mesures budgétaires pour l’année à venir par le premier ministre, à l’occasion de laquelle des manifestations sont systématiquement organisées. « Habituellement, ce sont plutôt la gauche et les anarchistes qui manifestent ainsi que tous ceux qui se sentent menacés par la précarité et les mesures d’austérité. Il s’agit aussi d’une contestation par rapport à la répression et aux violences policières [15].
» et à l’impunité dont elles bénéficient [16]. Cette année, ces manifestations draineront certainement des personnes de toutes les couches de la population, « La contestation prendra des formes de plus en plus violentes, qui seront directement liées aux effets du renversement du rapport de forces au dépens de la société » [17].
« Peuples d’Europe, soulevez-vous ! »
Le 4 mai, le KKE [18] occupait symboliquement l’Acropole et y affichait cette pancarte, à côté de ses revendications [19].

A l’heure où de nombreux pays européens [20] appliquent des programmes d’austérité sur un modèle édulcoré mais utilisant les mêmes armes que le plan d’austérité à l’œuvre dans la république hellénique, « La Grèce préfigure bien la tiers-mondisation de l’Europe » [21], « La Grèce est un peu le cobaye, le laboratoire de l’UE, il s’agit de la plus grande dégradation (mis à part les pays de l’Europe de l’est), depuis la seconde guerre mondiale, du standard de vie, une réduction des revenus des gens de l’ordre de 30 à 40% ».
La logique de ces plans d’austérité témoigne de la financiarisation croissante des économies [22] ; « La spéculation se porte désormais sur les monnaies et les dettes publiques » [23]. En Islande, en mars 2010, la population a refusé, par référendum [24] de payer pour des dettes qu’elle n’a pas causées (la faillite de la banque Iscave [25]. « Il est injuste que les citoyens ordinaires paient la facture des extravagances de quelques-uns (...) Partout dans le monde, c’est l’argent du contribuable qui sauve le système financier » [26].
En plus d’aller à l’encontre des droits sociaux et d’une juste redistribution des revenus, ces mesures sont un non-sens en matière d’économie. Et contrairement à ce qu’affirme le FMI, les groupes sociaux les plus vulnérables sont les premières victimes de ces programmes d’austérité.
La résistance à ces politiques passe par une solidarité internationale de l’ensemble des manifestants des pays européens et un refus des diktats néo-libéraux imposés par l’UE et le FMI.

Eponine Cynidès et Léandre Nicolas
Les passages en italique proviennent d’une interview réalisée le 28 août 2010 auprès de Yiorgos Vassalos, chercheur au « Corporate Europe Observatory » et Chloé (qui désire rester anonyme), membres de l’initiative d’organisation de la manifestation bruxelloise de solidarité aux manifestants grecs du 20 mai 2010 (jour de grève générale en Grèce) ainsi que d’Ermal Bubullima, Albanais résidant en Grèce depuis une quinzaine d’années, étudiant en Master 2 en Droits de l’homme à Strasbourg.
Leurs propos ont été recueillis par Eponine Cynidès et Léandre Nicolas.
Crise grecque : l’arbre qui cache la forêt
Les principales agences de notation (Moody’s, S&P et Fitch) ont une responsabilité indéniable dans la crise des subprimes. Et elles n’en sont pas à leur coup d’essai (cf. notation d’Enron). Elles ont d’ailleurs été convoquées au Congrès américain il y a 2 ans pour y rendre des comptes ; on envisageait même leur démantèlement, vu qu’elles sont juges et parties. Mais rien ne semble avoir changé depuis.
Ces sociétés continuent de faire la pluie et le beau temps sur les marchés financiers internationaux alors qu’elles ont une politique de deux poids deux mesures : certes la situation des finances publiques grecques n’est pas reluisante (surtout après avoir aidé le secteur bancaire à sortir de la crise, sans oublier les éternels problèmes de fraude fiscale et de corruption...) mais elle est loin d’atteindre les sommets de la dette des Etats-Unis qui, eux, bénéficient d’une belle notation AAA malgré que l’endettement du pays atteint les 160% du PIB !
On est dès lors amené à se poser la question du véritable rôle de ces agences : à qui profite le crime ?
1) au système financier qui, grâce à cette spéculation financière s’est refait une belle santé, distribuant à nouveaux des bonus astronomiques à ses traders les plus « fous ».
2) au Trésor américain qui voyait les capitaux internationaux se diriger de plus en plus vers l’euro plutôt que vers le dollar américain, surtout depuis 2007 où le déficit de sa balance des paiements n’est plus compensée par un solde net de flux financiers (par l’intermédiaire de bons du Trésor US)
3) à la droite au sens large puisque les gouvernements européens, même les plus socialistes, se mettent à « réformer » les acquis sociaux les plus élémentaires (santé, éducation, pensions, etc.), la Grèce jouant le rôle d’épouvantail.
Dans le contexte financier actuel, quoi de plus simple donc que de s’attaquer à l’euro, les finances publiques de tous les pays de la zone étant complètement exsangues. Et autant le faire par son point le plus faible : la Grèce.
Au vu des bénéficiaires de cette crise de l’euro, on comprend peut-être mieux pourquoi on a tout fait pour impliquer le FMI (à la solde des USA), garant du système financier international, alors que les pays européens à eux seuls auraient pu aider la Grèce en lui prêtant les fonds nécessaires.
Encouragées par les premiers résultats de leur supercherie, voilà que les agences de notation se mettent à donner des leçons aux gouvernements, elles qui les ont mis dans le pétrin avec la crise des subprimes ! C’est le monde à l’envers !
En effet, tout en s’acharnant sur la Grèce, elles martèlent, depuis plusieurs mois, que les finances publiques de tous les « PIGS » comme elles les appellent (Portugal, Italy, Greece, Spain) sont en piteux état... Les grands media reprennent la chanson en cœur (sans trop comprendre le comment du pourquoi) et, quand les esprits sont bien brouillés et que les gens ont peur de ce qui passe en Grèce, elles baissent le rating espagnol sans raison particulière, ce qui poussent ces pays (et tout doucement le reste de l’Europe) à prendre des mesures anti-sociales d’une ampleur sans précédent...
Quelle solution pour sortir de cette crise ? Les caisses de tous les états européens sont vides et, pour rétablir l’équilibre, on oublie souvent qu’on peut aussi augmenter les recettes. Impensable dans une période de crise me direz-vous ! Impensable en effet, si l’on s’attaque à la grande majorité des citoyens qui souffrent déjà de la crise, via le travail ou la consommation, comme on le fait actuellement. Mais pourquoi ne songe-t-on pas à taxer d’avantage les revenus du capital ? La grande majorité de la population souffrirait-elle d’une taxe sur la spéculation boursière par exemple ? L’investissement boursier en souffrirait-il ? Non. Seule une infime minorité de spéculateurs paieraient le prix de bénéfices faciles et rapides et ceci ralentirait les mouvements spéculatifs. Une telle taxe n’est pas envisageable au niveau national mais ne poserait pas de problème au niveau européen ! Le niveau de taxation moyen des entreprises en Europe est de 25% alors qu’il est de 40% aux USA, les entreprises américaines ont-elles pour autant toutes quitté le territoire US pour s’installer en Europe ? Non. Certes, les capitaux sont beaucoup plus mobiles mais une taxe de quelques dixièmes de pourcents sur la spéculation financière (suivi des marchés mondiaux afin de détecter l’achat et la vente d’un titre ou d’une devise européens dans un délai très court à définir), outre son rôle de justice fiscale et d’accalmie spéculative, représenterait des milliards d’euros qui contribueraient à autofinancer l’Europe et permettraient aux gouvernements nationaux de retrouver une marge de manœuvre budgétaire afin de garantir leur souveraineté politique, économique, sociale et culturelle.
LN
Sources :
– http://crise-europe.blog.lemonde.fr/2009/05/27/faut-il-taxer-les-benefices-au-niveau-europeen/
– http://www.attali.com/ecrits/articles/finance/la-depression-mondiale-est-devant-nous
– http://www.moneyweek.fr/20100429126/conseils/economies/deficit-grece-portugal-espagne/
[1] En janvier puis en mars 2010
[2] http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/04/26/l-intervention-du-fmi-une-humiliation-pour-la-grece_1342905_3214.html
[3] Italie, Portugal, Espagne, Irlande, Hongrie, Roumanie, Grande-Bretagne, Allemagne
[4] Suite au meutre du jeune Alexis Grigoropoulos (15 ans) par un policier à Athènes
[5] Seraphim Seferiadès (enseignant au sein du département de sciences politiques de l’univesité Panteion) et Loukia Kotronaki (chercheur en sciences politiques), http://www.contretemps.eu/interviews/decembre-grec-comme-action-insurrectionnelle, 18/12/09
[6] Seraphim Seferiadès (enseignant au sein du département de sciences politiques de l’univesité Panteion) et Loukia Kotronaki (chercheur en sciences politiques), http://www.contretemps.eu/interviews/decembre-grec-comme-action-insurrectionnelle, 18/12/09
[7] Les passages en italique proviennent d’une interview réalisée le 28 août 2010 auprès de Yiorgos Vassalos, chercheur au « Corporate Europe Observatory » et Chloé (qui désire rester anonyme), membres de l’initiative d’organisation de la manifestation bruxelloise de solidarité aux manifestants grecs du 20 mai 2010 (jour de grève générale en Grèce) ainsi que d’Ermal Bubullima, Albanais résidant en Grèce depuis une quinzaine d’années, étudiant en Master 2 en Droits de l’homme à Strasbourg.
Leurs propos ont été recueillis par Eponine Cynidès et Léandre Nicolas.
[8] http://www.monde-diplomatique.fr/imprimer/16707/ee701f36b1, janvier 2009
[10] http://www.le monde.fr/economie/article/2010/05/22/joseph-stiglitz-l-austerite-mene-au-desastre_1361520_3234.html, 22/O5/10
[11] Cfr. supra
[12] http://www.info-grece.com/news/societe/201008/syndicats-electricite-de-grece-menacent-de-blackout,5404F1.html, 4/08/10
[13] Date de la commémoration de l’intervention des chars de l’armée dans l’école polytechnique contre la révolte étudiante
[15] Un rapport d’Amnesty International (http://www.amnestyinternational.be/doc/article14407.html, Rapport AI : http://www.amnestyinternational.be/doc/IMG/pdf/eur250012009en.pdf) fait état, après le 6 décembre 2008, de nombreux cas de violences policières, arrestations arbitraires et refus d’assistance légale rapide de la part de la police ainsi que d’arrestations, détention et expulsion d’immigrés dans le contexte des émeutes et de non-respect des droits spécifiques des mineurs ainsi que de mauvais traitements à leur encontre. Des abus de pouvoir sont également dénoncés (http://www.france24.com/fr/20081021-europe-grece-policier-immigre-nu-presse-emoi)
[16] « La mentalité et les méthodes de la police sont un héritage de la période de la junte militaire. A l’époque, les policiers venaient de milieux peu éduqués et étaient utilisés par la junte pour faire le sale boulot. Actuellement, la situation a changé mais cette ‘culture’ d’impunité n’a pas été éradiquée ».
[17] http://www.mediapart.fr/club/blog/georges-contogeorgis/081208/la-revolte-de-la-jeunesse-en-grece-et-le-caractere-politique-de-la-crise-actuelle, 8/12/09
[18] Un des partis communistes grecs
[20] Pour se limiter à l’UE
[22] http://www.marianne2.fr/Exclure-la-Grece-ou-l-Allemagne-Ce-serait-faire-le-lit-des-marches_a190031.html
[24] A 93%
[25] http://www.la-croix.com/Islande-Hongrie-Argentine-les-lecons-de-la-rigueur/article/2424509/55400
[26] Steingrimur Sigfusson, ministre des finances d’Islande, http://www.lexpress.fr/outils/imprimer.asp?id=852913&k=2
Cet article en deux parties est un texte collectif, rassemblant les expériences et les opinions de divers militants actifs dans les réseaux No Border. Ainsi, nous tenterons de présenter l’histoire des camps No Border tout en expliquant comment les réseaux No Border sont confrontés aux questions de légalité et d’illégalité. Sur base de ces expériences partagées, nous proposons, simplement, de renoncer au questionnement quant à la légalité ou à l’illégalité, afin d’offrir une autre lecture du monde qui nous entoure. Nous revendiquons la légitimité de nos actions, qui seule, à nos yeux, peut les conditionner.
A propos des réseaux et des camps No Border
La genèse du réseau No Border remonte à un appel lancé à l’occasion du sommet européen de Tampere [1](1999). Cet appel s’adressait aux activistes, groupes ou associations militant autour des droits des réfugiés, des migrations clandestines, du contrôle social ainsi que des politiques anti-migratoires et des effets des ces dernières sur la vie des migrants comme sur celle des habitants des pays dits « d’accueil ». Il visait à échanger des informations et des compétences et à développer un réseau capable de poursuivre la lutte contre les politiques européennes anti-migratoires. Un réseau informel, assez large tant géographiquement qu’en termes de diversité d’actions, s’est ainsi développé par la connexion de réseaux locaux préexistants [2]. Un réseau dont la revendication de base, commune mais déclinée sous diverses formes et stratégies locales, est la liberté de circulation et d’installation, le caractère « collectif » de notre planète. Un réseau dont la dynamique était initialement fondée sur quatre thèmes : un appel pour une campagne européenne contre les expulsions, un appel à organiser des journées d’action internationales, un appel pour une campagne contre les centres fermés, et l’organisation de camps No Border.
Au fil du temps les thématiques se sont élargies et le réseau a évolué, mais il reste un réseau d’activistes, refusant de se muer en organisation formelle, en parti ou mouvement politique, et donc conservant une diversité dans les tactiques, les approches et les thèmes. Ni chef ni hiérarchie au sein du vaste réseau No Border, mais un partage des responsabilités et des tâches en perpétuelle évolution, selon les compétences et les affinités de chacun.
Un exemple du cheminement suivi par le réseau au cours des années est l’évolution des thèmes des camps No Border. A l’origine, ces camps étaient conçus comme des occasions de soutenir physiquement les migrants à passer les frontières, comme cela a été fait à Bialystok [3], au Mexique… Plus tard, des camps No Border ont été organisés pour contester le contrôle social, l’oppression des migrants entrés en Europe et le refus de leur assurer des soins médicaux, la possibilité de se loger, de travailler… Ainsi le camp No Border de Strasbourg (2002) était axé sur l’opposition au « Schengen Information system » (SIS), un système mis en œuvre pour échanger les empreintes digitales et les données biométriques des réfugiés, facilitant ainsi grandement le contrôle, voire la traque, des réfugiés déjà entrés en Europe.
« La folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat différent » A. Einstein
Un camp No Border vise à créer un espace autonome, libre, autogéré et égalitaire pour que des activistes y partagent compétences et informations et agissent contre les politiques anti-migratoires, luttant contre le système qui exploite et opprime tant les migrants que bien d’autres personnes. Il s’agit, d’une certaine manière, de la matérialisation temporaire des fondements du réseau : dans un lieu donné, pour une période donnée, se rejoindre physiquement et lutter ensemble, aussi différents que nous soyons dans nos parcours, nos idées et nos tactiques, contre ce système [4]que tous nous rejetons.
Cette année, c’est à Bruxelles que le camp No Border a choisi de s’installer [5].
Sur la question de la légalité et de l’illégalité
Les réseaux No Border ont toujours été confrontés à des questions quant à la légalité et à l’illégalité, et ce sous deux aspects. Le premier, fondamental et intrinsèquement lié à notre combat, concerne l’exclusion d’individus par les autorités, qui n’hésitent pas à les réduire à un « non-statut », celui « d’illégal », sur base de leurs origines et de leur situation. Le second aspect, assez général, est rencontré par bien des groupes et associations s’opposant aux pouvoirs [6] en place, et est lié aux modes d’actions choisis pour atteindre leurs objectifs ainsi qu’à la perception qu’a la force publique de ces contestataires.
Parce qu’il n’y a pas d’humains illégaux mais seulement des lois inhumaines
Le premier aspect est donc centré sur la personne, déclarée légale ou illégale, selon son pays d’origine et la manière dont elle est entrée sur le territoire de l’Union européenne. Il est aisé à analyser de notre point de vue : la différence faite entre la légalité ou l’illégalité de personnes franchissant des frontières est une distinction sans importance pour les participants à un réseau No Border. Nous considérons que les frontières ne sont ni naturelles ni légitimes, qu’elles divisent les individus et dispersent ainsi la résistance contre les Etats qui les mettent en œuvre. Elles sont en outre source de nombreuses injustices. Pour les activistes No Border, il est impensable et inadmissible, car illégitime, que quelqu’un (ou même sa migration) puisse être déclaré légal ou illégal. En premier lieu, seul un acte devrait pouvoir être considéré comme légal ou illégal, et certainement pas un être humain, ce qui serait aussi réducteur…qu’inhumain. Il ne s’agit donc à nos yeux que d’un odieux marquage administratif, foncièrement inepte, mais aux conséquences lourdes. Ensuite vient la légitimité de la migration. En tout premier lieu, comme précisé précédemment, nous sommes favorables à la liberté de circulation (et d’installation) de tous. Nous ne comprenons pas comment sa limitation pourrait être défendable éthiquement, sur quelle base morale une grande part de la population mondiale pourrait être privée de cette liberté de base. Nos arguons que les sociétés peuvent et doivent être adaptées aux migrations, et non le contraire. Enfin, les gens qui émigrent ont une raison de le faire. Tenter d’améliorer ses conditions de vies ou celles des siens est légitime. La différence faite entre réfugié politique et réfugié économique est une distinction qui n’a aucun sens. Si par exemple un pêcheur sénégalais émigre car il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, il est également réfugié politique puisqu’une décision politique est à la base de l’abandon des côtes sénégalaises à des entreprises chinoises [7], décision politique émanant d’une vision capitaliste des ressources. Le même principe reste valable pour les réfugiés de guerre comme pour les réfugiés climatiques.
La politique migratoire européenne tente de faire la différence entre de « bons » et de « mauvais » réfugiés [8], limitant de fait les raisons pour lesquelles des personnes pourraient migrer « légitimement ». L’unique intérêt à faire une telle distinction, artificielle et purement subjective, est de continuer à diviser et à exploiter une grande partie de la population. Pour les raisons énoncées ci-dessus, nous renonçons à cette distinction, considérant qu’« il n’y a pas d’humains illégaux mais seulement des lois inhumaines ».
La plèbe et les zotres
Seconde partie de cet article : le lundi 4 octobre.
[1] 15 & 16/10/99 http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_europ%C3%A9en_de_Tampere
[2] S’identifiant parfois comme réseaux No Border locaux
[4] Les politiques anti-migratoires comme l’exploitation – des sans papiers et de nombreux autres individus – étant le fruit d’un fonctionnement « social » basé avant toute chose sur la recherche du profit et l’enrichissement de quelques-uns au détriment du plus grand nombre, c’est ce « système » ploutocratique, de plus en plus oligarchique, et donc bien peu démocratique que nous rejetons.
[5] Ca peut sembler curieux puisqu’aucune frontière n’y est physiquement présente. Mais la ville est un symbole des politiques européennes anti-migratoires. Elle accueille de nombreux sommets et institutions européennes définissant ces politiques et organisant leur mise en œuvre. Elle héberge en outre plusieurs institutions appliquant les politiques belges anti-migratoires. La Belgique exerce la présidence du Conseil européen pour le second semestre de cette année 2010, ce qui la rend responsable à nos yeux des politiques européennes. Enfin, Bruxelles a été le lieu de nombreuses luttes de migrants et de leurs soutiens, prenant des formes diverses, de l’occupation de bâtiments par des sans papiers à la lutte contre le nouveau centre fermé construit en périphérie de la ville, voir à ce propos http://www.rtbf.be/info/belgique/politique/debut-du-chantier-du-nouveau-centre-ferme-a-steenokkerzeel
[6] Autorités publiques, entreprises, institutions…
[8] Ou encore de « vrais » ou de « faux » réfugiés
Cet article en deux parties est un texte collectif, rassemblant les expériences et les opinions de divers militants actifs dans les réseaux No Border. Ainsi, nous tenterons de présenter l’histoire des camps No Border tout en expliquant comment les réseaux No Border sont confrontés aux questions de légalité et d’illégalité. Sur base de ces expériences partagées, nous proposons, simplement, de renoncer au questionnement quant à la légalité ou à l’illégalité, afin d’offrir une autre lecture du monde qui nous entoure. Nous revendiquons la légitimité de nos actions, qui seule, à nos yeux, peut les conditionner.
La première partie de cet article est consultable ici
Parce que nous ne nous laisserons ni enfermer, ni utiliser. Parce que dormir ne ferait que prolonger le cauchemar dans lequel ils aimeraient nous faire jouer
La seconde manière dont les réseaux No Border sont confrontés aux questions de légalité et d’illégalité est plus complexe, quoique assez générale dans le militantisme, et concerne la manière et les conditions dans lesquelles des actions sont menées. Selon certains critères [1], le contexte [2] mais aussi une bonne dose d’arbitraire [3], les autorités catégoriseront certaines actions comme légales et d’autres comme illégales et poursuivront ou non les participants à des actions illégales. Le questionnement sur nos modes d’action et leur positionnement quant à « la légalité » aboutit souvent à de longues discussions durant les assemblées des camps No Border, par exemple lors de collaborations avec des organisations humanitaires importantes. Il est important d’analyser les raisons qui sous-tendent à ces questionnements afin d’y apporter des réponses.
En réprimant certaines actions autour des camps No Border, et en poursuivant des activistes, les autorités envisagent surtout la question de la légalité ou de l’illégalité comme une distinction entre les manifestations autorisées et les manifestations non autorisées. Nous ne pouvons bien sûr conditionner nos actions à l’obtention du label « autorisé/légal » décerné par l’Etat lui-même, selon ses intérêts et ceux qu’il défend, alors qu’il est lui-même la cible de notre contestation et notre opposant principal dans la lutte pour la liberté de circulation ! Nous revendiquons une légitimité supérieure, comme dans toute action de désobéissance, nous permettant de sortir des espaces – à la fois de plus en plus limités et contrôlés, pour ne pas dire neutralisés [4] – de la contestation légale. Nier cette légitimité revient par ailleurs à renier toute forme de désobéissance civile et à abandonner la majorité des modes d’actions [5].
« On critique souvent la violence du fleuve, mais jamais celle des berges qui l’enserrent. » B. Brecht
On peut également arguer le manque de réciprocité, le manque « d’universalité » dans l’application de la loi. Si les autorités utilisent systématiquement des législations de plus en plus répressives contre leurs opposants, il en est rarement de même quand il s’agit des infractions commises par ses agents dans la répression de cette opposition. L’égalité devant la loi est donc un leurre [6]. Ainsi, lors de nombreuses manifestations ou actions [7], les services de police font preuve d’une violence totalement disproportionnée face aux manifestants. On se souviendra de la répression liée aux sommets de Seattle (1999), de Gènes (2001), de Vichy (2008) ou encore de Strasbourg (anti-NATO, 2009) : de nombreux manifestants blessés, plusieurs traduits devant les tribunaux pour jet de pierre, rébellion etc., mais peu ou pas de policiers poursuivis malgré les très nombreux manifestants blessés [8], et les nombreuses images de provocations et de violences policières « gratuites » [9].
A plusieurs reprises, l’Etat belge lui-même, via ses administrations, a délibérément contourné ou carrément piétiné la loi ou les conventions internationales pour privilégier l’application de ses politiques anti-migratoires. Les exemples ne manquent pas : violations régulières des droits humains lors des arrestations, détentions et expulsions de migrants [10], utilisation de subterfuges fallacieux [11] pour l’arrestation de migrants, expulsions ou tentatives d’expulsions réalisées en urgence le week-end alors qu’une audience dans un tribunal est prévue pour le lundi, détention d’enfants et « accueil » des mineurs non accompagnés [12], condamnation de l’Etat belge par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir violé le droit humanitaire en expulsant par un vol collectif 70 Roms Tsiganes de Gand (arrêt Conka [13]) etc.
A Calais, la police française attaque un lieu considéré comme sûr pour les migrants, les battant, aspergeant de gaz au poivre, détruisant ou jetant leurs quelques biens, sans pour autant disposer du moindre mandat de perquisition (hangar de Kronstadt). Les politiques anti-migratoires grecques enfreignent clairement les politiques européennes en matière de migration et la police grecque est extrêmement violente avec les migrants [14].
Parce qu’isoler du contexte, c’est déjà mentir
Les Etats eux-mêmes méprisent donc la loi quand cela leur semble utile Dans la pratique, à de rares exceptions près, la loi ne s’applique qu’aux activistes et individus luttant contre le système et non aux Etats eux-mêmes, au système capitaliste ou aux entreprises. Dès lors, pourquoi devrions-nous nous sentir moralement obligés de la respecter ? Les autorités postulent souvent que les actions « illégales » sont par essence « antidémocratiques ». Ces mêmes autorités ne se jugent pourtant pas antidémocratiques et ne sont pas jugées comme telles par leurs pairs. Les autorités françaises ne considèrent leurs actions ni comme illégales, ni comme antidémocratiques. Les Grecs et les Belges non plus.
A fortiori, « légal » ne signifie pas forcément « démocratique ». Nous pourrions citer en exemple le régime nazi, qui s’est développé de manière parfaitement légale, ou se référer aux partis racistes récoltant des victoires électorales pour démontrer que légal ne signifie pas démocratique. Comme Jan Blommaert [15] le faisait remarquer dans un essai, le concept de démocratie a été réduit à un nombre de règles (légalité), oubliant le contenu même de la démocratie. Cela permet que des actes non démocratiques soient considérés comme démocratiques par leur respect de certaines règles. De même, des actes illégaux mais démocratiques peuvent alors être taxés d’antidémocratiques.
Pour les raisons développées précédemment, nous ne conditionnons donc pas nos actions à leur caractère légal ou illégal. Nous tenons à préciser que ce questionnement est différent de celui concernant le caractère violent ou non d’une action, puisque même des actions strictement non violentes peuvent être déclarées illégales par l’Etat et que la définition morale de la violence est extrêmement subjective [16]. A Copenhague, des organisateurs d’actions non violentes ont été arrêtés pour avoir été soupçonnés d’organiser des actions illégales. Une politique stricte de non-violence n’assurera jamais que nos actions ne soient déclarées illégales. En outre, nous considérons que prendre en compte le caractère légal ou non d’une action est jouer le jeu de l’Etat. L’Etat définit ce qui est légal ou illégal pour une certaine raison : le fait qu’une approche plus ferme de la gestion de la contestation soit simultanée à une crise mondiale du capitalisme et de l’impérialisme n’est pas une coïncidence. Depuis le 11 septembre, même le fait d’être musulman et opposé à l’impérialisme américain peut être prétexte d’incarcération, parfois de déportation dans un pays tiers où la torture est « légale » [17]. Depuis la crise grecque, les polices surveillent de près les activistes masqués lors des actions, craignant des actions similaires à celles qui se sont produites sur place, actions remettant l’Etat en cause et tentant de le faire chuter. Nous refusons de jouer le rôle qui nous serait imposé dans ce théâtre politique si nous accordions trop d’importance dans nos choix à la légalité. Nous refusons ces polémiques parce que les maintenir au centre de nos discussions amène à affaiblir la résistance contre les politiques et les lois inhumaines, créant des divisions entre activistes ayant les mêmes buts mais des voies différentes pour les atteindre. Le caractère légal ou non d’une action n’est qu’un paramètre de l’évaluation des risques, même s’il implique une prise de conscience des risques et des précautions à prendre.
"Là où il n’y a le choix qu’entre lâcheté et violence, je conseillerai la violence" Gandhi
Un des principes des camps No Border est la diversité des tactiques mais la solidarité de tous contre la répression. La diversité de tactiques réfère à un concept dans lequel des activistes de différentes origines et expériences travaillent ensemble pour atteindre un but commun, mais laissant aux uns et aux autres le choix de leurs modes d’action pour y parvenir. L’appel à la diversité des tactiques est souvent lancé par des groupes désirant concentrer leur énergie sur l’attaque de symboles du capitalisme, tels que des banques, des agences d’intérim, des McDonalds…revendiquant leur espace dans le champ d’action. Ils opposent cette diversité de tactiques à la politique du « pas de dégâts - pas de résistance active ». » prônée par certains acteurs de la contestation [18]. Le principe de la « diversité des tactiques » s’est fait connaître au plus grand nombre des activistes quand il a été communément utilisé pour décrire la convergence des actions lors de « la bataille de Seattle » [19]. La diversité des tactiques a obtenu le plus de résultats quand elle était soutenue par un haut degré de solidarité et de compréhension entre les différents groupes participant. Comprendre que, bien qu’en développant des modes d’action différents, il est possible de travailler ensemble dans le même but, génère une dynamique dans de nombreuses campagnes et permet de couvrir l’entièreté du champ d’action, une action renforçant l’autre.
Mais la diversité des tactiques engendre également une grande responsabilité chez les activistes la partageant. Les activistes doivent toujours avoir conscience des risques qu’ils courent ou non ou pourraient faire courir à d’autres, et comprendre les diverses implications des actions proposées afin de choisir auxquelles participer. Se montrer solidaires face à la répression contre des actions auxquelles ils décident de ne pas participer pour des raisons qui leurs sont propres. Respecter l’ensemble des militants : l’ « utilisation » d’une grande manifestation annoncée et légale par un groupe d’activistes « jeteurs de pierres » peut manquer de respect voir même être traumatisante pour des participants s’attendant à une manifestation autorisée et calme.
Lors du No Border Camp, nous soutiendrons toutes les actions menées en respect des principes du No Border Camp si ces actions sont menées contre les politiques anti-migratoires européennes ou belges, au sens le plus large. En contrepartie, nous attendons de tous les participants qu’ils utilisent leur mode d’action préféré avec respect pour les autres et leurs tactiques propres et qu’ils prennent la responsabilité de faire de ce camp un succès.
Ce qui conditionne nos actions est leur légitimité, une fois considérées dans leur contexte. C’est cette légitimité qui nous soude, elle qui associée au respect de chacun génère cette solidarité qui nous renforce. Nos actions ne seront jamais antidémocratiques au sens réel du terme, tout au contraire. Nos actions, notre « désobéissance » collective, qu’elle soit anonyme ou non, sont guidées par la volonté d’avancer vers un monde plus juste et plus solidaire. Et sans vouloir faire de (très) mauvais jeux de mots, au camp No Border, « chacun y apporte sa pierre »…
La plèbe et les zotres
[1] Notamment, mais pas uniquement, les lois, arrêtés, décrets, dispositions et règlements
[2] Ainsi des manifestations seront autorisées ou non en fonction de la concomitance de sommets européens, célébrations, matchs de foot, visite d’un chef d’état, autres manifestations programmées…
[3] Tels que l’image que se font les autorités d’un groupe ou d’une association, leurs difficultés à appréhender une organisation dépourvue de hiérarchie ou de leaders, les opinions personnelles de l’un ou l’autre haut fonctionnaire ou politique…
[4] Voir les trajets imposés pour les manifestations autorisées de Strasbourg en avril 2009 (anti-NATO) ou lors du camp No Border de Calais (2009), dans des zones industrielles dépeuplées, ou « l’espace d’expression libre », carré cerné de barbelés ou les bombspotters furent invités à crier leurs slogans…dans le calme lors du « NATO Game over ». Des « espaces de libre expression » furent également imposés lors de manifestations face à l’ambassade américaine de Bruxelles. On pourrait également citer le « fichage ou fouille préliminaires » rendus obligatoires avant la participation à certaines manifestations telles que le Festival des Résistances à Steenokerzeel (02/2003).
[5] Affichage massif, occupations, blocages, sabotages etc qui représentent d’ailleurs l’écrasante majorité des actions réalisées par de « grands acteurs de la scène contestataire » comme Greenpeace, Vredesactie (Bomspotting), les faucheurs volontaires etc
[6] Sans aborder ici l’influence de l’origine socio-culturelle sur la fréquence et la durée des condamnations
[7] Le cas est pour ainsi dire général à toutes les manifestations subissant une répression policière : il y a d’ailleurs toujours bien plus de blessés du côté des manifestants que des forces de l’ordre, qui disposent maintenant d’un véritable arsenal « non-léthal » (en réalité « à léthalité réduite » : Taser, flashballs, matraques de types divers, gaz CS, gaz au poivre, grenades au gaz, assourdissante ou aveuglantes, autopompes, cavalerie etc) et de tenues « robocop » protégeant de la majorité des projectiles.
[8] Et la mort de Carlo Giuliani à Gênes
[9] Notamment à Strasbourg, les vidéos de policiers jetant des pierres sur des manifestants pacifiques : http://dailymotion.virgilio.it/video/x8wyq0_strasbourg-manif-anti-otan-la-polic_news ; http://dailymotion.virgilio.it/video/x8vw7c_manif-strasbourg-les-crs-caillassen_news
[10] Si la mort de Semira Adamu a défrayé la chronique, les cas de menaces, mise au cachot, humiliations, coups voire torture ne sont pas rares, consulter le blog de la CRER, les rapports du Comité de Prévention de la Torture (CPT) , le rapport de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (1999, titré "Les centres fermés : l’arrière-cour de la démocratie" et qui décrit avec précision l’arbitraire administratif et la "torture psychologique" qui y règnent, ainsi que les sévices physiques qui y sont parfois commis), les rapports d’Amnesty International ou encore le site de la Ligue des Droits de l’Homme.
[11] Par exemple une convocation à l’Office des étrangers sous un prétexte mensonger, comme compléter un dossier de demande d’asile, ou encore l’arrestation d’enfants à l’école afin d’attirer leurs parents.
[12] http://www.amnestyinternational.be/doc/article1323.html?decoupe_recherche=terrorist&debut_artR=5
[16] Ainsi de nombreux journalistes verront plus de violence dans le bris d’une vitrine que dans un tabassage de manifestants au sol par des policiers en nombre ou dans un enfermement de plusieurs jours.
[17] Ce qui est bien le comble de ce que décrit Jan Blommaert
[18] Notamment, à quelques exceptions près, les acteurs institutionnels tels que les syndicats
Dans l’Etat d’Oaxaca, au Mexique, la révolte face aux inégalités sociales a commencé en 2006. Le soulèvement a pris un tournant libertaire au travers de projets d’autodétermination locale. Le gouvernement a répondu par la répression, massive et brutale. Depuis le mois de janvier 2010, la commune de San Juan Copala subit un véritable siège paramilitaire. Une caravane d’observateurs des droits humains, venue tenter de briser l’encerclement, a été violemment attaquée par des paramilitaires. Deux personnes sont mortes sous les balles. Nous avons rencontré Davide, qui faisait partie de la caravane. Il témoigne de l’attaque et nous livre ses impressions sur la situation.
La commune de San Juan Copala, localité de la région triqui, dans l’ouest de l’État de l’Oaxaca, au Mexique, subit une violente répression gouvernementale depuis qu’elle a décidé de s’autogérer en créant une "municipalité autonome" en 2007 (Lire l’encart). Harcèlement brutal de la part de la police, des militaires et des groupes paramilitaires, enlèvements, viols, meurtres, tout semble permis pour faire craquer ces peuples en lutte. La répression s’est encore intensifiée en janvier 2010 avec l’instauration d’un véritable siège paramilitaire, toujours en cours : les routes sont bloquées par l’UBISORT, l’un des groupes paramilitaires, les populations privées d’eau potable et d’électricité, personne ne peut entrer ou sortir de la commune - pas même les médecins ni les enseignants... Une situation proprement intolérable.
Des associations - surtout locales - et des observateurs internationaux des droits humains ont décidé d’organiser, en avril 2010, une caravane [1] afin de tenter de briser l’encerclement dans lequel se trouve la communauté autonome. Le 27 avril, la caravane fut violemment attaquée par des paramilitaires au service du gouvernement [2] et n’atteignit jamais Copala. Deux personnes sont mortes sous les balles : Beatriz Alberta Affection Trujillo, membre de CACTUS et Jyri Antero Joakkola (observateur finlandais) [3]. Une attaque vivement dénoncée par les organisations membres de la caravane dont VOCAL [4] et au travers de sites d’information militante, mais passée sous silence dans les grands groupes de presse.
Voici le témoignage de Davide, qui faisait partie de la caravane en tant qu’observateur européen.
JIM : Tu faisais partie de la caravane qui voulait se rendre dans la commune autonome de San Juan Copala : quel était votre objectif ?
Davide : L’objectif était d’abord d’exprimer notre solidarité à ces communautés qui se sont proclamées autonomes et qui, de ce fait, ont subi ces dernières années et subissent encore une forte répression. La commune avait d’abord été fermée par les paramilitaires, puis quand les gens du village ont repris la municipalité pour relancer ce projet d’autonomie, un siège hyper-violent a commencé : on leur a coupé l’eau, l’électricité, on ne les a plus laissé entrer ou sortir, des gens ont été assassinés - on dénombre environ 25 morts à Copala depuis le début de l’année. L’idée était donc de leur exprimer notre solidarité, mais également d’alerter les médias sur leur situation. Mais on ne nous a pas laissé passer.
Comment s’est passée l’attaque ?
Il faut savoir que, déjà avant, le gouvernement mexicain avait déclaré qu’aucune caravane ne pourrait passer et qu’il n’assumerait pas de responsabilité en cas de problème. De notre côté, on s’était dit que nous verrions bien les conditions que les paramilitaires fixeraient pour qu’on passe et qu’en cas de blocage, on ferait demi-tour. Quand nous sommes arrivés, des pierres bloquaient la route. Nous nous sommes arrêtés pour faire marche arrière mais une vingtaine de paramilitaires, embusqués sur les côtés de la route, ont immédiatement commencé à tirer sur nous. Ils nous ont entourés et ont tiré sur la camionnette et les deux voitures de la caravane.
L’attaque était donc préméditée et les paramilitaires ont tiré avec intention de blesser ou de tuer, sans tirs de sommation...
Les premiers tirs visaient la camionnette. C’est ainsi que deux personnes présentes dans la camionnette, Yuri et Bety, ont été touchées par les tirs et sont mortes très rapidement. Moi et les autres, on a sans doute été sauvés par une meilleure position dans les voitures.
Que s’est-il passé après l’attaque ? Vous avez été arrêtés ?
Certains d’entre nous se sont enfuis dans la forêt ou ont tenté de s’enfuir mais se sont fait rattraper et arrêter. Moi par exemple, j’étais déjà assez loin mais les paramilitaires ont attrapé des personnes et les ont obligées à nous appeler. Je suis donc revenu. D’autres se cachaient comme ils le pouvaient dans les voitures. Les chauffeurs essayaient de faire marche arrière. Une voiture est restée sur place et ses occupants ont été arrêtés. Puis, ils nous ont emmenés dans la forêt pour nous interroger, ils nous ont pris le matériel audiovisuel , l’argent - même si ce n’était pas leur vraie préoccupation - et nos papiers. Ils ont gardé les documents des personnes mexicaines et les ont menacées de mort. Au bout d’une demi-heure environ, ils nous ont relâchés.
Une deuxième caravane a été organisée en juin 2010. Amnesty International avait lancé un appel au gouvernement pour qu’une route sécurisée soit garantie, ce que les autorités avaient refusé. Que s’est-il passé ?
Cette deuxième caravane était principalement organisée par des associations locales d’Oaxaca. Il y avait environ 400 personnes. Mais elle n’a pas pu passer non plus. Cette fois, le gouvernement avait mis en place un important dispositif militaire et policier - police de l’état et fédérale - pour, officiellement, protéger la caravane. Sur son parcours, celle-ci a été bloquée plusieurs fois par la police. A un moment, le procureur qui dirigeait les opérations policières s’est entretenu avec le chef des paramilitaires et a proposé quelque chose de ridicule : la caravane pouvait entrer si elle était escortée par les paramilitaires et si le nombre de membres de la caravane ne dépassait pas celui des paramilitaires... Ce n’était pas envisageable et la caravane a poursuivi sa route. Il y a eu de nouveaux contrôles et des tirs de balles. Finalement, elle s’est résolue à faire demi-tour.
Comment s’organisent les gens de ces communautés face à une telle répression ?
Ils ne savent plus vraiment quoi faire. Il y a des personnes qui représentent la communauté autonome à l’extérieur de la commune, y compris à México, la capitale, et qui tentent de faire bouger les choses en dénonçant ce qui se passe. La communication avec les gens qui sont dans la commune est évidemment très difficile mais il y a parfois des contacts par téléphone satellitaire. A l’intérieur, ils n’ont pas vraiment de moyen pour se défendre. Ils sont pris au piège de la répression. Pour eux, lutter avec des armes n’est pas une option : d’une part les paramilitaires sont très nombreux et bien armés, d’autre part ils savent que cela déclencherait une escalade dans la violence dont ils sont victimes... Donc, ils s’organisent surtout pour arriver à sortir de la commune...
Beaucoup de gens alertent les médias mais ici, ceux-ci n’ont pas relayé l’information, seuls les médias militants en ont parlé. Et au Mexique ?
Les médias reprennent la version officielle du gouvernement, à savoir que c’est un problème ethnique entre indigènes. Ils ne parlent pas de l’aspect social et économique du problème ni du projet de communauté autonome ; ils ne disent pas que le gouvernement veut expulser les gens de leurs terres. Pour eux, c’est un conflit entre "communautés indigènes hyper-violentes".
Le classique prétexte sécuritaire pour réprimer les mouvements sociaux !
Exactement. Que ce soit pour le Chiapas ou pour Oaxaca, c’est toujours la même tactique de détournement, ça justifie la présence de troupes et la répression. Mais par rapport aux discours sécuritaires, la réaction des gens n’est pas la même au Mexique et ici [en Europe], où les discours sur la peur de la criminalité marchent très bien. Là, il n’y a pas une peur généralisée de la criminalité, mais de la répression d’Etat. Et puis, les gens savent qu’il y a d’énormes enjeux économiques. Il y a dans la région de Oaxaca de mega projets miniers, d’autoroutes, mais aussi d’"énergie verte" et de "tourisme écologique" [5]. De nombreuses sociétés européennes et surtout américaines ont des intérêts financiers à défendre là-bas [6]. La Banque d’Investissements européenne a investi un milliard d’euros dans un seul projet d’énergie verte à Oaxaca. Pour réaliser ces projets verts, le gouvernement veut expulser des milliers de gens de leurs terres. La répression des communes autonomes est liée à la défense de ces intérêts financiers. Là-bas, c’est encore plus évident qu’ici que le capitalisme vert reste du capitalisme tout court.
Propos recueillis par Christine Oisel
Quelques repères pour mieux comprendre.
[*L’Etat d’Oaxaca*]
L’Etat d’Oaxaca se situe dans le sud du Mexique. Voisin du Chiapas (à l’est), grand comme trois fois la Belgique, il constitue d’un côté l’un des Etats les plus riches du pays pour sa biodiversité [7] et ses ressources naturelles [8], parmi lesquelles son eau, utilisée pour l’hydroélectricité, et son vent, très fort, précieux pour l’énergie éolienne. Il s’agit donc d’une zone très attrayante pour les entreprises. Un vaste plan de "développement" lancé en 2001 prévoit l’implantation d’activités économiques et la création d’infrastructures (routes, ports, barrages...).
De l’autre côté, le niveau de pauvreté dans l’Etat d’Oaxaca figure parmi les plus élevés du pays. Les inégalités sociales se sont fortement creusées ces dernières années. Près de 460 des 570 municipalités de l’Etat ne disposent pas de services de base [9]. Le développement du tourisme dans la région a provoqué une forte augmentation du coût de la vie. Autour de la capitale Oaxaca de Juarez, attraction touristique du Sud du Mexique, s’étendent des quartiers de misère. La plupart des gens travaillent dans l’agriculture et pour les exploitations de richesses naturelles.
La population de l’Etat est pour la moité composée de peuples indigènes (Seize groupes indigènes s’exprimant dans plus de 22 langues et 150 dialectes) : ils représentent 1,6 millions de personnes sur 3,4 millions d’habitants. Ces peuples sont, depuis toujours, victimes de discrimination de la part des élites blanches. Selon le Conseil National à la Politique de Développent Social (Coneval), 75.7 % de la population indigène du Mexique vit "dans un état de pauvreté multidimensionnel" [10] .
C’est dans ce contexte - situation stratégique de la région, inégalités socio-économiques - que la grève des enseignants de 2006 va cristalliser la révolte mais aussi l’espoir d’une grande partie de la population.

[*Chronologie de la création de la commune libre*]
– 22 mai 2006 : Les enseignants installent leur traditionnel "plantón" : depuis des années, ce piquet de grève-rassemblement est installé aux environs du jour des instituteurs (le 15 mai). Environ 70 000 enseignants suivent le mouvement de grève et réclament, entre autres, l’augmentation des salaires au vu, notamment, de la hausse dramatique du coût de la vie dans la région. Le gouverneur Ulises Ruiz Ortiz répond par des menaces et tente de diviser la protestation.
– Juin 2006 : L’attaque violente menée contre les enseignants grévistes par quelque 750 policiers en armes (14/06), au terme de laquelle on dénombrera 200 enseignants blessés ainsi que plusieurs disparitions, provoque la colère de la population qui, jusqu’ici, était restée passive face au mouvement des profs. Des centaines de milliers d’Oaxaqueños descendent dans la rue pour se solidariser avec les revendications sociales des enseignants. Plus de 30 mairies sont occupées. Les habitants, mais aussi des universitaires et des organisations sociales, viennent aider les enseignants qui affrontent avec des pierres et des bâtons les policiers armés. La foule réinstalle le plantón, les instituteurs désavouent le gouverneur et exigent sa démission. Sous l’impulsion des instituteurs, l’Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) est créée le 18 juin et réunit quelque 350 organisations : syndicats, collectifs libertaires, groupes de la gauche marxiste, organisations citoyennes, indigènes, de travailleurs, d’artistes, d’étudiants... L’APPO s’inspire des pratiques autogestionnaires des Zapotèques, des Mixtèques, des Mixes, des Amuzgos et autres peuples aborigènes. Dans les assemblées, chacun nourrit la liste des revendications sociales du mouvement.
– Juin - octobre 2006 : l’APPO organise une douzaine de manifestations auxquelles participent des centaines de milliers de personnes [11]. La population s’empare des administrations et crée des organes de gouvernement autonome.
– Juillet 2006 : Les élections fédérales sont remportées par la coalition « Por el Bien de Todos » [12]. Le parti du gouverneur fédéral est en net recul. Les révoltés d’Oaxaca réclament toujours sa démission et mènent une série d’actions symboliques, comme le boycott de la fête traditionnelle de la Guelaguetza, récupérée politiquement et commercialement [13] et l’organisation d’une fête alternative ou encore le blocage de lieux touristiques et d’hôtels.
– Août 2006 : La répression contre la population et l’APPO est continue. Le 9 août, trois militants sont tués, deux leaders de l’APPO arrêtés et plusieurs instituteurs enlevés. Le 21, les occupants de la télévision officielle sont expulsés par des paramilitaires. Immédiatement, l’APPO investit douze radios commerciales. Le 22 août, un "convoi de la mort" [14] se met en route et tire sur les radios occupées. Des barricades sont dressées pour le bloquer.
– Octobre2006 : Un journaliste d’Indymedia New York, William Bradley Roland, est tué le 27 octobre, au cours d’une manifestation. Le 28 octobre, le gouvernement mexicain lance un ultimatum à l’APPO qui doit retirer les barricades et libérer les bâtiments occupés. L’ultimatum est rejeté. Au nom de l’« état de droit », 4000 militaires et policiers fédéraux sont mobilisés. Les barricades sont détruites par la Policía Federal Preventiva (PFP) [15], les occupants sont repoussés par la force. L’occupation policière d’Oaxaca est mise en place, justifiée par la restauration de l’ordre public.
– Novembre 2006 : La PFP attaque l’université (02/10). Quelque 50.000 personnes résistent à l’assaut policier du campus. Après 7 heures d’affrontements violents, la PFP se retire. On déplore une vingtaine de morts et 120 prisonniers. Le 4 novembre, une lettre ouverte de soutien à la population d’Oaxaca, et à sa lutte pour un gouvernement populaire qui reconnaisse les traditions et les valeurs locales est signée par des intellectuels et des artistes [16]. Les 10, 11 et 12 novembre, un congrès constituant est organisé par l’APPO. Environ 250 organisations de l’Etat d’Oaxaca y participent. Le 19 novembre, une manifestation pacifique de femmes organisée pour dénoncer les viols commis par les policiers est brutalement réprimée. Le 25, une marche longue de 8 kilomètres réclame la libération des prisonniers politiques et le départ de la PFP. Cinq manifestants sont tués, 140 sont blessés et une centaine sont arrêtés. Quatre jours plus tard, la PFP occupe l’université et l’ensemble de la ville (29/11). Le lendemain, le gouverneur Ruiz Ortiz annonce que les étrangers prenant part au mouvement seront arrêtés.
De novembre à décembre, une vague d’arrestations est lancée, notamment au sein de représentants de l’APPO.
– Janvier - juin 2007 : La répression, les nombreuses arrestations conduisent à un essoufflement du mouvement et, surtout, à une division entre les différentes organisations au sein de l’APPO. Si bien que le 2 juin 2007, la 2ème assemblée étatique de l’APPO avoue une crise de fonctionnement "en raison d’une diversité d’idéologies".
– Juin - novembre 2007 : Cela n’empêche pas 100 000 personnes de redescendre dans la rue pour commémorer le 1ier anniversaire de la répression du mouvement des enseignants et exiger, encore et toujours, la démission d’Ulises Ruiz Ortiz et la libération des prisonniers (14/06). Le 18, les enseignants reprennent leur plantón. L’APPO exhorte la Cour Suprême de Justice à enquêter sur les violations des droits de l’homme dans l’Etat de Oaxaca. Le ministre Juan Silva Meza suggère que la Cour Suprême de Justice enquête sur les violations des droits de l’homme à Oaxaca (12/06). La « Guelaguetza commercial » est à nouveau boycottée (16/07). Les manifestations continuent et la répression ne faiblit pas. Les manifestants dressent à nouveau des barricades contre les "convois de la mort" [17]. Des associations mexicaines des Droits de l’Homme [18] tentent d’assurer une médiation entre l’APPO et les instances de l’État.
– Le 2 novembre 2007 : La première célébration de la victoire de todos los santos (toussaint) de novembre 2006 a lieu, malgré la répression de la PFP qui ne cessera pas.

[*La lutte continue*]
Depuis l’attaque de la caravane en avril 2010, puis l’échec de la suivante en juin, le blocus et la répression se poursuivent. En témoigne ce communiqué de la Commune autonome de San Juan Copala datant du 23 août dernier, au sujet d’une "nouvelle embuscade meurtrière contre la Commune autonome de San Juan Copala" au cours de laquelle trois personnes ont été tuées et deux autres blessées. Malgré la violence, malgré l’isolement, malgré la peur, la population assiégée continue la lutte : "Nous disons clairement que nous ne nous tairons pas, et nous lançons de nouveau à tous les compañeros de la lutte sociale au Mexique et dans le monde un appel à se solidariser avec les communautés de San Juan Copala [...]".
Quelques jours avant ce communiqué, les femmes de la commune libre de San Juan Copala signaient un manifeste dans lequel elles réaffirmaient leur détermination à résister : "Aujourd’hui, nous voulons dire aussi à ces messieurs de l’Argent que nous nous rebellons, que nous nous soulevons et que nous les accusons avec colère. Que le monde sache que, dans ce pays, nous, les peuples indiens, sommes en résistance : le mauvais gouvernement, obéissant aux ordres du grand capital, a décidé d’anéantir nos peuples pour s’approprier la grande richesse naturelle, que, pendant des siècles, nous avons su conserver pour le bien de l’humanité ; c’est là, le véritable motif de la violence qu’aujourd’hui nous subissons, nous, les Triqui [...]" [19].
Il apparait dans ces déclarations, mais également au travers de nombreux témoignages de personnes présentes aux manifestations, que la contestation dépasse de loin la seule "question indigène". Certes, ces peuples luttent et doivent continuer à lutter et à résister pour qu’on les respecte, que l’on cesse de les exploiter et de leur prendre leurs terres. Le soulèvement à Oaxaca s’inscrit dans ce mouvement, mais propose également une alternative constructive au système capitaliste. Cette convergence des luttes est nécessaire pour donner une épaisseur et une cohérence au mouvement. La solidarité internationale l’est tout autant, face à un capitalisme mondialisé imposant les mêmes règles à tous.
Leur combat est notre combat. ¡Ya basta !
C.O.
[*Sources :*]
Cet encart n’a d’autre prétention que d’introduire le sujet. A lire, pour en savoir plus :
– Les différents articles parus sur Oaxaca dans le mensuel CQFD : http://www.cequilfautdetruire.org/spip.php?page=recherche&recherche=Oaxaca
– Les différents articles et communiqués parus sur CeMAB.Be : http://cemab.be/news/?comments=yes&keyword=Oaxaca&medium=
– Emission de radio Panik sur San Juan Copala et Oaxaca : http://www.radiopanik.org/spip/Autonomie-et-repression-au-Mexique
– "Autonomie indigène à Oaxaca.", Reportage de Pedro Matias, "Proceso" (journal mexicain), 19 janvier 1997 : http://www.zapata.com/brochures/labas-ici/autonomie.html
– Article "Commune libre de Oaxaca" sur anarchopedia.org : http://fra.anarchopedia.org/Commune_libre_de_Oaxaca (Attention, cet article est pointé comme enfreignant possiblement un copyright).
– Article "La commune autonome de San Juan Copala (Oaxaca)", Francisco Lopez Barcenas, "La Jornada", 10 janvier 2007 : http://www.narconews.com/Issue44/article_fr2499.html
L’interview de Davide date du mois de juin 2010. A l’heure où cet article est publié, nous apprenons que la communauté de San Juan Copala a purement et simplement été détruite par les paramilitaires. Ce triste dénouement a eu lieu entre le 13 septembre (prise de Copala par les paramilitaires qui ont tiré sur la population) et le 23 septembre (fuite des survivants, certains dans des corbillards...).
Lire à ce propos :
– La destruction de Copala
– San Juan Copala : bulletin urgent de la Commune autonome
[1] Dans la caravane se trouvaient des membres de l’Assemblée Populaire des Peuples de Oaxaca (APPO), de la Section 22 du magistère (syndicat des enseignants), de Voces Oaxaqueñas Construyendo la Autonomía y la Libertad (VOCAL), de CACTUS (Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos), des membres du MULTI (le Mouvement d’Unification et de Lutte Triqui - Indépendant), ainsi que des observateurs internationaux.
[2] Les paramilitaires déclareront aux membres de la caravane qu’ils agissent sous la protection du gouverneur Ulises Ruiz Ortiz (URO)
[3] Plus d’information sur ces deux militants : http://www.cemab.be/news/2010/05/9277.php
[4] Voir leur communiqué, traduit en français : http://oclibertaire.free.fr/spip.php?article749
[5] NDLR Voir par exemple cette offre de tourisme équitable : http://www.clubaventure.com/renseignements/oame.pdf
[6] NDLR EDF, pour prendre un exemple. Le [rapport d’activités 2006 "L’énergie du XXIe siècle" fait état de projets éoliens et hydrauliques dans la région d’Oaxaca (pp.21 et 22). Plus loin, le chapitre "Responsables par nature" est introduit ainsi : "Quand une activité est liée à l’environnement, elle doit rimer avec responsabilité. Responsabilité citoyenne vis-à-vis de la Collectivité, comme responsabilité d’entreprise vis-à-vis des différentes parties prenantes. Les acteurs de l’entreprise partagent tous un même engagement : le respect de valeurs et de bonnes pratiques, ainsi que le respect des territoires et des citoyens". Bien sûr, nulle part dans les pages suivantes, il n’est fait mention des populations d’Oaxaca qui luttent pour garder leurs terres.
[7] Forêts, côtes, lagunes, montagnes, plantes rares, divers types de maïs.
[8] Pétrole, uranium, charbon, fer, or, argent, plomb, mercure
[9] Eau, assainissement, électricité, routes
[10] Lire à ce propos : "Mexique : La communauté indigène reste vulnérable", Actu Latino, 11/08/2010 : http://www.actulatino.com/2010/08/11/mexique-la-communaute-indigene-reste-vulnerable/
[11] Le 3 octobre, une "mega-marche" de 500 km atteint Mexico.
[12] Pour le bien de tous
[13] Les deux lundis qui suivent le 16 juillet, les représentants des sept régions de l’état célèbrent, dans la capitale de l’état, la "Guelaguetza del Lunes del Cerro" (lundi de la Colline). Il s’agit d’une fête oaxacane dont le nom signifie "cadeau, offre, échange ou participation" en langue zapotèque. Cette fête exprime, au travers de signes et de codes, la tradition préhispanique : musique, danses, récolte et produits alimentaires de chaque région... Pour plus d’informations, lire : http://www.revemexicain.com/oaxaca_culture.php/
[14] C’est ainsi que la population nomme ces convois de camionnettes de la police judiciaire de l’Oaxaca, dont on a retiré les plaques d’immatriculation et qui circulent de nuit, en ouvrant systématiquement le feu contre les passants
[15] Police Fédérale Préventive
[16] Comme Noam Chomsky, Naomi Klein, Michael Moore ou encore Howard Zinn. Lire cette lettre (en anglais) : http://www.greenleft.org.au/node/36532
[17] Les barricades portent les noms des personnes tuées en 2006
[18] Comme la Ligue mexicaine pour la Défense des Droits de l’Homme (LIMEDH) ou la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH)
[19] 18/08/2010 : http://www.larevuedesressources.org/spip.php?article1728
Cet article a été rédigé par un groupe de personnes à l’initiative d’une manifestation de solidarité avec le peuple grec. Organisée en Belgique, elle s’est tenue au mois de juin. Objectif de l’article : déconstruire les mythes de la crise grecque ayant abouti à un plan d’économies drastique.
Mythe n° 1 : La crise de la dette grecque a éclaté à cause du secteur public pléthorique
La crise de la dette grecque est souvent attribuée à son secteur public qualifié de “pléthorique”. Mais le taux de dépenses publiques en pourcentage du PNB place la Grèce en dessous de la moyenne de la zone euro, les chiffres correspondants de l’Allemagne et de la Belgique étant beaucoup plus élevés [1]. Entre 2002 et 2006, les dépenses publiques ont chuté, et n’ont augmenté que lors de la période de récession globale. Et en grande partie "grâce" aux sauvetages des banques.
Durant la crise, une grande partie de la presse financière a également accusé le taux de dépenses "excessif" consacré aux salaires des fonctionnaires, par rapport au Produit National Brut. Dans la zone euro, le rapport PNB / traitement des fonctionnaires a diminué de 11% en 1995 à 10% en 2008. En Grèce, il a grimpé de 10% à un peu plus de 11%. Il est évident qu’une augmentation si faible ne saurait justifier le déficit existant.
Les dépenses publiques irrationnelles pour les armements ont toujours existé, et pour cette raison elles ne peuvent pas être tenues responsables de la crise du déficit public ; toutefois, elles constituent un facteur aggravant pour les finances du pays. En particulier, certains politiciens allemands, qui se plaignent de "l’excès de solidarité envers la Grèce", font semblant d’oublier que leur propre pays est dépendants des dépenses militaires grecques pour faire (sur-)vivre leurs industries militaires.
L’origine principale du déficit actuel ne se trouve pas dans l’excès de dépenses, mais plutôt dans l’incapacité de l’Etat à générer des revenus fiscaux [2]. La réduction des taux d’impôt appliqués aux entreprises de même que l’évasion fiscale des grandes compagnies et des grandes fortunes ont amené le déficit grec à son record actuel : on estime que 8.000 personnes et entreprises, ayant commis des fraudes fiscales avérées doivent encore €20 milliards à l’Etat grec. Ce montant équivaut au double du montant du déficit que la Grèce a dû refinancer le 19 mai.
Les faiblesses structurelles de l’économie grecque l’ont transformée en proie pour les spéculateurs. Mais à qui est responsable de ces faiblesses ? Les régimes d’austérité se pérennisent depuis ces dernières décennies. Ils sont également liés à l’agenda européen de libéralisation ainsi qu’à l’entrée du pays dans la zone euro. Ils ont conduit à une croissance économique de court terme, plutôt qu’à un développement réel. Cette "croissance" a été fondée sur des secteurs sans perspective à long terme, comme le transport de commodités et la vente de biens publics, le tout au profit d’une petite élite grecque. L’opacité des rapports présentés par le gouvernement grec y a aussi contribué. Mais le gouvernement grec n’est pas le seul coupable dans l’affaire : il a eu pour complices des banques mondiales comme Goldman Sachs, recrutée comme consultante par le gouvernement grec. Ladite banque fait à présent l’objet de poursuites judiciaires aux Etats-Unis.
Eurostat, le bureau de statistiques et de prévisions européen, s’est montré quant à lui assez inefficace dans son évaluation des données fournies par la Grèce. Les autres gouvernements de l’Union Européenne ont quant à eux préféré ignorer les preuves de falsification ; ouvrir ce dossier avant qu’il ne soit trop tard pour éviter la catastrophe ne servait pas leurs intérêts.
La crise du déficit grec a atteint son pic au moment ou les spéculateurs ont choisi la Grèce comme cible intermédiaire pour s’attaquer a l’euro. La spéculation financière a fait exploser le coût du crédit et a rendu le coût de refinancement du déficit insoutenable. En effet, la taille absolue de la dette grecque est limitée (comparée, par exemple, à celle de l’Italie), ce qui la rend facile à manipuler. De plus, le choix de la Grèce en tant que cible pour cette attaque était juste une question de conjoncture. Les bons grecs allaient expirer avant ceux du Portugal. Il faut également noter qu’on trouve parmi les spéculateurs des grandes banques françaises et allemandes, détentrices de la plus grande partie de la dette grecque. Deutsche Bank a constamment publié des scénarios catastrophiques concernant la situation de l’économie grecque depuis le début de l’année et a fait du lobbying pour continuer la spéculation à travers les Credit Default Swaps [3]. Plusieurs Etats de l’UE ont fermé les yeux devant cette spéculation, qui pourrait bien avoir servi les intérêts de leurs grands exportateurs. Pour l’Allemagne, comme pour tous les pays de la zone euro, le coût du crédit a diminué suite a la crise de la dette grecque. L’euro, affaibli, a pour sa part poussé à la hausse les exportations allemandes, donnant ainsi à l’économie allemande une porte de sortie de la pire récession qu’elle ait connue ces 40 dernières années. Le Premier Ministre italien Silvio Berlusconi a récemment déclaré qu’il ne s’inquiète pas de la chute de l’euro car "c’est bien pour les exportations italiennes". Le Ministre français des Finances a affirmé que l’Etat français tirera profit de la dette grecque [4]. Cela ne ressemble pas à un grand défilé de solidarité à l’égard un pays de la zone euro qui s’est trouvé dans la tourmente.
Mythe n° 2 : Les Grecs ont fait la fête, ont vécu au-dessus de leurs moyens, ont menti sur leurs chiffres, et maintenant ils demandent à d’autres nations européennes de les faire sortir de la misère
Selon l’Organisation de Coopération et Développement Economiques (OCDE), le travailleur grec moyen travaille 2.120 heures par an. Si ce n’est la Corée du Sud, le pays arrive en tête des pays membres de l’OCDE. Un travailleur allemand preste... 690 heures de moins.
Les salaires moyens en Grèce atteignent 73% de la moyenne de la zone euro. Les Grecs sont aussi avant-derniers du pouvoir d’achat parmi les pays de l’UE. Le revenu net moyen est de €12.800 par an. Selon Eurostat, 60% des retraités grecs reçoivent moins de 600 euros par mois, alors que le coût de la vie est comparable à celui de la Belgique. L’âge de départ à la retraite est déjà fixé à 65 ans pour la plupart des travailleurs, quoi qu’en disent les campagnes de la désinformation.
Est-ce que les ménages grecs dépensent plus que ce qu’ils gagnent ? Des données statistiques montrent que les ménages allemands sont plus endettés que les grecs, tandis que la consommation privée par habitant en Grèce est toujours plus basse que la moyenne européenne (pdf).
Le peuple grec n’est pas une masse homogène. La société grecque est une des sociétés les plus inégales de la zone euro [5]. Si on admet que les Grecs ont fait la fête, ce n’est que "l’élite" et une part de la classe moyenne supérieure qui y ont participé. Il s’agit de gens avec un compte suisse, une villa au littoral et une Porsche Cayenne.
Mythe n° 3 : Le prêt FMI-UE aide le pays et son peuple
Tout d’abord, le programme FMI/UE (notamment sa partie ‘UE’) ne ressemble en rien à une “aide” ou encore à un “sauvetage”, comme l’ont proclamé, entre autres, le Fonds Monétaire International et l’UE . Il s’agit d’une série de prêts au taux standard du FMI, assortis de conditions draconiennes. Quant a la partie ‘UE’ du prêt, elle a été accordée à un taux d’intérêt extraordinairement élevé, de 5-6%, alors la croissance du Produit Intérieur Brut du pays est de moins de 4% par an. Il est évident que la dette va se pérenniser. Dans 3 ans, quand les prêts auront expiré, la Grèce se retrouvera avec une dette encore plus importante que l’actuelle.
Deuxièmement, ce prêt n’a pas été offert pour aider ‘le peuple grec’. Il a été accordé pour garantir aux banquiers français, allemands et grecs qu’ils ne vont pas perdre "leur argent", pour que l’euro soit sauvé et pour s’assurer que la crise ne va pas se propager à d’autres économies. Le FMI en atteste clairement.
L’impact du "plan de sauvetage" FMI/ UE sur le peuple grec est le suivant :
– Le pécule de vacances et de congés (qualifiés de "13e et 14e salaire") a été aboli pour les salariés du secteur public et les retraités du secteur public et du privé.
– Tous les salaires sont désormais gelés tandis que la TVA augmente de 4%.
– Le salaire minimum pour les nouveaux entrants au marché du travail est réduit de 700 Euros à environ 500 Euros
– Les seuils de licenciements collectifs passent de 2% à 5% et le montant du remboursement correspondant pour de tels licenciements est réduit de 50%.
– Les conventions collectives de travail peuvent dorénavant être enfreintes si l’employeur le considère "indispensable".
– Un grand nombre de services publics, chemins de fer et service des eaus compris, vont être privatisés.
– Les budget de la santé et de l’enseignement sont réduits.
– L’âge de départ à la retraite pour les femmes augmente de 60 à 65 ans sous prétexte de l’égalité des sexes.
Des économistes estiment que ces mesures auront pour effet de faire baisser les standards de vie de 25%. Des mesures additionnelles sont attendues, comme des réductions explicites et nominales de salaires également dans le secteur privé, et l’introduction d’une retraite minimale de €360.
Mythe n° 4 : Les autres Etats Membres ne courent pas de risques similaires
Des plans d’austérité ont déjà été imposés dans d’autres pays européenne : l’Italie (plafond de salaires et gel de recrutement dans le secteur public, réduction des budgets des autorités locales), la Grande Bretagne (500.000 postes vont être réprimées dans le secteur public), l’Espagne et le Portugal (réductions de salaire pour les employés du secteur public).
Herman Van Rompuy, le Président du Conseil Européen a déclaré que la zone euro a failli s’écrouler, mais qu’elle a finalement été sauvée par la décision de la France et de l’Allemagne d’imposer des plans d’austérité et de libéraliser le marché du travail. Cette décision a pour résultat une dégradation massive des standards de vie partout en Europe.
La dette belge augmente de €45 millions par jour. Le mot "austérité" était tabou lors de la campagne électorale. Et pourtant, dans l’histoire très récente (1993 et le Plan Globla), des crises de déficit ont été tranchées par une hausse générale de la TVA. Les Belges devraient être vigilants afin d’empêcher la vague antisociale paneuropéenne qui va frapper ce pays et se préparer à défendre leurs standards de vie.
Mythe n° 5 : Les manifestants grecs sont des extrémistes
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pacifiquement deux fois par mois depuis le mois d’avril et des millions ont fait la grève. Les feux des médias se sont toujours concentrés sur les incidents violents et isolés, ils ont ignoré les attaques injustifiées de la police contre les manifestants paisibles. Il faudrait pourtant comprendre qu’il s’agit d’une lutte pour la dignité du peuple grec. Se battre contre ces mesures est le seul moyen d’assurer un avenir. La dette a été générée par les élites. Pourquoi les travailleurs et citoyens grecs devraient-ils payer pour cela ? Le niveau de vie des Grecs ne devrait pas une nouvelle fois être sacrifié à l’appétit des banques. La dette de la plupart des états membres de l’UE devra tôt ou tard être restructurée, parce qu’elle n’est pas viable. La question qui se pose tient aux conditions de cette restructuration. Va-t-on encore une fois placer en priorité le salut des banques privées par le recours à l’argent public ou préférera-t-on défendre les droits sociaux et le bien-être des européens ?
Initiative de solidarité à la Grèce qui résiste - http://solidarity-greece.blogspot.com
[1] Voir page159
[2] ETUI : Open letter to European policymakers : The Greek crisis is a European crisis and needs European solutions
[5] TARKI EUROPEAN SOCIAL REPORT – Income distribution in European countries : first reflections on the basis of EU-SILC 2005
Solidarité. C’est l’un des principes inscrits dans la charte de notre journal. Au fil de nos articles, les lecteurs auront compris que, si nous ne pouvons pas seuls changer le monde, nous prétendons contribuer à sa meilleure compréhension, en mettant à disposition de chacun-e les informations nécessaires à un positionnement, et à une action solidaire.
Mais il faut bien le dire : jusqu’ici, les articles du JIM ont souvent traité de sujets qui nous sont, peu ou prou, familiers ou proches [1]. Est-ce que la solidarité a des frontières ?
Bien sûr que non.
Notre journal s’inscrit naturellement dans le contexte militant d’aujourd’hui. Les luttes sont multiples, les engagements limités. Beaucoup [2] invoquent un changement radical des implications : moins de grandes idéologies, plus d’actions concrètes ; moins de mobilisations de masse, plus de démarches individuelles et de proximité.
Mais ce fameux « think global, act local » [3], comment le comprendre ? Est-ce qu’il est juste une invitation à faire pousser ses salades bio ? Nous pensons que non ; nous sommes convaincu-e-s que la solidarité pour celles et ceux qui luttent pour l’égalité et la liberté [4] vaut pour toutes et tous, et qu’elle est toujours possible. Regardons les nouvelles formes de lutte « transnationale » : des militants de tous pays peuvent se rejoindre pour manifester contre un sommet de la finance mondiale. Les Forums mondiaux avaient inauguré de façon éclatante ces nouvelles manières de se rassembler pour militer. Récupérés d’avance, ces mouvements dits « altermondialistes » ? Réservés à une élite ? Il fut un temps, pas si éloigné, où les militants s’engageaient dans les brigades internationales ; dans les années ’70, d’autres rejoignaient les groupes de lutte armée de par le monde.
Dans le contexte actuel, manifester sa solidarité et sa résistance prend des formes multiples, qui ne reconnaissent que la légitimité de l’action décidée, en dehors des systèmes d’ordre imposés par les pouvoirs dominants. C’est l’expérience du No Border, qui vient de se tenir à Bruxelles. Parti de la contestation face à l’injustice des frontières, le No Border devient un laboratoire des méthodes de lutte, exportables partout.
L’interview de Davide, elle, témoigne d’une implication militante extrême : accompagner la caravane autonome des associations locales pour briser l’encerclement dans lequel se retrouvent des populations de l’Etat mexicain d’Oaxaca. Lors d’une première caravane, les attaques des groupes paramilitaires avaient fait deux morts parmi les participants, une militante mexicaine et un observateur finlandais. Quelques mois plus tard, une seconde caravane démarre. L’objectif reste le même : briser l’isolement, faire connaître les exactions des paramilitaires, la complicité du gouvernement, la volonté des populations en lutte. [5]

De ces expériences autonomes et révolutionnaires, la presse majoritaire - et majoritairement capitaliste - ne rend pas compte. Nous avons choisi de donner la parole à une militante vénézuélienne, Antenea Jimenez, qui témoigne d’une forme d’organisation communautaire : la comuna. Basée sur la production au niveau local, elle fonctionne grâce à la participation politique des communautés. Le chemin reste long : la construction du socialisme par la base prend de l’énergie et du temps. Les populations ne sont cependant pas découragées ; elles espèrent plutôt que leur mode de fonctionnement populaire fasse tâche d’huile, et gagne les autres niveaux de pouvoir…
On peut être totalement d’accord ou pas, le front commun dans la lutte paie. Antanea le disait bien : Un autre succès important, c’est que les gens parlent du socialisme. Peut-être n’en parlent-ils pas de manière scientifique, comme sur ce que Marx ou Lénine disaient. Mais ils en parlent familièrement. Le renouvellement de nos schémas de lutte est obligatoire. Les distances géographiques ou idéologiques peuvent s’effacer dans un combat commun, pour autant que le but soit le même. Car la répression, elle, ne connaît aucune frontière.
Mais si certaines « frontières », certains territoires sont communs, la distance entre deux peuples peut tout de même être immense. Le texte de Yossi Bartal, des Anarchistes contre le mur, exprime les difficultés de mise en commun pour les exploités en Palestine occupée. L’exclusion s’étend, par la nature-même de l’Etat sioniste, à toute les populations, palestinienne ou israélienne. Soumises au diktat d’un pouvoir colonial et raciste, mais aussi autoritaire et conservateur, la nécessité de se battre ensemble est incontournable. En citant Yossi Bartal, notre plus grande épreuve est de trouver comment éviter que ces contradictions ne nous empêchent de poursuivre notre combat, et d’apprendre à en tirer des leçons qui nous permettrons d’avoir une meilleure compréhension de la lutte contre le capitalisme globalisé.

Act local… tout près de chez nous… des frontières presque communes, en plein « centre » du monde globalisé [6] : la crise grecque a monopolisé pendant des mois l’intérêt des chaînes de médias, généralistes ou spécialisés. Aucune perspective n’a été avancée, ou si peu. La société grecque était en ébullition depuis 2008, elle nous renvoyait déjà l’image de nos « démocraties » européennes, minées par les privatisations et le capitalisme. Les solutions proposées, et applaudies par le gotha européen et économique, ne remettent pas en question l’architecture d’un système intégré dans l’exploitation économique mondiale. Ce n’est pas à nous de payer leurs crises ! était l’un des slogans utilisés lors des manifestations. A deux, Eponine Cynides et Léandre Nicolas ont rédigé une sorte de « ligne du temps expliquée » des évènements de 2009 en Grèce. « Expliquée » non pas à travers le prisme dominant, mais à travers les convictions d’une partie de la population qui s’appauvrit et qui souffre. Une population exploitée qui en a marre. Dans un second article, de jeunes Grecs brossent un portrait de la situation économique grecque, en déconstruisant les principaux mythes utilisés pour parvenir à imposer le dogme néo-libéral.
Cette doctrine nous est imposée tous les jours, à tou-te-s, partout dans le monde. La "démocratie" capitaliste est le nœud de la nouvelle colonisation mondiale... Qui a cependant des conséquences : le rassemblement des exploités pour réclamer leurs droits démocratiques. La lutte de classes ne connaît pas non plus les frontières. Et elle a besoin d’énergies.
Merci à Christine, Eponine et Léandre, Jeffery et Susan, Yossi, et à tou-te-s celles et ceux qui ont participé à ce numéro.
Fiona Wallers, pour l’équipe du JIM
Bannière : Ode
[1] Dans nos numéros précédents, certains articles ont abordé des aspects très internationaux. Voir les textes sur le "nouvel ordre mondial" et des Etats victimes des préceptes ultra-libéraux ; l’image de São Paulo, paradis du libéralisme effréné, mais aussi, déjà, sur la Grèce et les révoltes populaires de 2008.
[2] Voir à ce propos les travaux de Jacques Ion : L’Engagement au pluriel, 2001, ou Le militantisme en mouvement, interview réalisée par M. Ravaud, 2006.
[3] Penser global, agir local ; expression attribuée à l’économiste René Dubos, qualifiant au départ une économie respectueuse de l’environnement. Par extension, cette expression devient un symbole des nouvelles façons de penser le monde : l’état de la planète dépend de ce que nous faisons près de chez nous, pas nécessairement en relation avec des organismes institutionnels.
[4] Voir la Charte du JIM.
[5] Au moment de publier cette interview réalisée par Christine Oisel, nous apprenons que la population dans cette comuna vient d’être durement réprimée, et que l’organisation communautaire et autonome a été totalement détruite par les forces répressives.
[6] Immanuel Wallerstein, sociologue américain, décrit, dans son ouvrage The Modern World System, le "système monde", dans lequel le captalisme s’étend à la planète. Son extension partage les pays en trois groupes : le centre, la semi-périphérie, et la périphérie. Ces Etats restent cependant intimement liés par le système d’exploitation capitaliste.
