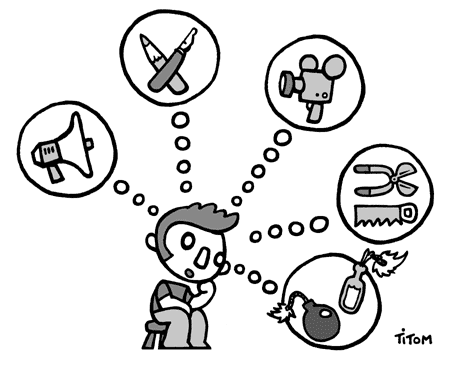|
Journal Indépendant et Militant
|
http://lejim.physicman.net/spip
|
|
La guerre des mots
|
« La guerre ne se fait pas seulement avec des missiles, des avions et des chars : elle se fait depuis toujours avec des mots » [1]
par Didier Brissa, Julien Dohet, Karin Walravens, Laurent Petit, Marc Jacquemain, Michel Recloux, Olivier Starquit, Pierre Eyben, Yannick Bovy
Guerre et terrorisme
Substituer un mot à un autre revient toujours à modifier le regard et les interprétations anciennement portés sur le phénomène observé. Ainsi, concernant la guerre en Irak, c’est une chose de soutenir la croisade pour la démocratie, c’en est une autre de voir les soldats états-uniens englués dans une guerre civile entre factions musulmanes rivales provoquée par la volonté délibérée de l’administration Bush d’anéantir l’Irak.
Joris Luyendijk, ancien correspondant au Proche-Orient, s’interroge également sur le choix des mots pour couvrir la situation de l’État d’Israël : Devons-nous dire « Israël », l’« entité sioniste », la « Palestine occupée » ? « Intifada », « nouvel Holocauste » ou « lutte d’indépendance » ? Ce bout de terre est-il « contesté » ou « occupé » ? Et doit-il être « donné » ou « rendu » ? Un responsable politique israélien qui croit que seule la violence peut protéger son peuple est appelé un « faucon ». A-t-on jamais entendu parler d’un « faucon » palestinien ? Non, c’est un « extrémiste » ou un « terroriste » ? [2]
En outre, depuis le 11 septembre 2001, la qualification de terrorisme est une puissante arme politique et morale utilisée aujourd’hui par quasi tous les gouvernements de la planète, non seulement pour discréditer ceux qui leur résistent (est terroriste celui que le pouvoir désigne comme tel), mais pour justifier leurs propres barbaries (et leurs pratiques liberticides portant atteinte à des droits fondamentaux tels que la liberté d’association). La puissance évocatrice de ce mot est devenue pratiquement incontrôlable.
Renommer pour rendre la réalité plus conforme à la nouvelle vision du monde : les premiers coups d’État sont toujours sémantiques. Ainsi, plus proche de nous, la crise politique belge peut également être vue et lue comme une bataille sémantique au cours de laquelle la Flandre ne cesse de prendre l’avance et de décrocher le premier prix d’excellence en dictant, d’entrée de jeu, voire en anticipant chaque fois que de besoin, par un mot, une phrase, un slogan, sa conception politique des choses et, dès lors, le cadre conceptuel qu’elle entend imposer et les limites dans lesquelles elle prétend circonscrire le débat [3]. Ainsi les Flamands parlent de la scission de Bruxelles-Halle-Vilvorde alors que cette option n’est pas nécessairement préconisée en ces termes par l’arrêt de la Cour d’arbitrage, qui stipule seulement qu’une solution devra être trouvée. Le choix des mots influence l’orientation du débat. Celui qui impose à l’autre son vocabulaire lui impose ses valeurs, sa dialectique et l’amène sur son terrain à livrer un combat inégal.
Monde politique et médias
Ce phénomène ne se cantonne pas aux belligérants en Irak et ailleurs ou à la crise politique qui traverse la Belgique. Tous les jours, nous y sommes confrontés dans le cadre de la guerre économique. « Les partenaires sociaux devront à tout prix se pencher sur la problématique des charges sociales.Afin d’éviter les pièges à l’emploi, seule une réforme drastique permettra de mieux aligner le capital humain sur les besoins d’une société efficace, soucieuse d’une bonne gouvernance.Une grève sauvage a encore pris en otage la population ce matin.
Tous les jours, les ondes déversent de manière lancinante de tels propos, tous coulés dans le même moule, cette logorrhée d’une pensée unique, outil de propagande silencieuse et de persuasion. Pourquoi ces termes foisonnent-ils ? À quelles fins ? Pourquoi certaines expressions sont-elles dépréciées ? Pourquoi tel mot est-il préféré à un autre ? Pourquoi les interlocuteurs sociaux ont-ils été transformés en partenaires, pour lesquels il semble obligatoire de parvenir à un accord à n’importe quel prix ? Pour mieux nier la lutte des classes et la conscience de classe, termes devenus obsolètes et invisibles à l’heure de la cogestion (des reculs sociaux) ? Pourquoi une grève qui démarre de manière imprévue est-elle appelée sauvage alors que le qualificatif de spontané paraîtrait plus adéquat ? Pour mieux tuer dans l’œuf toute velléité de solidarité entre les usagers et les travailleurs.
La langue politiquement correcte, le langage fonctionnel des technocrates, les lieux communs médiatiques et les expressions branchées dans lesquels doivent se mouler nos paroles quotidiennes, tout cela contribue à l’édification d’un vaste discours anonyme qui discipline la pensée de tous, tout en faisant taire la singularité de chacun.
Dans toute langue de bois, les circonvolutions ont pour fonction de freiner la prise de conscience des enjeux par l’adoucissement des images, outre qu’elles réduisent la compréhension et minimisent les dangers.
Les néologismes globalisants se naturalisent sans que les citoyens aient eu le temps de pratiquer à leur encontre le doute méthodique et d’identifier le lieu d’où parlent leurs inventeurs et leurs opérateurs. Et, bien souvent, les gens endossent sans le savoir les mots et les représentations associés aux choses et aux forces qu’ils entendent combattre.
Or le langage n’est pas un simple outil qui reflète le réel ou qui le désigne une fois constitué mais il crée également du réel en orientant les comportements et la pensée. Si les mots sont importants, les mots politiques et sociaux le sont encore plus. Leur répétition et leurs occurrences en réseau orientent la pensée et l’action car substituer un mot à un autre revient toujours à modifier le regard et les interprétations anciennement portés sur le phénomène observé. En travestissant leur sens ordinaire et en colonisant les mentalités, les mots ont un réel pouvoir de création de l’injustice.
Croyant refléter l’opinion des gens ordinaires, les médias contribuent en réalité à construire et à produire cette opinion, ils renforcent dès lors la pression de conformité qui pèse sur eux, réduisant ainsi leur propre marge de manœuvre pour tenir des discours plus lucides et plus explicatifs.
Le pouvoir symbolique, c’est d’abord le pouvoir d’amener les dominés à voir et à décrire les choses comme ceux qui tiennent des positions dominantes ont intérêt à ce qu’ils les voient et les décrivent. Certains concepts se voient ainsi renommés pour rendre la réalité plus conforme à la nouvelle vision du monde. Les exploités sont ainsi remplacés par les exclus : qui dit exploités, dit exploiteurs, mais qui est responsable de l’exclusion ?
Ainsi, le discours dominant relègue la radicalisation à la pathologie sociale, la conflictualité est dévalorisée et les problèmes sociaux sont psychologisés et dépolitisés [4].
Une autre stratégie de communication consiste à détourner le vocabulaire progressiste pour habiller et maquiller la mise en place et la domination d’un modèle capitaliste et conservateur.
La rhétorique réactionnaire, loin de se présenter comme la figure inversée de la rhétorique progressiste, reprend alors à son compte le lexique de l’adversaire. Ainsi la droite s’est appropriée la modernité, la réforme, la solidarité, le réalisme, l’internationalisme (même le terme de révolution n’a pas échappé à ses griffes), espérant faire passer une opération proprement réactionnaire pour une entreprise progressiste. Le mot réforme est un mot-valise, tantôt vide, tantôt évoquant son contraire, car les réformes menées ne sont pas des réformes mais plutôt une alliance objective pour maintenir l’ordre existant par tous les moyens. En d’autres termes, la réforme est le mode de permanence propre du capitalisme. Son usage permet de couvrir une révolution conservatrice et les dirigeants syndicaux et politiques ne sont pas les derniers à participer à ce marché de dupes, eux-mêmes noyés dans cet océan culturel libéral.
Un autre exemple de mot plastique est le concept de développement durable, qui est utilisé dans un sens tellement extensif qu’il ne signifie plus rien, sinon ce que veut lui faire dire le locuteur qui l’emploie et qui devient ainsi une arme sémantique pour évacuer l’écologie : la dissolution de l’idée de protection de l’environnement dans la novlangue du développement durable est une aubaine pour les multinationales. Telle voiture ou tel avion un peu moins polluants sont qualifiés de durables et se font caution morale dans la bouche des publicitaires alors même qu’ils ne sont que les chevaux de Troie d’une course effrénée à la croissance matérielle dont il est clair qu’elle n’est pas soutenable à long terme. On induit ainsi un insidieux effet rebond chez le citoyen, lequel se voit réduit au rang de consommateur et poussé à la surconsommation (pseudo-verte).
Pour paraphraser Philip K. Dick, l’instrument de base de la manipulation de la réalité est la manipulation des mots [5]. Certains termes sont dépréciés ou sont connotés négativement : tout ce qui gravite autour du peuple par exemple, à un point tel que l’on serait tenté de croire que le changement de conjoncture politique et intellectuelle invite à voir dans le peuple le principal problème à résoudre et non plus une cause à défendre [6]. Le recours à l’adjectif populiste permet de stigmatiser toute référence au peuple. Dans le même temps, cet adjectif a perdu toute signification vu l’usage surabondant qui en est fait. Dans le même ordre d’idée, s’abstenir de nommer avec précision participe de la même logique.
Outre les mots-plastiques ou les concepts-écrans, citons également les concepts opérationnels qui sont des mots qui empêchent de penser mais qui servent à agir et les énoncés performatifs où les mots font exister la chose : Ainsi, en acceptant d’utiliser le mot insertion, vous faites exister le mot et vous admettez implicitement qu’il n’y a pas de place pour tout le monde [7].
Tous ces outils font partie de l’attirail du discours capitaliste qui vise à justifier et à renforcer les politiques capitalistes. Il n’est pas un simple discours d’accompagnement, une simple musique de fond, c’est une partie intégrante de ces politiques. Il en masque le caractère de politiques de classe.
Pour rappel, la novlangue (newspeak en anglais) est la langue officielle de l’Océania inventée par George Orwell pour son roman 1984. Elle est une simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l’expression des idées subversives et à éviter toute formulation de critique (et même la seule « idée » de critique) de l’État, de doute, voire l’émergence d’une réflexion autonome.
La novlangue, ce jargon des propriétaires officiels de la parole, se compose de généralisations et d’expressions toutes faites et entraîne un appauvrissement sémantique qui lui-même induit un conformisme idéologique.
L’appauvrissement du vocabulaire sert à « restreindre les limites de la pensée. À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y aura plus de mots pour l’exprimer » [8].
Lutte et reconquête
Herbert Marcuse nous avait mis en garde : nous ne pourrons bientôt plus critiquer efficacement le capitalisme, parce que nous n’aurons bientôt plus de mots pour le désigner négativement [9]. 30 ans plus tard, le capitalisme s’appelle développement, la domination est devenue partenariat, l’exploitation a pris le nom de gestion des ressources humaines et l’aliénation est qualifiée par le terme projet. Des mots qui ne permettent plus de penser la réalité mais nous forcent à nous y adapter en l’approuvant à l’infini. Des concepts opérationnels qui nous font désirer le nouvel esprit du capitalisme même quand nous pensons naïvement le combattre.
Deux des principaux modes opératoires de cette novlangue sont l’inversion de sens (la réforme dont nous parlions tout à l’heure) et l’oblitération de sens : on empêche de penser selon certains termes ; certains mots sont bannis et à travers eux certains concepts et, partant, certaines analyses théoriques dont ces concepts sont les instruments [10].
Le constat étant posé, faut-il s’en inquiéter ? Oui et pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, parler et donc penser avec les mots de l’adversaire, c’est déjà rendre les armes.
Ensuite, restituer leur vraie signification aux mots est donner leur véritable sens aux actes. En outre, le silence autour d’une idée crée le risque de ne plus avoir un jour d’arguments pour contrer ceux qui s’opposent à cette idée.
L’imaginaire de la lutte sociale a été effacé. Or la reconquête idéologique passe par la reconquête des mots et du discours. Car si on ne dispose pas des mots pour penser, il sera impossible de le faire. Dans ce cadre, il faut souligner que nous avons besoin d’outils pour décoloniser notre imaginaire et il n’est pas inutile de rappeler que, historiquement, la montée des mouvements de gauche a été accompagnée d’un important mouvement d’éducation populaire. Ne serait-il pas judicieux de réhabiliter les mots tombés en désuétude, d’en créer de nouveaux et/ou de pervertir ceux de la droite ? Ne faudrait-il pas refuser l’usage de mots et d’expressions tels que rationalité de marché, marché, économie de marché et néolibéralisme en leur substituant ceux de irrationalité capitaliste, capital, économie capitaliste et ultralibéralisme, voire archéo-libéralisme ? Ne faudrait-il pas tenter de garder les mots de notre langage, ces mots qui étaient encore ceux de tout le monde en 68. Nous devons pouvoir dire encore peuple, ouvrier, lutte des classes sans être considérés à nos propres yeux comme des ringards. Abdiquer dans le langage, accepter la terreur qui nous interdit intimement de prononcer les mots qui ne sont pas dans la convenance dominante est une oppression intolérable [11] car, comme le terrorisme, le langage vise les civils et génère la peur pour induire un changement politique [12].
La reconquête idéologique sera lexicale ou ne sera pas.
Merci au Collectif le Ressort qui nous a permis de reprendre cet article.
Article publié dans les Cahiers de la Réconciliation, n°4, décembre 2008, pp. 22-26 (http://www.mirfrance.org/cahiers.htm)
[1] Marc Jacquemain et Corinne Gobin, « La guerre des mots », La Libre Belgique, 9-10 décembre 2006
[2] Joris Luyendijk, « Journalisme de guerre, les mots biaisés du Proche-Orient », Le Monde diplomatique, mars 2007, p. 32. Voir également Julien Dohet et Michel Hannotte, « Le résistant, un terroriste victorieux ? » in Politique n°32 de décembre 2003, pp. 58-59. Voir aussi Sophie Wahnich, La liberté ou la mort, essai sur la Terreur et le terrorisme, Paris, La Fabrique, 2003.
[3] Marc Delbovier, « De l’art du concept à la guerre des mots », La Libre Belgique, 5 septembre 2008
[4] Roser Cussó et al., Le conflit social éludé, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2008.
[5] Comme il l’explicite dans le cas présent dans le recueil de nouvelles Le crâne, Paris, Denoël, 1987, p. 20 : « L’outil fondamental pour la manipulation de la réalité est la manipulation des mots. Quand on peut contrôler le sens des mots, on peut contrôler les gens qui sont obligés d’utiliser les mots »
[6] Annie Collovald, Le « Populisme du FN », un dangereux contresens, éditions du Croquant, Bellecombes-en-Bauge, 2004, p. 189.
[7] Franck Lepage, L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu, Cuesmes, éditions du Cerisier, 2007, p. 63.
[8] George Orwell, 1984, Paris, Gallimard, 2000, p. 89
[9] Voir aussi le livre collectif Peut-on critiquer le capitalisme ?, Paris, La Dispute, 2008.
[10] Quelques exemples : charges sociales est utilisé à la place de part socialisée du salaire ; exiger la flexibilité, c’est exiger de se plier à l’inflexibilité de la domination du capital et c’est masquer la permanence de sa domination ; parler d’économie de marché, c’est oblitérer les concepts de capital et de capitalisme.
[11] Alain Badiou, « Mai 68, notre héritage », Le Sarkophage, n°7, juillet-septembre 2008, p. 11
[12] John Collins et Ross Glover, A User’s Guide to America’s New War, Collateral Language, New York, New York University Press, 2002, p. 2.
Je voudrais ici témoigner d’une expérience sociale et pédagogique déroutante, bien que courante car institutionnalisée et consacrée par les programmes officiels, à savoir l’enseignement de la théorie de la domination et de la reproduction de Pierre Bourdieu aux élèves des séries "économique et sociale" [1] dans le bassin du 93. J’y ai en effet enseigné les Sciences économiques et sociales de 2004 à 2010, dans 4 lycées différents, mon statut de TZR [2] dans la zone de remplacement de Bobigny m’ayant ainsi conduit à travailler dans un nouvel établissement pratiquement chaque année.
A chaque fois, le moment « Pierre Bourdieu » a été un temps fort dans l’année, un moment de remise en question collective, pour la classe comme pour le professeur, et un virage particulièrement délicat à négocier.
Nous reprenons ici un article initialement paru dans Socio-Logos, [3]. Merci à la revue et à Fabien Truong pour leur aimable autorisation.
1. Lycéens dans le 93
Commençons par brièvement décrire le profil les lycéens du département. Ce sont des élèves qui sont clairement situés dans le bas de la hiérarchie sociale. Les chiffres du chômage [4], des bénéficiaires des minima sociaux [5], des revenus [6] et de la répartition des Catégories socio-professionnelles [7]du département sont connus. L’inspection académique constate ainsi sur son site Internet que 50% de la population des collégiens provient en 2006 d’une CSP « défavorisée » (ce qui place le département en 4ème position parmi les 12 départements les plus peuplés du pays).
Ils réussissent en moyenne moins bien leur parcours scolaire que les autres élèves du pays : ainsi en 2008, les élèves de Terminale du 93 étaient 74,3% à obtenir le baccalauréat contre 85,4% pour la France entière [8]. Ainsi, à part un seul lycée, tous les établissements où j’ai exercé étaient classés APV [9]. Il faut d’ailleurs assister à la publication des résultats du bac dans un lycée de Seine Saint-Denis pour mesurer ce qu’il représente pour ces élèves. Pleurs, cris de joie, pas de danse, youyous et remerciements sans fins adressés aux professeurs sont autant de manifestations de la valeur accordée au diplôme, qui est bien plus perçu comme un aboutissement et une fin en soi que comme un passage obligé et un passeport vers les études supérieures, comme c’est le cas dans d’autres départements. L’obtention du bac reste une étape exceptionnelle qui distingue celui qui réussit de son milieu d’origine. Une autre indication permettrait de comprendre le symbole de distinction que représente le bac pour ces élèves : selon mes observations, dans les différents lycées où j’ai enseigné, entre un tiers et un quart des élèves de seconde que j’ai eu en classe étaient réorientés en fin d’année, et donc quittaient l’enseignement général et technologique. Aussi, lors des rencontres avec la famille, les parents expriment très souvent leur souhait que leur enfant obtienne un diplôme qu’ils n’ont pas.
Enfin, ce sont pour la très grande majorité des enfants d’immigrés ou de nationalité étrangère. Les chiffres de l’immigration du département sont ici une nouvelle fois connus. Mais ce qui semble encore plus révélateur que la question de la nationalité, c’est la dimension « ethnique » des lycéens du bassin, qui semble évidente pour qui enseigne dans le département tant elle est omniprésente mais qui est largement rendue invisible au regard extérieur, du fait, notamment de l’absence de statistiques « ethniques » en France. Pour ma part, sur l’ensemble des classes dans lesquelles j’ai enseigné pendant six années, je constate que 91% de mes élèves portent un nom à consonance maghrébine, africaine, asiatique, portugaise, espagnole ou est-européenne et que 9% portent un nom à consonance « française » [10](calcul effectué sur un panel de 312 élèves). Les élèves font très souvent référence à leur origine ethnique et expriment très clairement l’étrangeté de leur condition par rapport au modèle abstrait et universel du lycéen auquel devrait s’adresser l’école de la République. Ils traduisent régulièrement cette étrangeté par l’idée que « nous, c’est pas pareil », témoignant implicitement d’un déficit de légitimité au sein de l’institution scolaire et plus largement au sein de la société(1) [11]. Ce qui nécessite de penser aussi la question sociale dans son articulation à ce qui apparaît aussi être « la question raciale »(2) [12].
2. Que faire ?
Ainsi, les élèves qui me font face sont objectivement, au sens de Bourdieu, des élèves qui sont dominés socialement, économiquement, culturellement et scolairement. Non seulement, il va falloir parler de cette domination, la montrer et la démontrer, mais il s’agira en plus d’indiquer en quoi le rôle joué par l’école et par l’enseignement ne fait qu’accentuer des inégalités structurelles. C’est évidemment une position inconfortable et par ailleurs intenable pour l’enseignant. Le seul discours possible au quotidien est en effet le discours méritocratique car c’est le seul qui peut faire sens pour le professeur et pour les élèves. Si je commence à penser que mes cours sont inutiles et que mes élèves sont condamnés à l’échec, je ne fais plus cours. Si les élèves pensent que tout est déjà joué, alors ils ne travailleront plus.
La sociologie de Bourdieu nous pose donc un problème essentiel qu’il nous faudra résoudre en tant que classe : celui du sens de notre action.
Il pose aussi une question très concrète à l’enseignant : comment exposer sa thèse sans déclencher l’hostilité ou le mépris, qui seraient les deux faces d’une réaction attendue à l’expression de la « violence symbolique » latente dans le discours à venir et à tenir.
22.1. Acceptation et identification2
La première réaction de mes élèves – et ce constat s’est vérifié à chaque fois – est l’acceptation implicite et immédiate du discours sur la domination. Ce premier moment d’accord et d’acquiescement général s’est toujours dédoublé d’un second moment d’identification quasi automatique à la classe des « dominés ». Ce double mouvement est particulièrement visible dans les réactions à une séquence que je présente à la fois en classe de Première (chapitre sur la socialisation et la culture) et en classe de Terminale (chapitre sur la structure sociale) et qui consiste à travailler sur un texte définissant l’opposition entre le « franc manger populaire » et le modèle alimentaire bourgeois(3) [13]. Ce texte correspond par ailleurs à la première introduction aux écrits de Pierre Bourdieu pour les deux niveaux.
"Il a raison, Monsieur, un bon repas, c’est un couscous ou un kebab. On ne doit plus avoir faim après » (Fedh, 1ère ES)
« C’est pas logique. Les bourgeois, ils ont encore faim après leur repas alors que nous non ! » (rire général) (Gabriel, 1ère ES)
« C’est trop nous ça ! Arrêtez, Monsieur, ça me donne faim votre texte et il est bientôt midi ! » (Mounirou, Terminale ES)
On peut ici constater deux éléments significatifs. Tout d’abord, la très grande intériorisation du modèle dominant/dominé par les élèves qui se situent très vite, et de façon explicite, dans le groupe des dominés - ce qu’indique très bien le recours dans leur réaction orale à la dichotomie « Eux »/ « Nous » propre à la culture de la classe populaire, comme l’a bien montré Richard Hoggart(4) [14]. Ensuite, un fort sentiment de sympathie à l’égard de Pierre Bourdieu qui semble décrire « leur » monde et « leurs » pratiques.
22.2. L’impossible déni2
Cette première réaction contraste avec la réaction des élèves lorsque nous passons à la séquence sur l’école. Celle-ci consiste à présenter l’inégalité de réussite scolaire selon la CSP d’origine à l’aide de tableaux statistiques de l’INSEE, d’un extrait de texte de Bourdieu sur le capital culturel (5) et, enfin, d’une présentation de type magistrale sur la théorie des capitaux. Peut-être parce que le sujet comporte plus d’enjeux directs pour les élèves que celui du boire et du manger, celle-ci est beaucoup plus mise en doute et critiquée par les élèves.
« Monsieur, c’était il y a longtemps tout ça. C’était à son époque ! » (Khalifa, Terminale ES)
« Il a tort. C’est plus comme ça maintenant à l’école. En tout cas, je ne crois pas. » (Sihem, Terminale ES)
« C’est abusé, Monsieur. Il exagère. On dirait qu’il voit le mal partout. » (Zohair, Terminale ES)
Pourtant, cette phase de déni ne peut pas durer longtemps car les objections historiques ou morales des élèves ne tiennent pas face aux documents statistiques de l’INSEE les plus récents, notamment ceux qui établissent une corrélation statistique entre le niveau d’étude des fils et la CSP du père. Les oppositions sociologiques à la théorie de Bourdieu que propose le programme ne permettront pas non plus de renforcer cette position de déni temporaire puisqu’elles portent principalement sur des considérations épistémologiques (la thèse de Raymond Boudon (6) par exemple) qui ne remettent pas en cause ce qui pose problème aux élèves : le constat d’un échec socialement construit. S’en suit, alors une réaction générale qui oscille entre la prise de conscience pour certains et le fatalisme pour d’autres.
« C’est chaud pour nous, Monsieur ! » (Tahar, Terminale ES)
« En gros, on n’a pas vraiment le choix dans nos études, Monsieur ? » (Will, Terminale ES)
« C’est déprimant la sociologie ! » (Joshua, Terminale ES)
C’est à ce moment que l’enseignant doit trouver une porte de sortie pour les élèves. Si le capital sympathie que Bourdieu avait jusqu’alors accumulé semble avoir complètement disparu, l’essentiel n’est pas là : la plupart des élèves font une lecture personnelle des constats sur l’inégale réussite à l’école présentés en cours et projettent leurs difficultés dans un jeu de miroir peu à leur avantage.
« En gros, on est foutu, Monsieur ! » (Sékou, Terminale ES)
« Cela veut dire qu’on ne peut pas y arriver ? » (Fatiha, Terminale ES)
Cette lecture personnalisée des travaux du sociologue se projette d’ailleurs très souvent sur l’enseignant. C’est en général à ce moment que les questions personnelles me sont posées.
« Et vous, Monsieur, vous venez de quelle classe sociale ? Ils faisaient quoi vos parents ? » (Iklhef, Terminale ES)
Elles sont d’ailleurs beaucoup plus pressantes lorsque je présente le rôle inconscient joué par l’enseignant dans le mécanisme de reproduction car celui-ci insiste sur la distance sociale et culturelle entre le professeur et les élèves issus des catégories populaires et sur l’homologie d’habitus entre celui-ci et les élèves issus des catégories supérieures. Cette distance est souvent mal interprétée par les élèves qui l’assimilent à un complexe de supériorité.
« Vous vous sentez comment par rapport à nous, Monsieur ? » (Mounirou, Terminale ES)
« Ca veut dire que vous êtes un bourgeois alors ? » (Joshua, Terminale ES)
J’essaye alors de déplacer le débat hors de sa dimension personnelle et émotionnelle en proposant aux élèves deux interprétations morales et pratiques de ce qui vient d’être dit et qui nous permettront de dépasser la situation d’impasse dans laquelle nous risquons de nous trouver.
3. Des vertus du déterminisme
La première réponse d’ordre moral et philosophique est celle qu’adressait Bourdieu lui-même lorsqu’il lui était reproché d’avoir une théorie mécaniste où les individus sont privés de liberté d’action et de capacité d’initiatives. La connaissance sociologique est le premier pas vers la liberté : c’est en connaissant ses déterminismes que l’on peut être véritablement libre. On retrouve ici la lecture sociale que fait Bourdieu du concept de liberté chez Spinoza [15].
Citons ici Pierre Bourdieu : « la sociologie (...) offre un moyen, peut-être le seul, de contribuer ne fût-ce que par la conscience des déterminations, à la construction autrement abandonnée aux forces du monde de quelque chose comme un sujet » (7. p. 41). On peut aussi retrouver cette conception dans la séquence où Bourdieu doit faire face aux critiques de jeunes du Val Fourré lors d’un débat où ceux-ci se sentent désarmés et attaqués par le discours du sociologue dans le film La sociologie est un sport de combat [16] : "« J’espère avoir été le déclencheur de quelque chose (…) Pourquoi conclure de manière très pessimiste et de ne pas entendre ce que j’ai entendu aujourd’hui : c’est à nous de nous bouger et j’ajouterai collectivement, c’est à nous de nous mobiliser ».
Cet appel à l’espoir et à la mobilisation est souvent interprété par les élèves d’un point de vue pratique et se révèle être très efficace. Les élèves reprennent la parole et l’hostilité et la défiance qui commençaient à gagner la classe s’estompent très vite. Néanmoins, la portée politique du discours est rarement perçue et c’est plus une lecture individuelle du propos que font les élèves.
« Il pense que lorsque l’on va comprendre tout ça, ça va nous faire réagir ? » (Sara, Terminale ES)
« Il faut que l’on travaille beaucoup plus que les autres en fait, Monsieur ! » (Lahouari, Terminale ES)
« Comme ça, quand on voit tous ces chiffres, ça doit nous motiver pour s’en sortir et pour réussir » (Withney, Terminale ES)
Je ne saurai dire à quel point ce moment est véritablement performatif à moyen terme (les élèves vont-ils vraiment travailler beaucoup plus ?) mais à court terme il permet de retrouver la paix scolaire dans la classe, entretenu par l’espoir que tout est encore possible.
D’un point de vue personnel, il est parfois difficile de se situer clairement par rapport à cette lecture philosophique sur les vertus de l’objectivation du déterminisme social tant les difficultés scolaires persistent et tant c’est le temps long qui compte. Au final, le temps de classe peut ainsi souvent paraître dérisoire à l’échelle de celui des destins sociaux.
J’aime alors, dans ces moments de doute, me rappeler la célèbre phrase de Francis Scott Fitzgerald :« On devrait par exemple pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir, et cependant être décidé à les changer. » [17]
4. Faire mentir les statistiques : « yes you can »
La seconde réponse au problème posé est beaucoup plus pragmatique : derrière les statistiques, se cachent des individus. Si 48,5% d’élèves diplômés des grandes écoles sont des fils de cadres et professions intellectuelles supérieures, 6,4% sont des fils d’ouvriers [8]. Les destins sociaux ne sont donc pas scellés : sortir de sa condition d’origine n’est pas impossible, par contre cela est statistiquement peu fréquent. Il s’agit alors ici d’individualiser le discours et de recourir à une rhétorique plus anglo-saxonne centrée sur la possibilité de chaque élève de réaliser l’improbable. Il s’agit ici d’abandonner le mythe républicain de l’idéal collectif méritocratique et la logique bourdieusienne du faire ensemble pour emprunter à celui du « self made man » et de la réussite individuelle de l’être de talent.
Ce second appel à l’action est en général encore mieux perçu par les élèves, probablement parce qu’il s’adresse à chacun plutôt qu’à tous et qu’il éveille en chaque élève le sentiment qu’il sera différent des autres et qu’il pourra faire mieux. Il permet de donner à chacun, l’espoir ténu, de faire partie de l’exception et non de la norme, de l’accident et non de la moyenne.
« Vous allez voir, Monsieur, ce que je vais devenir, vous serez surpris ! » (Massinissa, Terminale ES)
« Je veux absolument faire cette école privée parce que je sais qu’après tout sera plus facile pour moi et que j’aurai un bon travail, qui paie bien » (Farid, Terminale ES)
« Il va falloir que vous gardiez mes contacts Monsieur parce que je vais réussir et je vais être riche, je pourrai peut-être vous aider un jour ! Retenez bien mon nom ! » (Ikhlef, Terminale ES)
« On veut vraiment que notre dossier soit accepté, on veut la faire cette prépa, nous ! » (Will et Julien, Terminale ES)
Par ailleurs, il suscite un enthousiasme contagieux, celui de l’infinitude du champ des possibles, d’autant plus fort que les désirs et le besoin d’expression et de projection dans le futur des élèves avec qui j’ai travaillé sont extrêmement forts. Ils sont régulièrement exprimés en classe ou dans les couloirs du lycée, d’autant plus souvent que leur imaginaire dépasse largement le cadre scolaire et que l’affirmation de soi passe, pour beaucoup d’élèves, par la parole et la capacité à rompre le silence. Ou quand parler, c’est d’abord exister.
Ce n’est alors plus Francis Scott Fitzgerald mais plutôt un refrain de NTM qui illustrerait le mieux cet élan d’énergie et de détermination presque aveugle porté par mes élèves et qui, souvent, ont contaminé le professeur : « La Seine Saint-Denis, c’est de la bombe baby et si t’as le pedigree, ça se reconnaît au débit ! » [18].
5. Ce que parler veut dire
Si enseigner, c’est ainsi parler pour dire, faire face à une classe pour lui livrer des connaissances et leur donner du sens, l’enseignement de Pierre Bourdieu dans le bassin du 93 a été pour moi une expérience de confrontation sociale où parler pouvait se risquer à… ne plus rien avoir à dire.
Le propos du sociologue et la théorie de la domination et de la reproduction posent en effet la question du non-sens et de la contradiction entre les moyens mis en œuvre et le but visé par chacun dans la classe. C’est en effet le sens que le professeur accorde à son métier et à son rôle social, et le sens que l’élève donne à son travail aussi bien qu’aux attentes de réussite portées par la famille et l’institution qui risque de se perdre dans l’objectivation bourdieusienne. Quid d’une mission inutile pour l’enseignant et d’une mission impossible pour l’élève ?
L’histoire de la sociologie nous rappelle que deux postures classiques sont possibles : celle du protestant que décrit Max Weber qui, face à l’insupportable prédestination divine, se jette à corps perdu dans le travail et dans sa profession-vocation pour y trouver les signes rassurants de son élection ou celle du déviant de Robert K. Merton, qui, constatant que la fin ne peut être en adéquation avec les moyens, devra changer soit le but à atteindre, soit le chemin à emprunter pour y parvenir, ou bien, agir par routine, sans plus croire à ce que la société idéalise. C’est à ces choix et à ce que l’on pourrait appeler, pour parodier ici Max Weber, les « conséquences psychologiques de l’éthique boudieusienne », que la classe et le professeur sont ici renvoyés.
Par ailleurs, cette expérience met aussi en évidence la difficulté propre à la sociologie qu’est la réception de l’objectivation de ses pratiques et de la mise en forme de son propre parcours social. Celle-ci est, dans notre cas, d’autant plus grande à surmonter, qu’elle met en lumière l’existence d’une barrière sociale et culturelle entre l’enseignant et ses élèves afin d’insister sur l’influence qu’elle peut avoir dans le processus de reproduction sociale, alors même que la classe se doit d’être un lieu de vie et d’apprentissage cohérent où un seul but commun doit animer tous les protagonistes des interactions : comprendre et réussir. Et dans le contexte dans lequel j’ai enseigné, il m’est apparu que tout ce qui pouvait nuire à la cohésion du groupe classe entraînait très vite un accroissement des difficultés scolaires car il favorise les stratégies d’évitement face au travail.
C’est donc toute la question des conséquences pédagogiques de la « violence symbolique » en acte à laquelle aboutit la présentation de la « violence symbolique » théorique qui est alors posée.
Pour autant, il me semble que les propos de Pierre Bourdieu, ainsi que les effets de réflexivité qu’ils entraînent nécessairement, permettaient à chaque fois l’instauration d’une nouvelle lucidité commune dans la classe. Ils participent à la diffusion d’un savoir partagé parce qu’il a été dit, qui entraîne des interactions innovantes, des questions et des réponses inédites et une indicible connivence entre le professeur et les élèves, qui ressemble peut-être un peu à celle que partagent ceux qui ont été décrétés vaincus mais qui se savent encore debout.
« La sociologie confère une extraordinaire autonomie, surtout lorsque l’on ne l’utilise pas comme une arme contre les autres ou comme un instrument de défense mais comme une arme contre soi, un instrument de vigilance » (9, p. 38).
Fabien Truong
(1) Sayad A., L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. 2. Les enfants illégitimes, Paris, Éditions Raisons d’agir, 2006
(2) Fassin D. et E. (Dir.), De la question sociale à la question raciale ?, Paris, Editions de la Découverte, 2009
(3) Bourdieu P., La distinction, Paris, Editions de Minuit, 1979
(4) Hoggart R., La culture du pauvre, Paris, Editions de Minuit, 1970
(5) Bourdieu P., Les Héritiers, Paris, Editions de Minuit, 1964
(6) Boudon R., L’inégalité des chances, Paris, Armand Colin, 1973
(7) Bourdieu P., Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 1980
(8) Chauvel L., « Le retour des classes sociales ? », Revue de l’OFCE, 2001
(9) Bourdieu P., Choses dites, Paris, Editions de Minuit, 1987
[1] NDR : La rédaction s’est permise de remettre en toutes lettres des abréviations couramment utilisées dans l’enseignement en France
[2] NDR : Titulaire de zone de remplacement. Le Titulaire en Zone de Remplacement, appelé TZR, est un personnel titulaire du second degré affecté à titre définitif sur une zone de remplacement. L’appellation TZR regroupe l’ensemble des personnels d’enseignement, d’éducation, d’orientation et de documentation.
Le TZR conserve l’affectation en zone de remplacement qui lui a été attribuée lors du mouvement intra-académique jusqu’à ce qu’il demande et obtienne une mutation soit sur un poste définitif en établissement, soit sur une autre zone de remplacement. Selon le site web de l’Académie de Nantes .
[3] la revue de l’Association française de sociologie
[4] Un taux de chômage de 9,4% au 1er trimestre 2008 contre 7,2% pour la France métropolitaine selon l’INSEE.
[5] Le nombre de bénéficiaires du RMI reste très supérieur à la moyenne française (au 31 décembre 2008, c’est le département qui atteint le taux le plus fort avec 64 personnes pour 1000 vivant du RMI, contre 31 pour 1000 au niveau national selon l’INSEE)
[6] Un salaire horaire net moyen de 12 euros par heure de l’ensemble des salariés à temps complet contre 16 euros pour l’ensemble des salariés à temps complet en Ile de France selon l’INSEE.
[7] 7,1% de Cadres et professions intellectuelles supérieures contre 15,2% d’Ouvriers, et 21,8% d’Employés en 2006 selon l’INSEE.
[8] Ces moins bons résultats sont d’ailleurs observables pour l’ensemble des baccalauréats : 78,8 % contre 89 % pour le bac général, 68,4% contre 78,8% pour le bac pro et 71,2% contre 81,8% pour le bac techno en 2008 (Source : Ministère de l’Education Nationale)
[9] Quant au seul lycée non APV, il satisfaisait aux critères de classement mais le proviseur refusait de le classer affichant une volonté explicite de ne pas discriminer son établissement.
[10] Ce qui correspond, dans mon calcul statistique, aux noms restants, c’est-à-dire aux noms qui n’ont pas de consonance maghrébine, africaine, asiatique, portugaise, espagnole ou est-européenne.
[11] Sur ces questions voir Sayad A., L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. 2. Les enfants illégitimes, Paris, Éditions Raisons d’agir, 2006.
[12] Voir Fassin D. et E. (Dir.), De la question sociale à la question raciale ?, Paris, Editions de la Découverte, 2009
[13] Voir Bourdieu P., La distinction, Paris, Editions de Minuit, 1979.
[14] Hoggart R., La culture du pauvre, Paris, Editions de Minuit, 1970.
[15] Spinoza critique ainsi la notion de « libre arbitre » dans son Éthique : « Les hommes se croient libres pour cette seule cause qu’ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés » (Trad. franç., Paris, GF-Flammarion, 1965, partie 3, prop.2, scolie, p.139)
[16] Pierre Carles, La sociologie est un sport de combat, C-P Production,2001
[17] Francis Scott Fitzgerald, La fêlure, Gallimard, 1945.
[18] NTM, « Seine Saint-Denis Style » in Suprême NTM, Sony Music, 1998
Luk Vervaet a été pendant pendant plusieurs années un visiteur de Nizar Trabelsi en prison. Ce texte résulte d’entretiens directs qu’il a eus avec ce dernier.
Il nous livre, d’une part, l’analyse d’un mécanisme de lutte contre des personnes qui ressemble plus à de l’abus et à de l’injustice ; et, d’autre part, sa conviction par rapport à un homme qui souffre en prison.
Le jeudi 29 avril, un tribunal de Bruxelles a examiné pour la dernière
fois, en séance extraordinaire, le dossier de l’extradition de Nizar
Trabelsi aux États-Unis. Il s’agissait plus particulièrement de savoir
si accepter son extradition équivaut pratiquement à signer son arrêt de
mort.
En effet, dans une lettre du 11 novembre 2009 concernant la peine qui
lui serait éventuellement infligée, le ministre américain de la Justice
a déclaré sans détours que Trabelsi risque d’être exposé à « deux
fois la perpétué sans possibilité de remise de peine » (two times life
without parole). Lorsque le tribunal de Bruxelles aura formulé son avis,
il reviendra au ministre de la Justice de trancher. Depuis décembre 2009,
une procédure a été introduite par la défense de Trabelsi devant la
Cour européenne de Strasbourg afin d’empêcher une éventuelle
extradition.
Trabelsi : du footballeur professionnel au terroriste amateur
En juillet 2010, Nizar Trabelsi, ancienne vedette internationale de
football, qui a joué jadis pour la Tunisie, la Belgique et l’Allemagne,
aura 40 ans. A ce moment, il aura passé près d’un quart de sa vie dans
une cellule de prison en Belgique.
Il y a 10 ans, en septembre 2000, Trabelsi est parti au Pakistan et ensuite en Afghanistan. Avec son argent, il a aidé à y construire des mosquées et des puits d’eau. Il y aboutira dans un camp d’entraînement. Selon ses propres dires, il est revenu avec le plan de commettre un attentat contre la base militaire de Kleine Brogel, qui abrite des armes nucléaires et des militaires américains.
Ce retour en Belgique s’est effectué en juillet 2001. Le 11 septembre 2001, des avions se sont écrasés contre les tours de New York.
Le monde s’est arrêté pendant un instant. Immédiatement, l’ensemble
du monde occidental a préparé la riposte. A peine un jour après nine
eleven, la police belge a arrêté Nizar Trabelsi à Bruxelles. Elle n’a
dû ni le dépister ni le chercher. Il a suffi de sonner à la porte de son
appartement et de lui passer les menottes. Tous ses faits et gestes, depuis son départ et son séjour en Afghanistan jusqu’à son retour en
Belgique, étaient parfaitement connus des services de sécurité.
Plutôt qu’une intervention judiciaire et policière impérieuse, cette
arrestation-éclair devait servir de signal politique. Elle transmettait le
message qu’un scénario WTC américain avait été empêché en Belgique
: un émissaire d’Oussama Ben Laden avait été arrêté dans la capitale
de l’Europe, alors qu’il préparait un attentat. Que Trabelsi ne
disposait ni du professionnalisme, ni des réseaux de contacts, ni des
planques, ni de l’argent, ni des armes dont avaient disposé les auteurs
de l’attaque contre les tours de New York, n’y fit rien.
Alors qu’aucune preuve tangible n’est venue étayer la thèse que les
attentats de New York étaient l’œuvre de Ben Laden, chez Trabelsi on a
trouvé ce qu’il fallait. Très rapidement, il avouera en détail tout ce
qu’il avait dans son esprit : de ses bons contacts et de son admiration
sans limites pour Ben Laden jusqu’à son plan précis en vue de commettre
un attentat. Aussi, les Américains viendront-ils se mêler dès le premier
jour du cas de ce « lieutenant de Ben Laden » en prison : ils étaient
présents aux séances du procès, ils sont venus l’interroger à
plusieurs reprises en Belgique et ils lui ont même proposé un deal pour
qu’il fournisse des informations sur l’identité de « la taupe » au
sein de la base de Kleine Brogel. [1]
Trabelsi de son côté, fidèle à son rôle de vedette internationale,
s’est prêté avec complaisance au rôle d’icône de l’islamisme
radical. Mais il ne devait échapper à personne que Trabelsi n’avait
rien d’un terroriste endurci. Il reconnaissait ouvertement, sans aucune forme de contrainte de la part des enquêteurs, les intentions qu’il nourrissait. Dans ses déclarations à la presse, il affirmait qu’après sa libération il ne comptait plus que s’occuper de sa famille et qu’il n’avait nullement l’intention de faire de la peine à qui que ce soit.
La peine maximale en Belgique, en Tunisie et aux Etats-Unis
Après deux années de détention préventive, Trabelsi a été condamné
en 2003 en Belgique à la peine maximale de 10 ans d’enfermement
effectif « pour avoir planifié un attentat terroriste ». La Belgique ne
serait pas la seule à le condamner. La Tunisie et les Etats-Unis en
feraient de même.
Parce qu’il dispose de la nationalité tunisienne, son affaire est passée en janvier 2005 devant un tribunal militaire tunisien qui l’a condamné à 20 ans de prison pour « appartenance à une organisation terroriste étrangère en temps de paix ».
En avril 2006, son affaire a été traitée devant le Grand Jury Fédéral de Washington D.C. (District de Columbia) aux Etats-Unis. Celui-ci l’a inculpé d’ « appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but
d’assassiner des citoyens américains, d’utiliser des armes de
destruction massive, et soutien matériel et effectif à une organisation
terroriste étrangère (en l’occurrence Al Qaida). » Les Etats-Unis ont
demandé ensuite son extradition [2] [3].
L’appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des attentats terroristes est passible aux Etats-Unis d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité, dans son cas deux fois la perpétuité, sans possibilité de rémission de peine. Le soutien à une organisation terroriste est passible de 15 ans de prison, dans son cas deux fois [4].
Le 19 novembre 2008, la Chambre du conseil de Nivelles a décidé de donner le feu vers à son extradition [5] [6].
De football à punching ball.
A cause de son étiquette de « terroriste », Trabelsi a été soumis au
régime d’incarcération le plus sévère envisageable en Belgique.
D’abord, il a été transféré sans cesse d’une prison à une autre :
de Lantin, à Arlon, à Ittre, à Nivelles, à Bruges et retour.
Ensuite, il a été enfermé régulièrement, non par mesure disciplinaire, mais pour des raisons ‘administratives’, dans une cellule spéciale de haute sécurité (maximum security unit), sorte de prison à l’intérieur de la
prison, dans le Bloc U à Lantin ou la section AIBV (section de mesures de
sécurité individuelles particulières) à Bruges. Ce régime d’isolement total a été instauré sur ordre des plus hautes autorités pénitentiaires, contre tout avis médical, contre l’avis de certains directeurs de prison, malgré les recours répétés introduits par ses avocats et malgré ses grèves de la faim [7].
Enfin, suite à sa condamnation pour terrorisme, Trabelsi s’est vu refuser pendant ces neuf années toute possibilité de réduction de peine prévue par la loi ou toute possibilité de réintégration. A partir de 2004, Trabelsi pouvait éventuellement prétendre à un congé pénitentiaire. On ne lui a jamais accordé un seul jour. A partir de 2005, il pouvait solliciter une
libération conditionnelle. Refusée. De même, sa demande d’asile politique en Belgique, la même année. Refusée.
Trabelsi s’est avéré être le punching ball rêvé des spécialistes
de l’antiterrorisme. En mettant en avant son affaire, ceux-ci ont pu décréter une alerte
terroriste pendant des mois et arrêter des islamistes suspects. Alors que
dans le monde entier le passage au nouvel an en 2007 se fêtait sous les
feux d’artifice, Bruxelles a été la seule ville européenne à
interdire le feu d’artifice pour cause de « menace terroriste ». [8]. Il s’agissait prétendument de plans d’évasion de Trabelsi pendant son transfert d’Arlon à Lantin. Les questions au parlement à propos du «
sérieux » de cette opération antiterroriste sont restées sans réponse
et Trabelsi n’a jamais été interrogé ni inculpé à propos de cette
affaire. En novembre 2008, il a été transféré de la prison de Nivelles
à celle d’Ittre, après que des rumeurs aient évoqué son intention de
s’échapper de Nivelles. En décembre 2008, il a été transféré
d’Ittre à Bruges, parce qu’il aurait dirigé à partir de la prison le
bras belge d’Al Qaida. Lorsque Ashraf Sekkaki s’évade de la prison de
Bruges en juillet 2009 à l’aide d’un hélicoptère, Trabelsi, qui se
trouvait à ce moment dans le Bloc U à Lantin, à été lié à cette
affaire et quelque semaines plus tard « des lames de rasoir ont été
découvertes à proximité de sa cellule ». Son transfert à Bruges a
suivi immédiatement et son isolement a encore été renforcé : hormis les
membres de sa famille, personne ne peut plus visiter Trabelsi depuis août
2009 [9].
Condamnation à mort ou asile.
La Belgique est impliquée dans la guerre américaine contre
l’Afghanistan depuis aussi longtemps que Trabelsi est en prison. Trabelsi
est le genre de personnes que nos soldats combattent en Afghanistan. Son procès, son éventuelle extradition, son isolement depuis des années, ont moins rapport à une justice équilibrée qu’ils ne sont des séquelles inévitables de cette guerre.
La Belgique est bien trop partie prenante pour juger Trabelsi de manière impartiale et ceux pour qui notre pays se bat en Afghanistan, notamment les Etats-Unis, n’y sont en aucun cas capables.
Je plaide pour l’armistice. Pour l’arrêt de l’engagement belge en Afghanistan. 10 années de guerre sans issue, c’est assez.
Je plaide pour que la justice belge refuse l’extradition de Trabelsi aux
Etats-Unis.
Je plaide pour la mise en œuvre d’un dialogue avec ceux qui
prennent les armes contre nous ou souhaitent le faire, avec les Trabelsi et les autres que nous regroupons sous des dénominateurs tels que « réseau kamikaze pour l’Irak de Muriel Degauque » ou « filière afghane de Malika al Arud ».
Les Britanniques l’ont fait avec succès en Irlande du
Nord avec l’Ira et le Sinn Fein.
L’affaire Trabelsi est peut-être l’occasion de renouer avec une autre vieille tradition. Le président Mitterrand a accordé en 1985 l’asile politique en France à quelques centaines de membres des Brigades Rouges italiennes parce qu’ils n’avaient aucune chance de bénéficier d’un procès équitable en Italie et ce à condition qu’ils renoncent à la lutte armée. Le président brésilien a fait la même chose en 2009 pour Cesare Battisti des Prolétaires Armés pour le Communisme (PAC), dont l’Italie demandait l’extradition suite à sa condamnation à perpétuité pour quatre homicides. Qu’est-ce qui empêche la Belgique d’en faire autant ?
Luk Vervaet, enseignant en milieu carcéral
Pour mieux comprendre les mécanismes de lutte anti-terroriste mis en place depuis le 11 septembre 2001, notre article sur la violence légale en trois parties est consultable ici :
Quand ils viendront chercher un juif,
Quand ils viendront chercher un communiste et Quand ils viendront nous chercher....
Connaître, comprendre
Lorsque les Etats-Unis ont demandé son extradition en 2008, j’ai
décidé de rendre visiter à Trabelsi dans la prison de Lantin. Ces
visites se sont déroulées dans les règles, avec la demande officielle
requise, screening, autorisation, fouille, gardien à la porte lors de
chaque visite. Dans des articles du journaliste Claude Demelenne, du
sénateur MR Destexhe et de Nadia Geerts, le trio qui organise en Belgique francophone la chasse médiatique contre les « islamo-gauchistes », il a été suggéré que j’entretenais des « liens douteux » avec le « terroriste Nizar Trabelsi », et, selon eux, mon licenciement comme enseignant en milieu carcéral en août 2009 pour des raisons de sécurité (gardées secrètes) était dès lors « justifié et normal » [10]. Ainsi, l’affaire Trabelsi a également offert l’occasion en Belgique d’instaurer une interdiction professionnelle pour ceux qui lui rendent visite.
A propos des mes « rapports douteux » avec Trabelsi, je souhaite
apporter les quelques observations suivantes.
D’abord, et ceci n’est évidemment pas en soi un argument dans la
discussion, mais face à l’imagerie ambiante sur le genre de « monstres
et de barbares » que nous combattons en Afghanistan, cette précision
n’est pas inutile : l’homme menotté, portant une barbe religieuse,
dont vous voyez de temps en temps la photo dans votre journal est un Homme, comme vous et moi. Il a évidemment aussi acquis une renommée parmi les détenus. Du « prosélytisme » dira-t-on.
C’est un avocat qui m’a fait le récit qui suit, et non Trabelsi lui-même : une des rares fois où il ne se trouvait pas dans une unité spéciale de sécurité, un Belge condamné à perpétuité occupait la cellule voisine de la sienne. L’homme était dépressif, ne sortait plus de la cellule, ne faisait que fumer, ne se lavait presque jamais et mangeait à peine. Trabelsi lui a remonté le moral. L’homme a confié à son avocat : « Si jamais on
m’accorde le droit à un congé pénitentiaire, c’est Trabelsi que
j’irai visiter en premier ».
Le prisonnier que j’ai rencontré durant mes visites à Lantin, était, après presque neuf ans de prison, physiquement mais surtout psychiquement, un homme blessé. Il m’a beaucoup parlé de la mort, mais surtout
des enfants. Jusqu’à l’obsession, disent certains. Lorsque je lui ai
rendu visite, il a sorti son cahier de coupures de journaux qu’il a
confectionné au fil des années. La plupart des articles et des photos
concernent des enfants assassinés dans les guerres en Irak, en Afghanistan et en Palestine. « Palestine, Palestine » : davantage que le nom de l’Afghanistan ou de l’Irak, c’est celui de la Palestine qui revient
toujours. Il m’a montré une photo d’un enfant palestinien, la tête
seulement, sans corps. « Si jamais j’écris un livre, cette photo doit
figurer à la première page », insistait-il, lorsque j’essayais de
protester et lui faisais observer que ce ne serait probablement pas le
meilleur argument de vente de son livre. Trabelsi a perdu un enfant lui
aussi, perte dont il ne s’est manifestement toujours pas remis et dont il
a du mal à parler.
En disant certaines choses sur Trabelsi je ne souhaite pas en faire un
martyr, une source d’inspiration ou une victime innocente. Je veux
seulement écarter certains clichés diffusés sur le « terroriste
international Trabelsi » et mettre à jour la véritable question dans
cette affaire.

Trabelsi était un footballeur international talentueux et reconnu, un homme qui, jusqu’à ses vingt-cinq ans, ne s’était occupé
que de carrière, de succès et d’argent et qui ne s’était jamais
préoccupé de religion, voire de violence. Qu’est-ce qui l’a amené en
Afghanistan ? Comment en est-il arrivé à dépenser presque tout son
argent dans des projets humanitaires ? Et ensuite à revenir en Belgique
avec le plan de commettre un attentat ?
Naomi Klein a posé la même question quand elle écrivait sur les
attentats à la bombe avortés à Londres en 2005. Dans son article «
Terror’s Greatest Recruitment Tool » (11 août 2005), elle écrivait : «
La Repubblica mentionne qu’Hussain Osman, l’un des hommes suspectés
d’avoir participé à la tentative d’attentats à la bombe à Londres
le 21 juillet (il a été arrêté à Rome le 29 juillet 2005), avait
expliqué aux enquêteurs italiens qu’ils préparaient les attentats «
en regardant des films sur la guerre en Irak ». Surtout les films qui
montraient « des femmes et des enfants assassinés par les soldats
britanniques et américains… ou des veuves, des mères et des filles en
pleurs… ». Et de préciser : « ce qu’Osman révèle c’est notre
tolérance face à la barbarie, commise en notre nom, qui nourrit le
terrorisme ».
Moi-même, je n’avais pas de réponse à la question de savoir ce que l’affaire Trabelsi pouvait nous apprendre. La question n’a même pas été posée en Belgique.
Mes « liens douteux » avec Trabelsi ont consisté à l’encourager à écrire son récit. Ce à quoi il s’est consacré pendant des semaines dans sa cellule d’isolement.
Nous n’avons pas pu achever le travail parce que depuis son transfert de
Lantin à Bruges en août 2009, j’ai d’abord était rayé de sa liste
de visiteurs et ensuite parce que j’ai été interdit d’accès à
toutes les prisons de Belgique.
Luk Vervaet
Les notes sont de la rédaction
[1] Voir, par exemple, La Libre Belgique, 30 sptembre 2003
[3] De multiples questions restent posées quant aux motivations américaines dans la demande d’extradition de Nizar Trabelsi. Des journalistes de médias non alternatifs se sont même posés des questions
[4] Si Nizar Trabelsi est extradé, il devra être jugé et, plus que probablement, condamné une seconde fois. C’est ce que dit la défense, qui soutient que les arguments américains pour extrader Nizar Trabelsi ne sont pas clairs, et risquent d’être les mêmes que ceux pour lesquels il a déjà été jugé en Belgique.
[5] Le Soir, 24 novembre 2008, Solidaire et La Libre Belgique, 17 mars 2010. En comparaison, deux Belges détenus à Guantanamo ne seront pas extradés des Etats-Unis sur demande de la Belgique...
[6] Gareth Peirce, avocate et journaliste britannique, a consacré une partie de ses travaux aux condamnations extraordinaires en Grande-Bretagne, notamment concernant des militants de l’IRA. Elle a récemment publié un article dans le London Review of Books où elle détaille les processus extraordinaires mis en place par la justice américaine face à des présumés terroristes
[8] La Ligue des Droits de l’Homme n’a pas manqué de relever le caractère manipulateur de l’état d’urgence à Bruxelles, mais aussi d’autres médias, comme ici A Voix autre
[9] Peu de voix se sont élevées pour défendre Nizar Trabelsi. Le Soir a, pour se part, pu avoir un entretien avec Nizar Trabelsi en 2008
[10] Luk Vervaet a eu gain de cause contre l’administration pénitencière qui lui avait interdit d’exercer en prison. Une campagne a été initiée pour le défendre. Aujourd’hui, on sait que c’est uniquement sur la base de ses opinions que Luk Vervaet a été écarté
Au delà du titre volontairement provocateur, voici une petite analyse sur le rôle de stabilisateur du processus électoral dans le système actuel, et pourquoi la révolution ne sortira pas des urnes.
Le système dans lequel nous vivons actuellement repose sur un ordre social de type pyramidal : la minorité de ceux qui en profitent en haut, la majorité des exploités en bas. Comme toujours dans ce type de hiérarchie se pose la question de la pérennité d’une organisation qui ne profite réellement qu’à une infime partie de ses membres, le reste devant se contenter de miettes.
Le capitalisme a trouvé de nombreux moyens pour assurer sa stabilité. L’un d’entre-eux est l’organisation d’élections "démocratiques" [1].
Ces élections ont (au moins) deux objectifs : d’une part renouveler les élites politiques, et d’autre part garantir l’adhésion d’une majorité de la population à l’ordre actuel [2].
Renouveler les élites politiques
Si le premier point est relativement évident, il est tout de même bon de rappeler que ce que l’on nomme les "élites politiques" (c’est à dire ceux qui se trouvent à la tête des partis de gouvernement par opposition aux militants "de base" ou aux petites formations politiques) se situent dans le haut de la pyramide. S’ils désirent s’y maintenir, ils ont besoin de l’appui du capital [3] et se doivent donc de servir, dans une certaine mesure, ses intérêts [4].
N’oublions pas non plus la capacité du système à corrompre et séduire nombre de ses opposants. Des anciens de Mai-68 [5], aux anciens maos de la Gauche Prolétarienne [6], en passant par d’anciens trotskistes [7], ils sont nombreux à avoir succombé aux charmes de l’économie de marché et à avoir su se hisser à une bonne place dans la pyramide capitaliste.
Canaliser le ressentiment populaire
Quant au second objectif, obtenir le soutien de la majorité de la population, le processus électoral y contribue en donnant à tout un chacun le sentiment de participer, ne fut-ce que par le simple acte de voter, à la vie politique sans pourtant lui donner un moyen concret de peser sur elle.
De plus, le vote permet de jouer un rôle de soupape face au mécontentement populaire. En effet, l’élection fournit aux mécontents une voie légale pour exprimer leur ressentiment.
Cet aspect de contestation légale est absolument nécessaire au système puisqu’il permet alors à celui-ci de criminaliser toutes les autres méthodes de contestation et de canaliser la colère populaire dans un processus dont il garde la maîtrise [8].
Ainsi, en criminalisant les autres formes de lutte et en offrant une large palette d’offres politique, il parvient à installer progressivement dans l’esprit de la population l’idée que le vote est le seul moyen acceptable d’obtenir un changement ; et par voie de conséquence, que seuls ceux qui ont été élus à l’issue de ce processus soient habilités à l’incarner [9].
Mais quelle sont les chances pour un mouvement révolutionnaire (c’est à dire un mouvement qui vise à renverser l’ordre pyramidal de la société pour instaurer une société de type égalitaire - ce qui en exclut les groupes réactionnaires) de prendre le pouvoir par les élections ?
A vrai dire, elles sont infinitésimales.
Un marché des votes
En effet, le capitalisme a fait, avec le débat politique, ce qu’il fait le mieux, il l’a transformé en marché.
Les différentes "offres" politiques se retrouvant donc en concurrence pour le marché des voix. L’accession au pouvoir, c’est-à-dire à une position dominante sur le marché, se fait donc suivant les règles classiques du capitalisme : publicité pour son "produit", adaptation de l’offre à la "demande", joint-ventures (alliances) et fusions-acquisitions, etc.
Publicité : elle oblige les partis révolutionnaires à se soumettre aux règles du jeu des médias dominants [10] pour obtenir une plus grande visibilité [11] et donc, souvent, à édulcorer le message révolutionnaire. On a ainsi pu voir des militants communistes révolutionnaires se produire dans une émission de variétés, ou dans une émission de "débats" politiques [12]. Le format de ces émissions ne permet généralement pas l’expression sereine des idées de fonds [13] et limite donc la portée du message qui peut ainsi être transmis dans un contexte de propagande massive en faveur du système [14]. Les résultats dans les urnes sont d’ailleurs rarement à la hauteur de la couverture médiatique ainsi obtenue par certaines figures de la gauche de gauche [15].
Adaptation à la "demande" : il faut d’abord noter que la demande n’est pas nécessairement celle du consommateur (de l’électeur donc). Elle est généralement formatée par la publicité et donc par les détenteurs du capital [16]. Par conséquent, le message politique a perdu de sa radicalité au fur et à mesure que la "demande" s’est déplacée vers la droite. On peut voir le chemin parcouru par le Parti Socialiste français entre la phrase de Mitterrand en 1971, « La Révolution, c’est d’abord une rupture. Celui qui n’accepte pas cette rupture avec l’ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. » [17] et celle de Ségolène Royal en 2007, « Il faut développer les pôles de compétitivité. Enfin, il faut investir massivement dans l’innovation et dans la recherche. Nous avons la capacité de relever tous ces défis, de réconcilier les Français avec les entreprises, de développer l’esprit de conquête et celui d’entreprendre. » [18]. De même, en Belgique, on peut mesurer l’écart entre la déclaration des principes fondamentaux d’Ecolo de 1985 [19] et le soutien au Traité Constitutionnel Européen [20] vingt ans plus tard. De sorte que, c’est maintenant la droite qui s’approprie des termes comme rupture [21] ou même révolution [22], en même temps que les mots révolution, lutte des classes (et même simplement classes dans un contexte extra-scolaire), voire carrément travailleurs ont quasiment disparu des programmes des partis de gauche (et ce même au sein de la "gauche radicale") [23].
Par ailleurs, l’adaptation à la "demande" se fait également en intégrant dans leur "produit" des éléments qui semblent faire le succès de la "concurrence", les partis dominants reprenant à leur compte des thématiques sécuritaires, xénophobes [24], nationalistes [25], voire sociales [26].
Alliances : leur but est évident, il s’agit de s’associer avec un ou plusieurs concurrents en vue d’obtenir (ou de conserver) une position dominante sur le marché [27]. Elles sont quasiment nécessaires pour parvenir au pouvoir, ce qui permet au système de se garantir contre des changements trop radicaux.
Et les Fronts populaires ?
Et si, malgré tout, une coalition à tendance révolutionnaire parvenait au pouvoir par la seule force des urnes, le capital a montré qu’il était prêt, soit à négocier avec le nouveau pouvoir en faisant quelques concessions [28] de manière à préserver l’essentiel du cadre capitaliste [29], soit à recourir à des méthodes plus drastiques comme le coup d’Etat [30].
Certes, on peut observer des situations intéressantes, particulièrement en Amérique latine, où des gouvernements affichant une claire volonté de changement sont parvenus au pouvoir. Mais quelques précisions sont à apporter.
D’abord, le contexte particulier de l’Amérique latine (longues années de dictature, énorme fossé dans les inégalités, populations indigènes en quête d’une existence politique) qui a permis l’émergence de mouvements populaires forts et sévèrement réprimés (des centaines de morts lors de la manifestation à Caracas en 1989, plusieurs morts aussi lors de la « guerre de l’eau » à Cochabamba en Bolivie en 2000) : c’est grâce à ces mouvements que les gouvernements actuels sont arrivés au pouvoir et parviennent à s’y maintenir malgré les contre-offensives [31] de la bourgeoisie locale (généralement soutenue par les Etats-Unis et les transnationales).
Ensuite, on assiste plus à un transfert du capital (du privé vers l’Etat) qu’à son abolition. Le patron change, il est peut-être meilleur et plus juste que le précédent ; mais ça reste un patron [32].
Seul l’avenir dira si ces expériences actuelles [33] mèneront progressivement à la révolution, c’est-à-dire à l’abolition du système pyramidal capitaliste ; mais l’issue dépendra certainement plus de la force et de la résolution des mouvements populaires que du seul processus électoral.
Seule la lutte paie
Bref, jamais la révolution, c’est-à-dire la renversement de l’ordre établi, n’a réussi au travers d’élections. Au contraire, en martelant que le vote est la seule voie possible pour le changement, le système à su transformer le processus électoral en un outil de décrédibilisation des autres formes de luttes. Ceci lui permet donc de maintenir sa domination sur la population, tout en donnant à celle-ci l’illusion d’un existence politique.
Peut importe, somme toute, la position de chacun dans le processus électoral bourgeois : vote ou abstention ; ce n’est que par des luttes populaires que l’on obtiendra des changements radicaux de l’ordre social actuel. Pour reprendre un slogan de Mai-68 : "Le vote ne change rien. La lutte continue."
Olivier Grévin
[1] Le terme démocratique est évidemment frauduleux dans le sens où ce n’est pas le peuple qui choisit ses candidats. Diverses règles assurent également que tout un chacun ne peut devenir candidat.
[2] Cette majorité ne doit pas nécessairement voter elle-même. Il suffit qu’elle ne conteste pas le jeu électoral, c’est-à-dire qu’elle accepte le résultat des élections. C’est ainsi qu’une abstention massive, tant qu’elle ne remet pas en cause le résultat des élections, ne constitue pas de réel danger pour le système en place.
[3] Pas seulement en terme de financement ; mais aussi en terme d’accès aux grands médias et aux réseaux d’influence.
[4] Qui deviennent donc progressivement les leurs aussi.
[5] Pensons à Daniel Cohn-Bendit, aujourd’hui défenseur de l’écologie de marché
[6] dont André Glucksmann qui a soutenu Nicolas Sarkozy en 2007
[7] Par exemple Lionel Jospin, Julien Dray, Jean-Christophe Cambadélis, tous reconvertis dans l’appareil du PS.
[8] Rappelons-nous par exemple du mouvement de colère dans les banlieues françaises en 2005 qui a donné lieu à une très forte répression d’une part et à une grande campagne pour inciter les jeunes à voter d’autre part. Avec le résultat qu’on sait...
[9] Ce qui explique qu’une abstention de plus de la moitié du corps électoral (par exemple en France, lors des élections européennes de 2009, ou plus récemment des élections régionales en 2010) ne remet pas fondamentalement en cause le système électoral étant donné qu’il reste, même pour la majorité des abstentionnistes, le seul mode de participation politique envisageable.
[10] Détenus par le Capital ou éventuellement par son fidèle second, l’Etat.
[11] Qui reste néanmoins marginale comparée à celle dont bénéficient les partis bourgeois. Voir par exemple le travail d’Acrimed lors de la présidentielle de 2007.
[12] Notons qu’à cette émission consacrée aux "petits" partis étaient tout de même invités les représentants des "grands", autant de temps de parole en moins pour les "petits"...
[13] En particulier par le cadrage qu’effectuent les journalistes face à un candidat proclamé communiste.
[14] Dans les médias dominants, dans les "grands" partis, à l’école, ...
[15] Ainsi, lors de l’élection régionale en France en 2010, le Nouveau Parti Anticapitaliste emmené en Ile-de-France par Olivier Besancenot, habitué des plateaux télés et radios, a obtenu un score inférieur à celui de Nicolas Dupont-Aignan, gaulliste dissident inconnu du grand public. Lire NPA contre NDA : 0-1, Le Plan B n°23, mai-juin 2010.
[16] Par exemple, Chirac s’exprimant à la télévision sur le thème central de l’« insécurité » dans la campagne présidentielle de 2002 : « Il aurait fallu être tout à fait sourd pour ne pas entendre ce que disaient les français avant la campagne. (...) Vous savez, je regarde aussi les journaux télévisés. Qu’est-ce que je vois depuis des mois et des mois : tous les jours ces actes de violence, de délinquance, de criminalité. C’est bien le reflet d’une certaine situation. Ce n’est pas moi qui choisissais vos sujets. » cité par Acrimed.
[17] Cité par Serge Halimi dans le Monde Diplomatique, Mai 2009.
[19] Parmi ceux-ci, on notera avec intérêt la place de l’antiproductivisme, la lutte contre la mondialisation, la lutte contre l’automobile et la prolifération nucléaire, le fédéralisme intégral, l’autogestion, ...
[20] Traité dont l’un des points principaux visait à l’instauration d’une concurrence libre et non-faussée sur le territoire de l’Union.
[21] Nicolas Sarkozy en 2007
[22] Voir le programme du cdH (démocrates chrétiens) pour les élections de 2009 en Belgique
[23] Lire à ce propos, « La guerre des classes », François Ruffin, Fayard, 2008, où l’auteur montre bien comment l’évidence de la guerre des classes à disparu du champ politique.
[24] Nicolas Sarkozy, toujours lui, a déjà mis en pratique au-moins 20 propositions du Front National avant la présidentielle de 2007
[25] Voir par exemple comment les principaux partis flamands en Belgique se lancent dans la surenchère communautaire.
[26] Par exemple, la "fracture sociale" du candidat Chirac, ou le "président du pouvoir d’achat" du candidat Sarkozy. Du côté du PS, on peut se rappeler de la position "noniste" de Laurent Fabius lors du référendum sur le Traité Constitutionnel Européen.
[27] Les exemples ne manquent pas, en France : Programme Commun (PS-PCF), Gauche Plurielle (PS-PCF-Les Verts), UMP (fusion RPR-UDF) ; comme en Belgique : coalitions "colorées" (arc-en-ciel, violette, orange-bleue, ...), cartels SPa-Spirit, CD&V-NVA, PC-PSL-LCR-PH, ...
[28] Ces concessions peuvent parfois paraître très larges et forment la base de ce que l’on a appelé "l’Etat-Providence", elles n’en ont pas moins permis au Capital de se maintenir et même de se développer.
[29] Ce fut par exemple le cas du Front Populaire en France en 1936. Il faut noter que l’une des premières actions de ce gouvernement fut de mettre un terme (par les accords de Matignon) au climat quasi insurrectionnel qui régnait, prouvant déjà que les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, appartiennent avant tout au parti de l’ordre.
[30] Par exemple en Espagne en 1936, en Grèce en 1967, ou plus récemment au Honduras en 2009 (à ce propos : La lutte contre la pauvreté est-elle tolérable aux yeux du nouvel ordre mondial ?).
[31] Coup d’Etat au Vénézuela en 2002, menaces de séparatisme des provinces riches en Bolivie depuis 2006, par exemple.
[32] Il est à noter que les gouvernements vénézueliens et boliviens commencent à faire face à des mouvements sociaux parfois très violents. Et si l’on peut certainement y voir en partie la main de l’opposition réactionnaire, il ne faut pas non plus négliger les immenses attentes de la population que les politiques gouvernementales ne parviennent pas à combler.
[33] Qui sont donc réformistes plus que révolutionnaires.
Nous sommes à trois jours de nouvelles nouvelles élections et avons (presque) tous reçu nos convocations électorales, le vote étant obligatoire en Belgique. Pourtant, de plus en plus de voix se font entendre en faveur de l’abstention. L’occasion pour le JIM de confronter les opinions.
A quoi servent les élections et pourquoi avez-vous choisi de voter ou de ne pas voter ? C’est la question que nous avons posée à quelques militant(e)s de gauche anti-capitaliste. Dans l’ordre des témoignages que nous vous proposons ci-dessous, certain(e)s ont fait le choix de se présenter comme candidat(e)s pour de "petits partis", comme Pauline (Front des Gauches) ou Axel (PTB), qui nous résument donc aussi la position de leur parti. Ensuite viennent les témoignages de "simples" citoyen(ne)s qui nous expliquent leur démarche. Ainsi, celui d’Anne qui, comme beaucoup, est dans le questionnement et hésite quant à l’attitude à adopter. Gérard et Françoise expliquent quant à eux pourquoi ils votaient et ne votent plus. Tous semblent revenus de l’idée que les élections peuvent apporter un vrai changement, c’est-à-dire sortir du système d’exploitation capitaliste. Ce qui les sépare, c’est que pour les premiers, les élections restent un outil d’expression politique et qu’avoir un élu permet de jouer au poil à gratter. Pour les autres, les élections permettent de faire croire à la population qu’ils ont un pouvoir qu’en réalité on leur a confisqué, ce qui permet de consolider le système et donne un argument à la répression des mouvements sociaux.
Pauline, 24 ans, enseignante, militante et candidate pour le LCR/Front des Gauches : Les élections doivent être un outil politique au service de la lutte.
A la LCR, nous ne croyons pas que les élections à elles seules puissent mener au changement. Nous prônons la révolte sociale, l’auto-organisation des mouvements de contestation sociale. En même temps, nous pensons que les élections constituent un outil d’expression important. C’est un moment où les gens entendent plus parler de politique. C’est une bonne occasion de faire passer et d’expliquer nos positions anticapitalistes , de causer avec les gens dans les rues, sur les marchés... Je rencontre beaucoup de gens qui survivent avec peu, parfois moins de 600 euros par mois. Certains ont entendu parler de nous, s’intéressent. C’est motivant.
Nous sommes réalistes quant aux espoirs de résultats. J’avoue que j’y pense peu. Bien sûr, ce serait utile d’avoir un élu qui pourrait utiliser le parlement comme une tribune pour relayer les luttes, mais le centre de gravité principal ce sont les revendications et les mobilisations. Les élections doivent être un outil politique au service de la lutte. C’est dans cette optique que nous utilisons de grands mots d’ordre qui peuvent faire sourire certains, mais qui sont là pour mettre en lumière des revendications et susciter le mouvement.
Par ailleurs, je trouve important que le Front des Gauches ait réussi à réunir des gens qui ont mis de côté leurs divergences de contenu et de fonctionnement pour mettre le paquet sur ce qui les rassemble. Et l’idéal serait bien sûr que ce Front des Gauches persiste au-delà des élections pour continuer à construire cette lutte.
Quant à l’abstention, elle ne sert à rien. Si on ne peut faire changer les choses en votant, on ne le peut en s’abstenant non plus. Dans des pays où l’abstention est forte, comme aux Etats-Unis, le capitalisme se porte très bien aussi. Les capitalistes eux, ils ne s’abstiennent pas !
Axel, 32 ans, avocat, militant et candidat pour le PTB+ dans l’arrondissement BHV.
Les élections sont un moment où le débat politique prend un certain envol parmi la population et où elle se montre plus intéressée. Nous pouvons donc répondre présent et poursuivre notre engament militant : les actions que nous menons dans les quartiers et les associations, aux piquets de grève et dans les entreprises ou via nos maisons médicales. La situation de crise économique et de morosité politique, explique aussi que nous ne faisons pas une campagne purement anticapitaliste. Nous appelons à voter contre ce cirque politique pour pouvoir, lors de la campagne électorale, élever le débat et évoquer des thèmes comme la taxation des plus riches ou l’interdiction des licenciements.
Nous ne nous présentons pas en disant que si nous avons un élu nous nous en ficherons. Un élu peut amplifier les mouvements sociaux, surtout actuellement. Mais est-ce qu’un élu va pouvoir changer fondamentalement le rapport de force ? Au PTB, nous disons clairement non. Je ne me fais pas d’illusion. Par contre, dans les communes ou nous avons des conseillers communaux [1], on voit qu’ils jouent un rôle de porte-voix des luttes, ce sont des moteurs de mobilisation dans le fait que la population s’organise et peut ainsi obtenir certains résultats. En bref, cela appuie la lutte sociale. Un éventuel élu ne conçoit son rôle qu’en termes d’organisation et de conscientisation des gens dans leur propre lutte.
Anne, 33 ans, travailleuse sociale : Le vote est un outil d’expression politique, mais certainement pas de changement
Je viens d’une famille où l’on parle beaucoup politique, surtout au moment des élections. Mon premier souvenir marquant remonte aux années 1990, lorsque le PRL de Jean Gol menait une campagne bien facho. Mon père, en tant qu’indépendant, votait traditionnellement libéral mais a vécu une grande crise à ce moment-là, refusant de voter pour des gens qui défendaient une politique raciste. Parallèlement, mes parents ont accueilli des réfugiés politiques latino-américains, notamment en provenance du Chili où, une fois le projet d’Allende détruit, ils ont été emprisonnés puis envoyés en exil et déchus de leur nationalité. Les discussions que nous avions avec eux m’ont fortement marquée.
Mon questionnement par rapport au système parlementaire et à notre modèle de démocratie remonte à l’université. Peu à peu, je me suis rendu compte que croire à un vrai changement par les urnes est illusoire. Car si tu interroges trop le système une fois élu, on ne te laissera pas faire . Les Lumumba, les Allende ont été tués. Pour autant, j’ai continué à voter notamment en raison de mon histoire, et sans doute de la peur qu’un changement apporté par une révolution ne mène à une dictature, et donc doutant aussi de cette alternative-là.
J’ai voté pour des personnes que j’estime beaucoup chez Ecolo jusqu’en 1999, date du point de rupture en ce qui me concerne. Cette année-là, il y eut une grosse rafle de Tziganes [2] et Ecolo, qui était dans le gouvernement, n’a pas démissionné, se rendant complice d’une politique raciste, et je dirais même fascisante. A partir de là, je n’ai plus voté Ecolo, j’étais dégoutée.
Estimant que le "vote utile" n’avait rien d’utile, fatiguée par la logique électorale et de parti qui mène inéluctablement à une logique de pouvoir et à la perte des valeurs de base, j’ai voté "extrême gauche". Pas parce que je croyais à leur victoire électorale, mais pour défendre une position . Je n’étais pas d’accord avec tout, mais je me retrouvais dans les principes de base. J’ai voté PTB, ou autre petit parti de la
gauche radicale, comme je participe à une manifestation ou signe une pétition : c’était un acte militant.
Cette année, c’est le pompon. Quand le gouvernement est tombé, j’ai pensé : ça suffit ! Je n’aime pas les expressions faciles et poujadistes, mais c’est effrayant de voir à quel point tout ceci est un cirque ! Nos dirigeants ne nous montrent qu’un jeu politicard et de pouvoir. Ce n’est pas acceptable. Et même les "petits" partis jouent le jeu. Depuis les dernières élections, le PTB est entré dans cette logique électorale, a adouci son discours pour faire grimper les voix. Je ne voterai plus pour eux. J’ai par ailleurs été déçue de lire certains échanges sur Facebook, lors de la constitution du Front des Gauches. Ils révélaient à quel point ils suivent également une logique de pouvoir entre eux.
En l’état actuel de mes réflexions, je suis raisonnablement persuadée que, dans notre système, voter ne peut pas apporter de réel changement. Par contre, voter reste pour moi une manière parmi d’autres de dire quelque chose et j’estime qu’il est important d’exprimer son opinion quand on en a l’occasion. De plus, il y a la pression familiale, sociétale, c’est une vraie machine. En résumé, le vote est pour moi un outil d’expression politique, mais certainement pas de changement.
S’abstenir, c’est aussi dire quelque chose. Mais le problème c’est que l’abstention est systématiquement mal interprétée et présentée comme un désintérêt de la chose politique. C’est pourquoi je ne m’abstiens pas : je ne veux pas que l’on interprète mal ce que j’ai à dire. Par contre, si une manifestation était organisée le jour des élections, ou un communiqué collectif rédigé expliquant pourquoi des citoyens pleinement conscients et responsables s’abstiennent d’aller voter, je pense que j’en serais.
Françoise, 36 ans, enseignante : Le changement ne viendra pas des élites politiques mais des luttes sociales
J’ai voté Ecolo pendant pendant des années. Au début par conviction. « Ca nous concerne tous », « On a lutté pour avoir le droit de vote » etc. Puis, au fil des déceptions, par obligation légale mais sans y croire. Les années passant, la mise bout à bout des éléments qui constituent l’ordre mondial inégalitaire et violent que nous subissons m’a conduite à me « radicaliser » dans le sens étymologique du terme : connaitre et combattre les racines du mal plutôt que tenter d’en limiter les conséquences. Les catastrophes sociales et écologiques à répétitions sont principalement engendrées par le système capitaliste mondialisé.
Au sein des partis « traditionnels », dont Ecolo fait à présent partie, et même si certains membres bénéficient, à titre individuel, de toute mon estime et de mon amitié, le système n’est pas remis en question, on nous propose de le réformer : vive le capitalisme « social », « vert »... durable ! Et tant pis si ces notions sont fondamentalement antinomiques ! Il est amusant, si l’on peut dire, de prendre la peine de comparer les programmes des socialistes et des verts entre les années 1970 et 2010 ou de constater le rapprochement et le lissage des discours dits de droite ou de gauche. La dernière fois que j’ai voté, c’est donc pour un parti de gauche radicale.
Mais là encore, c’était sans conviction. Ces petits partis fourmillent de gens et d’idées intéressantes mais il est évident qu’ils n’arriveront pas à récolter un nombre de voix suffisant pour insuffler un changement radical. Parce qu’on ne les laissera jamais faire . D’abord en agissant en amont, la propagande étant l’arme quotidienne du système, puis par le jeu des alliances et des coalitions. De plus, certains comme le PTB ont décidé d’adoucir leurs discours pour avoir davantage de chances de gagner des voix. C’est très décevant.
Ce qui m’a fait basculer vers l’abstention, c’est de me rendre compte que participer aux élections dans un tel système non seulement ne peut conduire au changement, mais contribue à légitimer le système et donc à le renforcer . Les gens votent majoritairement pour les partis traditionnels, formatés depuis la maternelle à accepter bien sagement de vivre dans une société de « marché », la seule acceptable, tout autre alternative conduisant forcément vers la violence et la dictature. Pour les autres, des partis « radicaux », « extrêmes » sont là pour canaliser leurs colères et leurs déceptions, ce qui donne l’illusion de vivre en démocratie. De ce temps-là, ils ne pensent pas à contester autrement, ce qui d’ailleurs est considéré comme illégal puisque sortant des structures autorisées et organisées par le système. En d’autres termes, les élections, sont un très bon moyen de faire croire aux gens qu’ils bénéficient d’un pouvoir qui en réalité leur est confisqué, et constituent un très bon argument pour criminaliser les autres formes de luttes . C’est pour cette raison que je m’abstiens depuis quelques scrutins : je refuse de cautionner un système qui me révolte au quotidien.
Bien sûr, l’abstention n’est pas le moyen d’expression idéal. Mal interprétée, voire récupérée, elle ne constitue pas un outil de lutte en elle-même. Je pense que le changement ne viendra pas des élites politiques mais des luttes sociales, comme il en a toujours été .
Gérard, 31 ans, auteur pour le JIM : La lutte ne paie pas toujours, mais seule la lutte paie.
Personnellement, la dernière fois que j’ai voté, c’était pour faire plaisir à un pote du PTB en 2003. Auparavant, je suis passé par des votes pour le PS, Ecolo, le PC la liste D’Orazio (le seul vote que je ne regrette pas). J’ai nourri l’illusion de pouvoir changer le système par les urnes tout en menant un combat militant à côté. J’en suis revenu.
Ne parlons pas du PS et d’Ecolo qui, malgré certains acquis, combattent les plus faibles : approbation sans réserve du traité constitutionnel européen, soutien de la guerre en Afghanistan, contrôle des chômeurs et minimexés d’un côté et cadeaux inconditionnels aux plus riches de l’autre. Dans le champ de la lutte des classes, ces organisations se situent clairement du côté de la bourgeoisie, aussi sincères soient certains de leurs militants.
Viennent ensuite les « petits » partis (ce qu’a été Ecolo, d’ailleurs) de gauche radicale. Leur programme est souvent chouette, voire parfois novateur, mais après ? Les élections ne sont pas inutiles en soi. Mais dans un système capitaliste ? Maintenant ? En Occident ? En pratique, ces petits partis espèrent avoir un élu pour faire le moustique du Parlement (et un moustique, ça s’écrase facilement) ou bien ils comptent utiliser la campagne électorale pour bénéficier d’une tribune médiatique.
Ce faisant, ils valident complètement le processus électoral, même s’ils disent le contraire. Ils dépensent beaucoup d’énergie à entrer dans un système qui ne veut bien d’eux que pour donner une illusion démocratique. Et s’ils parviennent à y rentrer, leur vision idéologique est, au bout de quelques années, balayée au profit d’un programme politique épuré. C’est l’opération que mène le PTB depuis quelque temps. Ils ont bien fait de supprimer leurs références de « principe » aux pires conneries faites au nom du communisme (la Chine est capitaliste mais est toujours officiellement communiste) et de revoir leur mode d’organisation. Pour autant, le PTB doit-il renier son affiliation communiste ? Et ils n’ont même pas (encore) d’élu.
Je trouve l’aspect "tribune" ridicule. Autant de dépenses d’argent et d’énergie pour espérer apparaitre dans les médias et se faire le « porte-parole des travailleurs » ? Ne faut-il pas mieux repenser les modes d’action ? Les blocages des centres fermés par des militants sont efficaces à leur échelle et relayés médiatiquement sans grande campagne électorale. Les exemples sont nombreux et, que l’on soit d’accord ou non sur le fond ou la forme, ils ont aussi « le mérite » de voir l’appareil d’Etat s’y opposer de manière virulente. Chacun peut se positionner par rapport à l’action militante et à la réaction du pouvoir (je schématise très fortement sur l’organisation et l’éventuelle stratégie de ces luttes) . Pour utiliser une image malheureusement militaire, il est réellement déterminant de savoir dans quel camp on se situe et qui est son ennemi.
A mon sens donc, la lutte ne paie pas toujours, mais seule la lutte paie. Penser, comme beaucoup d’abstentionnistes et autres déçus du système, que celui-ci va tomber comme un fruit mûr, n’est donc pas non plus la solution. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont déclenché l’opposition à la mondialisation capitaliste dans les pays de l’Ouest. Mais bien les mobilisations de Seattle, de Gênes, etc. auxquelles les « petits » partis n’ont pris qu’une faible part organisationnelle. Ce sont les travailleurs de Clabecq ou de Continental qui se sont battus, pas les petits partis (même s’ils ont accompagné ces luttes).
Pourtant, il faut mettre ces combats bout à bout, en faire un ensemble cohérent de contestation. Et c’est bien là le rôle d’un parti (pour le communiste que je suis). Cela permet de rendre la victoire plus facile grâce à la solidarité qui peut être ainsi créée. Parce qu’aujourd’hui, les défaites sont bien plus nombreuses que les batailles gagnées. Dans un pays capitaliste, ce ne sont pas les campagnes électorales qui déterminent la réussite ou l’échec d’une lutte. C’est la manière dont la lutte pèse sur les dominants, qu’ils soient au parlement ou au siège patronal.
Cela étant, je déplore ce manque d’organisation des luttes, ce manque de parti (sans pour autant que ce soit un monstre qui doive tout gérer, tout le temps, faut arrêter le mythe). J’aurais bien plus de sympathie que je n’en ai envers le PTB (pour sa force militante) ou la LCR (pour sa force intellectuelle [3]) s’ils ne se fourvoyaient pas dans un processus électoral.
Cette convergence des luttes n’est pas facile à réaliser. Et je n’ai pas de réponse toute faite à apporter. Si ce n’est me battre, analyser, rester ouvert aux idées et espérer . Même si cela est souvent usant, être militant communiste est aussi très stimulant.
Propos recueillis par Christine Oisel
Article mis à jour le 11/06/2010
[1] Herstal, La Louvière, Seraing et Zelzate
[3] Je grossis le trait

Si ce n’est par ses brèves, le Journal Indépendant et Militant réagit rarement à chaud à l’actualité. Nous aurions pourtant aimé avoir un article de fond sur la Palestine. Sur l’historique du conflit, le sionisme, l’étouffement de Gaza, l’appropriation des ressources en eau, le mur, la vie au quotidien, l’attitude des pays occidentaux [1], l’hypocrisie des pays arabes. Ou plus simplement sur ces nouvelles brigades internationales, à vocation humanitaire faute de mieux : empêcher les Palestiniens de crever est devenu un objectif en soi.
Nous n’avons parlé de la lutte du peuple palestinien qu’au travers de nos brèves ainsi que par la publication d’une carte blanche ignorée des grands médias breve 818. Nous encourageons chacun à soutenir, d’une manière ou d’une autre, les peuples en lutte, dont les Palestiniens sont une constituante historique et spécifique. Une façon utile de se joindre à ce combat est de rallier la plate-forme Boycott-Désinvestissements-Sanctions qui vise à contraindre Israël à conférer des droits et un état aux Palestiniens autrement que par des ronds-de-jambes diplomatiques.
Dans ce numéro, nous avons donc proposé des articles qui abordent d’autres sujets, parfois moins connus.
En Afghanistan aussi, certains se battent. Leurs motifs ne sont pas toujours légitimes, loin de là. Ceux de ses envahisseurs ne le sont pas plus. La Belgique s’est rangée du côté de la "grande coalition" de l’OTAN et y a envoyé des troupes. De retour sur le sol belge en juillet 2001, Nizar Trabelsi a servi d’épouvantail idéal à la distillation de la peur du terrorisme. Militant islamiste, il a été arrêté en 2001. Le... 12 septembre. Il a très vite reconnu sa volonté de faire sauter la base militaire de Kleine Brogel, alors que le projet s’avérait complètement farfelu. Luk Vervaet, qui l’a longtemps côtoyé en prison, nous donne sa vision d’un homme menacé d’être extradé vers les Etats-Unis (et d’y être condamné une nouvelle fois) et victime de conditions de détention dignes de la torture "blanche" [2]. C’est à lire dans Extradition vers les USA : double-peine pour Nizar Trabelsi ?.
Mais La guerre ne se fait pas seulement avec des missiles, des avions et des chars : elle se fait depuis toujours avec des mots, phrase reprise par le Collectif Le Ressort [3] auteur de l’article La guerre des mots. Et, tiens, le premier exemple de cette guerre des mots nous vient du Proche-Orient : Devons-nous dire « Israël », l’« entité sioniste », la « Palestine occupée » ? « Intifada », « nouvel Holocauste » ou « lutte d’indépendance » ? Ce bout de terre est-il « contesté » ou « occupé » ? Et doit-il être « donné » ou « rendu » ? Un responsable politique israélien qui croit que seule la violence peut protéger son peuple est appelé un « faucon ». A-t-on jamais entendu parler d’un « faucon » palestinien ? Non, c’est un « extrémiste » ou un « terroriste » ?. Au-delà, les capitalistes au pouvoir usent et abusent de détournement de sens, de néologismes, de mots-écrans. La campagne électorale en cours nous donne un bon aperçu de l’attirail utilisé par le pouvoir pour tenter de masquer ce qu’il ne peut réellement taire. l’information de diversion des vrais problèmes avec, bien entendu, le communautaire. Ou encore la manipulation du langage. Les plans d’économie à venir, ce n’est pas de "l’austérité" (vocable utilisé par le passé) mais de la "rigueur". Nombreux sont ceux qui parlent de "nouvelles recettes", en fait des projets de taxes multiples : sur le carbone, sur les grosse fortunes, sur les transactions financières, sortes de potions magiques jamais utilisées. Ainsi, ils évitent d’aborder la "baisse des dépenses" qui touchera les plus pauvres. On parle de revoir les intérêts notionnels, pour en fait mieux les conserver, etc. etc.
Une autre machine se met également en œuvre. Face à l’éventualité d’un taux d’abstention élevé, les discours relevant l’importance du vote se sont succédé. Le JIM a publié deux articles sur la question. Le premier présente l’opinion, tranchée, d’Olivier sur le rôle de stabilisateur du système électoral, Pour ne rien changer : votez !. Le second pose la question : Le changement par les urnes, vous y croyez ? à des militants de gauche qui expliquent leur position quant au vote. Certains sont par ailleurs candidats aux élections. Le débat n’est pas facile, alors même que la position sur le vote est, entre guillemets, parasitée par un vote ou un non-vote protestataire lié au communautaire et pas au rôle des élections pour les luttes sociales. Et c’est bien le développement des ces luttes qui amène les personnes interviewées à voter… ou pas. Pour le JIM, qui n’a pas de « position officielle » à défendre [4], les élections ne représentent de toute façon qu’un élément parmi d’autres dans la question de la lutte. Juste voter ou juste s’abstenir, et ne rien faire à côté, ça ne sert à rien. C’est dans leur multiplication, leur diversité et leur capacité à être solidaires que toutes les « petites » luttes parviendront à faire changer le système.
Enfin, soulignons encore l’article de Fabien Truong, Enseigner Pierre Bourdieu dans le 9-3 : ce que parler veut dire, consacré à l’enseignement des théories de domination et de reproduction sociale développées par Pierre Bourdieu à des élèves qui... sont dominés socialement, économiquement, culturellement et scolairement. Autrement dit, comment faire comprendre à ces élèves que leur situation est statistiquement condamnée, sans pour autant les condamner eux. Bonne lecture.
Pour finir, le mois de mai fut l’occasion pour l’équipe de faire un premier bilan du projet, de se féliciter de ce qui marche bien et de chercher comment améliorer nos points faibles… Et le JIM a encore et toujours besoin d’articles et d’auteurs. N’hésitez pas à nous contacter si le projet vous inspire.
Merci à Christine, Fabien, Gérard, Luk, Ode et Olivier pour leur contribution à ce numéro.
Pour l’équipe du JIM, Gérard Craan
Bannière : Ode
[1] Dont la Belgique, qui s’est sagement abstenue au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question d’une enquête impartiale
[2] La torture blanche est une privation de stimulus : isolement, réveils brutaux, éclairages et bruits intempestifs, etc.
[3] et extraite de Marc Jacquemain et Corinne Gobin, « La guerre des mots », La Libre Belgique, 9-10 décembre 2006
[4] La première position officielle du JIM étant Notre Charte.