|
Journal Indépendant et Militant
|
http://lejim.physicman.net/spip
|
|
Edito 8
Enseignement /
jeudi, 20 mai 2010
/ Christine Oisel
,
/ Chris B.
|
L’enseignement a toujours suscité un intérêt particulièrement marqué. Au-delà de l’aspect strictement pédagogique et méthodologique se pose également la question du rôle de l’école dans la société. A quoi sert-elle ? A quoi doit-elle servir ? Dans une vision émancipatrice, l’école devrait permettre aux adultes de demain d’acquérir non seulement des connaissances, mais également les outils nécessaires afin qu’ils puissent poser des choix de vie conscients. Or, on le sait, l’école constitue l’un des premiers lieux de reproduction sociale. Il est donc permis de s’interroger sur les valeurs et les discours qui y sont transmis dans nos « démocraties » capitalistes.
C’est la démarche de Gérard Craan qui, dans L’école (entre-)prise d’assaut, s’intéresse à la manière dont l’école, soumise à la logique et aux exigences du secteur privé, inculque aux enfants dès leur plus jeune âge « l’esprit d’entreprise ». Des entreprises qui poussent et parviennent adapter les programmes des cours de manière à satisfaire leurs propres besoins en future main-d’œuvre : ce point précis fait l’objet du second volet de l’article, L’école (entre-)prise d’assaut : deuxième partie.
Les contenus sont donc au centre d’importants enjeux sociaux, économiques mais également philosophiques. Eponine Cynidès s’interroge pour sa part sur la pertinence de l’enseignement de contenus religieux à l’école : enseigner les croyances et les dogmes liés à une religion fait-il partie des attributions de l’école ? A lire dans Cours de religion à l’école ; et si l’on se préoccupait de l’intérêt de l’enfant ?.
Face aux questionnements multiples et nécessaires sur le rôle de l’école, différents projets pédagogiques alternatifs sont mis en œuvre depuis des décennies. Pierre Hère nous présente l’un d’entre eux, né en Belgique en 2008 : Pédagogie Nomade. Une école différente, basée sur le fonctionnement démocratique, l’autogestion et le décloisonnement, qui permet dans bien des cas de récupérer des élèves en décrochage dans l’enseignement ordinaire.
Si les matières et leurs contenus reflètent et entretiennent les valeurs que veut transmettre la société, il en va de même pour la façon dont l’école trie et sélectionne les enfants et les adolescents. Les enfants continuent à fréquenter des écoles et à suivre des filières différentes en fonction de leur classe sociale ou de leur origine.
Certains enfants, parce qu’ils souffrent d’un handicap par exemple, connaissent également des difficultés à évoluer dans le cadre de l’école ordinaire. Ceux-là sont majoritairement orientés vers un enseignement dit spécialisé ou adapté. Un système louable dans ses intentions, mais qui ne va pas sans susciter certaines préoccupations dans sa mise en oeuvre. Un système à l’image du lissage imposé par une société qui exclut les faibles et les originaux. Christine Oisel a rencontré le Dr Verheulpen qui revient sur les enjeux et les problèmes liés à ce type d’enseignement dans "Martine va à l’école spécialisée".
Ce tri commence bien avant l’école. La question de l’accès aux études, particulièrement aux études supérieures, reste très largement posée. Renaud Maes dans L’accès à l’enseignement supérieur : à questions idiotes, réponses stupides montre comment les diverses approches suivies jusqu’à présent se révèlent inefficaces et suggère d’en finir avec trois concepts mystificateurs : le talent, l’effort, le mérite.
Et pour tous ceux qui, en fin de parcours scolaire, n’ont que les petits boulots ou le chômage comme horizon ? Eh bien, on utilisera cette Armée de réserve de travailleurs [1] pour fournir au patronat une main-d’œuvre bon marché et corvéable à souhait et ce au travers, notamment, de « plans pour l’emploi ». Le plan Activa : « On a tous à y gagner ». Vraiment ? C’est la question posée par Ariane Lévêque. Ce « plan d’embauche massif » permet aux employeurs qui engagent des chômeurs « difficiles à placer » de bénéficier de réductions de cotisations ONSS tandis que les travailleurs subissent une instabilité financière importante liée à une bureaucratie effrayante et restent assimilés à des chômeurs.
Merci à Arianne, Christine, Eponine, Gérard, Renaud pour leur participation à ce numéro.
Chris et Christine, pour l’équipe de JIM
Une fois n’est pas coutume, le numéro suivant du Journal Indépendant et Militant se voudra éclectique et ne sera pas consacré à une thématique en particulier. De nouvelles élections anticipées se profilent dans notre beau royaume. Ce sera sans doute l’occasion de s’interroger sur les raisons qui poussent certains à voter voire à se présenter aux élections et d’autres à s’abstenir. Nous vous proposerons également des témoignages très différents, comme le coup de gueule d’Ernestine qui en a marre d’être prise pour une secrétaire ou, pour ne pas perdre le fil avec le numéro qui se termine sous vos yeux, un témoignage consacré à une expérience sociale et pédagogique audacieuse : l’enseignement de la théorie de la domination et de la reproduction de Pierre Bourdieu à des lycéens des séries ES dans le bassin du 93, en France.
Rendez-vous le 23 mai prochain pour le premier article de ce numéro 9.
[1] K. Marx, Le Capital, Livre I, Chapitre XXV. Voir :
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-25-3.htm
|
L’école (entre-)prise d’assaut
lundi, 19 avril 2010
/ Gérard Craan
|
En Belgique francophone [1], les organisations patronales ou des asbl sponsorisées rivalisent d’ingéniosité pour insuffler l’esprit d’entreprise dans l’enseignement primaire et secondaire. Elles sont également parvenues à faire modifier les programmes de cours afin que ceux-ci répondent à leurs besoins. Les pouvoirs publics, communautés et régions, ont toujours répondu favorablement.
Le risque de privatisation de l’enseignement public est régulièrement mis en évidence. La condamnation est souvent générale et floue parce qu’elle s’attache à dénoncer des négociations internationales : accords de Bologne, négociations sur le commerce des biens et des services (AGCS), lien entre les entreprises et la recherche universitaire, etc. Des organisations partisanes du démantèlement du public ou bien des lobbys sont généralement en embuscade : Commission européenne, Table ronde des industriels, OCDE, etc.
Ces tentatives peuvent être avortées grâce à de fortes mobilisations pour défendre les services publics.
Plus discrètement pourtant, la privatisation des esprits et des corps des jeunes têtes blondes est déjà bien lancée.
La première partie de cet article est consacrée aux opérations de séduction idéologique : comment injecter, de gré ou de force, l’esprit d’entreprise auprès des élèves ?
Du temps de cerveau disponible
Deux fondations soutenues par les pouvoirs publics s’adressent au monde enseignant avec l’objectif affiché de promouvoir l’esprit d’entreprendre. L’asbl Les jeunes entreprises vise à « donner le goût d’entreprendre aux jeunes » tandis que La fondation Free encourage le développement de l’esprit d’entreprendre au sein de la population francophone de Belgique. Concrètement, elle sévit dans l’enseignement.
Ainsi, l’asbl jeunes entreprises, au travers de quatre types de projets, aborde la question de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes de tous âges. Le plus connu de ces projets est sans doute la mini-entreprise, concept qui date du début du XXè siècle. En pratique, des jeunes inscrits dans les deux dernières années du secondaire, soutenus par leur professeur [2], tentent de concrétiser un projet marchand et de rendre leur entreprise viable. Bien entendu, ils ne sont pas rémunérés. La plupart des projets tourne autour de la vente de produits de confection sur base d’une fausse bonne idée. Il est également possible de céder une partie de ses bénéfices à une œuvre charitable [3].
2Mooi, het leven is mooi2
Officiellement, l’asbl les Jeunes entreprises porte des valeurs telles que la confiance en soi, la persévérance, la créativité, l’optimisme, la responsabilité, l’esprit d’équipe, l’autonomie et l’initiative. Un ensemble de très beaux principes dont on retiendra d’emblée qu’ils concernent quasi exclusivement l’individu. Mais en filigrane, on devine que l’asbl développe le mythe de l’inventeur-entrepreneur. Tout qui a une bonne idée et « sait gérer ses affaires » est voué à s’enrichir grâce au commerce. Chacun a sa chance.
Ces projets donnent une réalité complètement tronquée de l’entreprise dans un monde capitaliste. Créer une entreprise n’est pas simple. Le président de l’asbl, Chief Executive Officer à Fortis-BNP-Paribas, devrait savoir que les prêts bancaires se font plutôt rares. Mieux vaut souvent être fils de patron, avoir accès au réseau familial et avoir suivi des études supérieures pour devenir entrepreneur. Nulle part non plus, il n’est fait mention de la rémunération des travailleurs, de leurs conditions de travail, de l’environnement économique prédateur et, plus largement, de la destruction sociale et environnementale provoquée par de nombreuses entreprises, …
Bref : créer une entreprise, c’est cool.
Une des "innovations" de l’asbl s’adresse, elle, aux élèves de 5è et 6 primaire. C’est le projet DEEEP, pour "Développer l’Esprit d’Entreprendre dans l’Enseignement Primaire". Certaines des ses applications se consacrent au tour des commerces du quartier et/ou des métiers divers. Les témoignages des élèves évoquent le travail de l’agent de police, celui du pharmacien, tandis que sont présentés les métiers de cardiologue, conseiller-vendeur, et vétérinaire [4]. Les instituteurs bienveillants auront sans doute soigneusement évité de présenter les chômeurs du bistrot, les ouvriers à la chaîne, ou encore les pizzaïolos précaires. Il n’y a pas non plus d’explication quant à la pénibilité de certains métiers, ni même que nombreux sont ceux qui décrochent un job pour gagner leur vie plutôt que par choix.

Au total, l’asbl déclare toucher 6500 jeunes pour l’année académique 2007-2008. 6500 jeunes aux bons soins de Fortis, Deloitte, mastercard, UCB, Citibank, la Loterie Nationale, GSK, CBR, IBA, TNT ou encore Acerta. Tous sponsors de Jeunes entreprises.
Régions Wallonne et Bruxelloise, Commission Communautaire française ont toujours soutenu ces projets [5].
2Free your esprit2
Pour sa part, la Free fondation (On notera la volonté de rapprochement avec l’anglais tout en gardant le mot fondation en français), pour Fondation pour la Recherche et l’Enseignement de l’Esprit d’Entreprendre, a été créée sous le haut patronage du gouvernement wallon avec le soutien de sept figures emblématiques de l’entrepreneuriat : Monsieur Jean-Pierre Berghmans [6], le Baron Albert Frère [7], Monsieur Jean-Pierre Hansen [8], Monsieur Christian Jacqmin [9], le Comte Maurice Lippens [10], le Baron Jean Stéphenne [11] et Monsieur Francis Verheughe [12] et cinq sociétés fondatrices : Electrabel, Fortis Banque s.a., GlaxoSmithkline Biologicals s.a., Lhoist s.a., et Sonaca s.a. [13].
La Free fondation a pour objectif de fédérer et coordonner les initiatives prises en matière de développement de l’esprit d’entreprendre.
Elle entend associer le plus grand nombre de celles et ceux qui ont un intérêt manifeste au développement de l’esprit d’entreprendre : les acteurs publics comme les réseaux d’enseignement, les universités, les organismes de développement local ou les administrations, mais aussi les acteurs privés, comme les sponsors, les entrepreneurs, les entreprises, etc[dixit sa page... philosophie.
A en croire ses déclarations, FREE serait presque le nouvel acteur du développement économique de la Wallonie. Elle associe à son action les meilleurs spécialistes sans aucun autre critère que la compétence et a pour ambition de s’imposer dans le cercle des centres d’entrepreneuriat reconnus en Europe et dans le monde. Dans cette perspective, des contacts et des relais sont entretenus avec les grands centres étrangers [14] On croirait presque lire la page de présentation du Cercle de Lorraine.
Sur son site web, l’espace "enseignants" ne propose (heureusement) que quelques rares outils pédagogiques. Par contre, le portail foisonne de références bibliographiques élogieuse vis-à-vis de l’entreprise et de l’initiative individuelle : Entreprendre et réussir, Entrepreneurship as strategy, Guide pratique pour reprendre une entreprise, Innover pour prospérer, Le goût d’entreprendre au féminin, ou encore L’école du succès. Mais à destination des entrepreneurs. La plupart des ces références se trouvent en effet sur la partie du site destinée aux patrons. Le volet enseignants est beaucoup plus... pudique.
Craignait-on une réaction virulente de ces feignasses de profs fonctionnaires syndiqués ? Fédérer les ressources oui, mais pas pour tous.
Notons encore que le site de la fondation renvoie, pour la commande de certains ouvrages, vers le site www.zerolimite.ca, au look de marabout de l’entreprise et de la réussite individuelle. L’auteur de ces lignes ne résiste pas à l’envie de vous suggérer ce site à des fins de détente zygomatique. Il s’agit probablement des experts internationaux mentionnés plus haut.
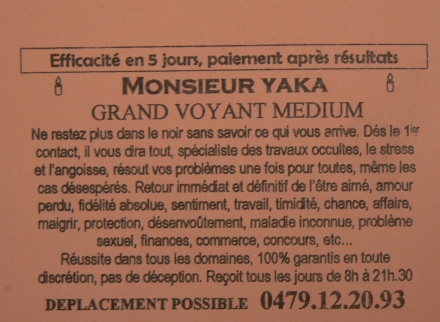
2Que de nobles desseins !2
Officiellement ces associations mettent en avant l‘esprit d’entreprendre dans le but de favoriser l’épanouissement personnel [parce que] Dans la vie, le plus "enrichissant" n’est pas l’argent qu’on gagne mais bien le développement de soi. [15]. C’est aussi fournir à la population et plus
particulièrement aux jeunes, la capacité de se mettre en projet dans une dynamique de vie. C’est oser ses envies de vie [16] Rien que ça....
La Free fondation souhaite carrément mettre fin à la sclérose de l’assistanat [17], tout cela de façon... apolitique [18].
Ces belles phrases cachent-elles autre chose que de la pure philanthropie, un amour de l’élévation de l’homme vers de hautes destinées ? Venant d’entreprises qui abusent de leur rente nucléaire, rackettent l’Etat et la collectivité au nom de leur "systémisme" bancaire, refourguent des vaccins pour apaiser la panique qu’elles ont elle-même créée, fraudent légalement grâce aux intérêts notionnels et, "naturellement", n’hésitent pas à licencier, la question est légitime.
En réalité, l’objectif est bien moins alambiqué : les entreprises ont besoin de main d’œuvre docile et de travailleurs prêts à se mettre en concurrence les uns contre les autres. De l’autre côté, l’Union européenne, dans sa constante rivalité avec les Etats-Unis, s’est mise en tête de devenir la zone la plus compétitive du monde : c’est la Stratégie de Lisbonne. Côté belge, qui n’a jamais entendu parler de la compétitivité de notre économie ? La Belgique cultive le même mythe capitaliste de l’esprit d’entreprise des avantages de la concurrence, etc [19].
Avec le soutien des pouvoirs publics, ces associations sont des outils de guerre idéologique : esprit d’entreprise, individualisation, entrepreneuriat, etc. Et tant pis si l’émancipation sociale, l’éducation, la culture, bref : tous ces trucs non-rentables, sont mis de côté. En parallèle s’esquisse la transformation des programmes des cours en fonction des besoins économiques. Ce qui est l’objet de la deuxième partie de cet article.
Gérard Craan
[1] La Flandre n’est pas en reste. A la pointe du combat pour une meilleur "adéquation" entre enseignement et business figure l’organisation patronale des classes moyennes, l’Unizo. Elle a développé un site internet relatif à cet aspect : ondernemendeschool.
[2] La mini entreprise peut également se faire durant les heures de pause ou après les cours
[3] Il n’y a pas de petit profit : Triodos est un des « partenaires » de l’asbl Les jeunes entreprises
[5] Il n’est pas facile de trouver trace des subventions accordées à ces différentes associations. Notons que, malgré ses multiples sponsors, l’asbl jeunes entreprises a reçu, en 2005, 50.000€ du Gouvernement de la Communauté française et la mise à disposition d’un chargé de mission. Le soutien à ces initiatives se marque aussi par des circulaires envoyées aux enseignants ou des prises de position publiques
[6] groupe Lhoist
[7] Compagnie Nationale à portefeuille
[8] Electrabel
[9] ex-Sonaca
[10] Fortis
[11] GlaxoSmithKline
[12] ex-Siemens Belgique, ancien président d’Agoria
[13] cf. le site de la « fondation ». Celui-ci mentionne sept sociétés fondatrices et non cinq. Il faut y ajouter la Compagnie Nationale à Portefeuille, le holding spéculatif d’Albert Frère, et Siemens Belgique-Luxembourg. A noter encore que ce site n’est que rarement actualisé, il mentionne encore la présence au Conseil d’administration de… Rudy Aernoudt en tant que… conseiller spécial auprès du Ministre de l’économie, des PME, de la recherche et des technologies nouvelles.
[14] loc. cit.
[16] Les deux dernières citations sont extraites de Entreprendre c’est oser ses envies de vie. 3 chantiers à… entreprendre pour faire progresser l’Esprit d’Entreprendre dans l’espace Wallonie-Bruxelles..., document/manifeste de la Free fondation remis aux parlementaires et présidents de partis en mai 2004. Le document est téléchargeable ici (pdf).
[17] ibidem
[18] loc. cit
[19] On en trouve de bons exemples dans le programme de réformes 2008-2010 de la Belgique dans le cadre de la stratégie de Lisbonne (pdf).
Initié fin 2001 par le gouvernement arc-en-ciel, le plan Activa avait pour objectif de créer de l’emploi, surtout pour les personnes les moins bien loties sur le marché du travail : les jeunes peu ou pas diplômés, et les plus de 45 ans (trop chers).
Depuis, ce plan d’embauche massif est toujours d’actualité, bien que la législation évolue sans cesse. Une sorte de plan Activa « de crise » a même été créé, portant le doux nom de plan Win-Win.
Le plan Activa vise à octroyer des réductions de cotisations ONSS aux employeurs qui embauchent ces chômeurs « difficiles à placer » [1]. Dans certains cas, une partie du salaire (jusqu’à 1100€), appelée allocation de travail est prise en charge par l’Onem, via les organismes de paiement (OP) [2], et versée directement aux travailleurs. La durée de ces avantages dépend de la situation du travailleur au moment de l’embauche : âge, durée du chômage, qualification… [3]
Arrêtons-nous d’abord sur la réalité vécue par les « bénéficiaires » du plan Activa. Souvent vanté comme un atout à rajouter sur le CV, le plan devient rapidement un obstacle à l’intégration sociale.
A peine embauché par l’employeur, le travailleur doit retourner à son OP pour remettre l’annexe au contrat Activa [4]. Cet organisme payeur mettra jusqu’à 2 mois pour traiter le dossier, et procéder aux paiements…difficile de s’en passer quand on sort du chômage. Par la suite, le travailleur devra tous les mois s’y rendre à nouveau, apporter un autre formulaire fourni par l’employeur, le C78 [5], afin de percevoir ses allocations entre le 1er et le 10 du mois [6].
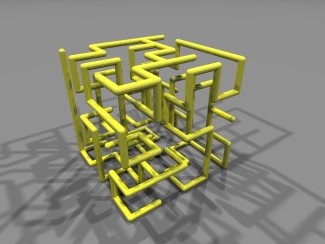
Bien entendu, inopinément, l’OP pourra stopper tout paiement sans en avertir le travailleur, pour cause de « dossier perdu à l’Onem », ou d’erreur commise par l’employeur sur l’annexe au contrat remise des années auparavant [7].
Enfin, lorsque l’avantage financier de l’employeur aura pris fin, le risque est grand de se voir licencié et remplacé par un autre plan Activa. Le seul rempart contre cet abus est le dépôt d’une plainte, ainsi que la constatation par l’Inspection du Travail que ces faits se sont produits à plusieurs reprises [8].
Bref : instabilité financière causée par des normes bureaucratiques parfois absurdes, assimilation au statut de chômeur (contraintes administratives, obligation de fréquenter le bureau de chômage), octroi d’une allocation de travail et non plus d’un salaire [9], instabilité de l’emploi,… : il s’agit bien de précarisation par le travail.
Ne soyons pas naïf, il s’agit surtout de cadeaux aux employeurs, leur permettant d’engager de la main d’œuvre à très bas prix. Mais même là, on est en droit de se demander si certains employeurs ne seraient pas défavorisés. La lourdeur administrative et la législation très changeante ne permettent pas à de petites PME d’y consacrer le temps et le personnel nécessaires.
Fort heureusement, pour s’y retrouver parmi toutes les « mesures pour l’emploi » existantes, un site web a été créé : www.autravail.be. Sonnant comme une injonction pour le chômeur, on constate pourtant rapidement que la très grande majorité des mesures détaillées n’offrent des avantages qu’aux employeurs, et non aux chercheurs d’emploi.

C’est également le cas du nouveau plan Win-Win, appelé ainsi car il ferait gagner tout le monde : le demandeur d’emploi et l’employeur, les jeunes et les âgés, l’Etat et l’emploi [10]. En y regardant de plus près, voici ce qui est vendu comme un avantage pour le demandeur d’emploi : Le travailleur est engagé comme travailleur ordinaire avec un contrat de travail classique et a droit à un salaire conforme au salaire fixé par la Convention Collective de Travail qui est d’application (…), aux avantages habituels, dans les conditions usuelles : bonus à l’emploi, complément de reprise du travail pour les plus de 50 ans, (…) [11]. Étrange de considérer des acquis de base minimum comme des avantages…
Avec la création des plans Activa, Win-Win et des autres [12], les gouvernements successifs avaient surtout pour préoccupation de donner l’impression qu’ils faisaient tout pour créer de l’emploi… en vain [13]. La stratégie de communication accompagnant ces plans, et particulièrement le plan Win-Win [14], cache hélas difficilement que le problème est ailleurs : enseignement et formation, crise financière, licenciements massifs, mal-être au travail,… autant de problématiques nécessitant des investissements importants dans des solutions structurelles à long terme.
Ariane Levêque
[1] Ce plan existe aussi pour les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale des CPAS.
[2] http://www.onem.be/frames/Frameset.aspx?Path=D_Partners/UI/&Items=3/1&Language=FR&Selectie=UI_Uitbetalingsinstellingen
[4] Divers formulaires existent selon la situation, un exemple : http://www.onem.be/D_Egov/Formulieren/Fiches/Bijlage_Activa/FormFR.pdf
[6] Il est possible pour l’employeur d’effectuer cette démarche directement sur internet, mais ce sont ici les problèmes informatiques en tous genres qui peuvent retarder les paiements
[7] Informations recueillies par témoignage. L’erreur de l’employeur était d’avoir exprimé les heures prestées chaque semaine en heures et minutes, et non en décimales, sur l’annexe au contrat
[8] Art. 12 de l’A.R. de promotion de mise à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée : http://www.rva.be/frames/Frameset.aspx?Language=FR&Path=D_opdracht_activa/Regl/Wetteksten/&Items=1/3/1
[9] On parle même d’activation d’allocation de chômage : http://www.onem.be/web_Embauche/frames/Frameset.aspx?Language=FR&Path=D_accueil/&Items=1
[10] http://www.milquet.belgium.be/fr/news/le-nouveau-plan-dembauche-massif-pour-les-demandeurs-demploi-wwwplanwinwinbe-a-tous-%C3%A0-y-gagner
[11] http://milquet.belgium.be/files/100118-Conf%C3%A9rence%20de%20presse-plan%20d%27embauche-partie%20modalit%C3%A9s.pdf
[12] Article 60, Programme de Transition Professionnelle, Plan Formation Insertion, Convention Premier Emploi,…
[13] Rappelons-nous les 200.000 emplois promis par Verhofstadt en 2003 : http://www.politiquessociales.net/Politique-nationale,3271, promesse contredite par les statistiques du SPF Economie, « indicateurs du marché du travail selon l’âge et le sexe » : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/index.jsp
[14] Voir à ce sujet le site web www.planwinwin.be, qui ferait presque penser à une publicité pour des assurances
La question de l’accès à l’enseignement supérieur fait l’objet d’une attention toute particulière en ces temps de refonte globale de l’enseignement supérieur dans le moule « Bologne ». Les différents « acteurs » du secteur (étudiants, enseignants, chercheurs, autorités académiques, autorités politiques) s’interrogent sur les moyens de garantir qui la gratuité, qui l’équité, qui l’efficience de cet enseignement et ce, dans le but d’une augmentation de l’accès aux études supérieures ou d’une réduction des inégalités sociales face à ces études.
Quelques exemples typiques de questions qu’ils se posent :
• peut-on diminuer le taux d’échec (surtout en première année) par des mesures pédagogiques ?
• peut-on intensifier les aides sociales pour permettre à plus d’étudiants issus de milieux défavorisés de fréquenter l’enseignement supérieur ?
• est-il faisable de mettre à niveau, de donner les « prérequis » aux étudiants qui ne les ont pas, à l’issue de l’enseignement secondaire ?
Les constats sont pour chacun de ces trois thèmes, effrayants. Dans cet article, je me consacrerai essentiellement à l’enseignement universitaire car c’est au sein de l’université que ces constats prennent leur ampleur maximale. Ainsi, le taux d’échec à l’issue de la première année à l’université semble inéluctablement figé aux alentours de 60%[1] malgré la mise en place d’initiatives de « promotion de la réussite » (guidances et tutorat individualisés, dispositifs de « mise à niveau », etc.). Les aides sociales arrivant en aval des processus d’orientation et de choix des études, seule une infime portion des étudiants qui pourraient en bénéficier entament les procédures menant à leur octroi ; tout assouplissement des critères d’octroi de ces aides a dans ce cadre un impact forcément par trop limité : les potentiels étudiants issus des milieux les plus défavorisés ont déjà renoncé aux études avant d’avoir envisagé la possibilité de bénéficier d’une aide sociale. Les inégalités de niveau dans l’enseignement secondaire qui vont largement de pair avec les inégalités socioculturelles et socioéconomiques sont telles que l’effet des mesures de « propédeutiques » (cours de remise à niveau visant à donner les « prérequis » aux études) devient quasi-négligeable.
Ces questions paraissent donc extrêmement pertinentes et chacune doit nécessairement trouver réponse. Néanmoins, les considérer isolément, comme le font nombre d’acteurs, implique nécessairement de mettre au point des mesures qui rapidement se révèlent inadéquates. En effet, participant d’un morcellement d’une problématique, elles empêchent de poser une question nettement plus fondamentale : comment casser les mécanismes de reproduction des élites via l’enseignement supérieur ? Tant que le problème n’est pas envisagé de cette manière, les réponses apportées demeurent irrémédiablement parcellaires et par là, inopérantes.
Parmi les implications d’un questionnement de cet ordre surgit la (re)définition de l’objectif même de l’enseignement supérieur et singulièrement de l’université. Et donc le projet politique dont l’enseignement supérieur est porteur. Or ce projet politique est, à ce jour, tout sauf clair dans les discours des « acteurs ».
Petite historique de l’université « massifiée »
Avant de proposer des pistes de réponse, il paraît crucial de revenir quelques instants sur plusieurs notions qui reviennent de manière récurrente dans le discours politique en matière d’enseignement, sans que leur sens ne soit toujours explicité, ce qui contribue sans doute à la difficulté de l’élaboration d’un projet politique clair.
Première notion fréquemment utilisée, celle de la massification. Elle trouve son origine dans les politiques publiques menées dans les années 60 visant à accroître l’accès à l’enseignement. Ces politiques publiques se fondaient à la fois dans les travaux d’économistes de l’école du "capital humain", qui considéraient l’éducation comme un moyen d’accroître la croissance économique, dans les demandes des firmes en main d’œuvre qualifiée et dans les « attentes des familles ». L’objectif de ces politiques était donc clairement utilitariste. En Communauté française de Belgique, les politiques de massification se concrétisèrent notamment en une augmentation du nombre de bourses du Fonds national des Etudes, destinées à soutenir les étudiants de condition peu aisée et bien doués et à l’assouplissement des critères académiques présidant à cet octroi.
Pourtant, dès le milieu des années 60, il est apparu évident que l’université massifiée ne s’était pas démocratisée ! En effet, les classes sociales défavorisées étaient (et sont toujours) largement sous-représentées à l’université, et plus largement dans l’enseignement supérieur. Comme le mirent en évidence les sociologues Jean-Claude Passeron et Pierre Bourdieu, le dispositif pédagogique est en lui-même vecteur d’inégalités : tant les modes académiques de transmission des savoirs que les procédures d’évaluation renforcent l’impact des facteurs sociaux sur les curricula des étudiants et participent à un mécanisme de reproduction des élites [1].
Suite au ralentissement brutal de la croissance au milieu des années 70 et à une diminution importante de l’activité économique, le chômage des diplômés du supérieur apparaît. Ce phénomène a inquiété plusieurs économistes dont le plus célèbre est sans doute l’américain Freeman, auteur d’un essai intitulé The Overeducated American. Ces économistes plaidèrent pour une limitation du nombre de diplômés afin d’éviter un phénomène de « saturation » du marché de l’emploi. Avec la montée en puissance des néoconservateurs et l’arrivée au pouvoir de Reagan aux Etats-Unis et de Thatcher au Royaume uni, ces thèses trouvent une concrétisation politique sous forme de plans d’économies drastiques imposés notamment à l’enseignement supérieur.
Entre 1972 et 1988, l’allocation moyenne par étudiant (à prix constants) des universités belges diminua de près de 44% [2]. En parallèle, les universités furent obligées de résorber leur déficit budgétaire chronique (Arrêté royal du 31 juillet 1982). En particulier, les services sociaux universitaires durent limiter drastiquement le niveau et le nombre des bourses qu’ils octroyaient : le montant des bourses ne fut plus indexé, un critère de nationalité pour l’octroi des aides fut introduit dans toutes les universités.
Avec ces plans d’économie apparut progressivement une inquiétude pour « l’efficience » de l’enseignement supérieur. Plusieurs organismes internationaux (l’OCDE, l’UNESCO, la Banque Mondiale, etc.) et lobbies (comme la Table Ronde des Industriels européens, la Conférence des Recteurs d’Europe) suggèrent dans des publications la nécessité d’une "modernisation" du système d’enseignement supérieur [3]. Ainsi vit jour le Processus de Bologne, dont le but est d’accroître la compétitivité de l’enseignement supérieur européen et donc de l’inscrire dans un marché mondial de l’enseignement supérieur. Globalement, les universités sont amenées à se « rapprocher » des préoccupations du « marché de l’emploi » et à doter leurs étudiants de compétences (skills) directement opérationnalisables sur ce marché.
Dans ce contexte, plusieurs auteurs proches de la Commission européenne annoncent la fin de la massification [4] : il convient désormais de « cibler les investissements » sur les « meilleurs étudiants ». L’initiative « Erasmus Mundus » qui permet à des étudiants non-européens triés sur le volet d’avoir accès aux filières « d’excellence » des universités d’Europe préfigure, à cet égard, l’avenir de l’Espace européen d’enseignement supérieur. Un peu partout en Europe, les universités sont progressivement privatisées (sous forme d’une « autonomisation de gestion », rapidement suivie d’un retrait des subsides publics). En conséquence, elles augmentent largement les frais d’inscription qu’elles exigent. En parallèle, le débat de l’orientation des étudiants fait rage : ne faudrait-il pas les orienter préférentiellement vers les filières porteuses en matière d’emploi, comme le suggère en Communauté française de Belgique, le Ministre socialiste Jean-Claude Marcourt ?
En matière d’implications concrètes en Communauté française de l’avènement de « l’Espace européen d’enseignement supérieur », on observe de manière croissante la dualisation des filières, entre filières d’études nationales, réservées à la majorité des étudiants et filières d’études internationales, destinées aux étudiants « mobiles » majoritairement issus de l’élite socioculturelle et socioéconomique. La faiblesse des fonds sociaux disponibles ne peut absolument pas contrebalancer ce phénomène, d’autant que les priorités des autorités académiques en termes d’affectation de ces fonds est de garantir l’attractivité de l’institution vis-à-vis de ces étudiants mobiles – ce que permet la quasi-absence de contrôle public sur l’affectation des fonds sociaux des institutions.
Reproduction des élites via l’enseignement supérieur : évidences, mécanismes
Après ce bref historique de la massification, revenons à la question de la reproduction des élites par l’enseignement supérieur. La sous-représentation des classes sociales défavorisées dans l’enseignement supérieur de la Communauté française est l’une des plus criantes d’Europe [5]. Alors que ces classes représenteraient près de 45% de la population active en Belgique, moins de 20% des étudiants en seraient issus.
Notons qu’il ne suffit pas de poser ce constat pour en trouver les origines ! Trop souvent, la théorie de la reproduction est de la sorte assimilée à une sorte de truisme qu’est l’évidente sous-représentation des classes sociales moins favorisées dans les populations étudiantes du supérieur. Cette assimilation permet une dénaturation lente du modèle bourdieusien, progressivement déconnecté de son origine empirique dont la mémoire s’étiole. Il sort du cadre de cet article de procéder à l’exégèse des thèses de Bourdieu, je me consacrerai donc à l’étude de mécanismes de la reproduction telle qu’elle s’ancre dans la réalité des universités de la Communauté française en particulier.
Typiquement, la Communauté française a prévu deux grandes sources de financement pour les étudiants défavorisés : les allocations d’étude et l’aide sociale des services sociaux des institutions. Il est impossible de décrire ici ces deux dispositifs de manière exhaustive. Je me bornerai à relever quelques éléments qui démontrent leur inadaptation pour contribuer à une augmentation de la démocratisation de l’enseignement supérieur.
En matière d’allocations d’études de la Communauté française, deux critiques immédiates peuvent être formulées : les plafonds de revenus au-delà desquels l’étudiant n’a pas droit à une allocation sont largement trop bas (à titre d’illustration, dans le cas d’une famille avec deux enfants à charge dont un aux études supérieurs, le plafond dépasse de 12% le seuil de pauvreté) et le montant de la bourse moyenne octroyée aux étudiants (environ 780€ par an) est totalement dérisoire en comparaison avec les coûts d’une année d’études supérieures (le loyer moyen d’un kot en cité universitaire est de 265€ par mois à Bruxelles). Notons qu’entre 1986 et 2008, le montant moyen de l’allocation a diminué de près de 46% par rapport à l’indice des prix, ce qui démontre la politique de désinvestissement suivie par les pouvoirs publics en la matière. Au-delà de ces chiffres, notons que l’octroi de l’allocation d’études dépend du mérite académique de l’étudiant ! En effet, un étudiant boursier ne peut bisser qu’une année du premier cycle pour conserver le bénéfice de son allocation d’étude.
Les aides sociales octroyées par les institutions sont, généralement, résiduaires. Les services sociaux constituent donc un « dossier social », déterminent « l’ampleur » des besoins de l’étudiant et interviennent uniquement pour les dépenses « à vocation académique » (syllabi et matériel scientifique, transports en commun, repas du midi, kot, connexion internet). Là aussi, l’ampleur de l’aide reste largement insuffisante (maximum 480€ pour les institutions les plus « généreuses »), vu la faiblesse des fonds disponibles. Les politiques sociales étant du ressort de chaque institution, le niveau de cette aide connaît également des disparités très importantes. De manière générale, les institutions d’enseignement supérieur imposent également des conditions académiques. Les plus « sociales » ne subsidient pas les étudiants en situation de triplement sans réorientation ou de quadruplement, les plus « élitistes » suspendent l’intervention dès le premier échec.
On l’aura compris, les conditions d’octroi des aides sociales disponibles en Communauté française de Belgique restent largement marquées par la promotion du mérite académique. Or l’échec est largement corrélé à l’origine sociale des étudiants, ce qui implique que ces aides sociales soient inefficaces en terme de démocratisation de l’enseignement supérieur.
L’orientation est également un enjeu crucial en matière d’accès à l’enseignement supérieur. Actuellement, il n’existe pas en Communauté française d’organisme unique et étatique chargé de cette question. Comme conséquence, toutes les institutions d’enseignement supérieur disposent de leurs propres services d’orientation, dont l’optique est évidemment biaisée par les politiques institutionnelles en matière de recrutement d’étudiants. Il faut remarquer que, globalement, les étudiants issus des milieux plus défavorisés s’orientent préférentiellement vers les études de type court et, plus généralement, vers les études hors université. Outre le lien entre longueur des études et coût des études, un des facteurs expliquant ce phénomène est la dynamique de « réorientation » mise en place au sein des « pôles » d’enseignement supérieur. En effet, dans le cadre des mécanismes censés « promouvoir la réussite », les étudiants ont la possibilité de discuter de leurs difficultés académiques avec des conseillers d’orientation. Toutes les universités procèdent sur un même modèle en la matière : les étudiants qui sont en situation d’échec dès le premier semestre de leur première année se voient systématiquement conseiller d’entamer des études dans l’enseignement hors université et, si possible, de type court. Ces mécanismes de relégation ont même été officialisés dans le cadre d’une initiative subsidiée par les pouvoirs publics et ironiquement nommée tremplin.
Toujours dans le cadre de la « promotion de la réussite », des tests facultatifs accessibles aux étudiants de première année sont organisés de plus en plus tôt dans l’année académique. Ces tests, supposés permettre à l’étudiant de « s’auto-évaluer », sont évidemment un formidable outil de diagnostic des inégalités de niveau de l’enseignement secondaire, qui sont directement liées aux inégalités socioéconomiques et socioculturelles, les meilleurs écoles secondaires étant réservées aux plus nantis. Que fera l’étudiant confronté à un échec ? Il pourra prendre rendez-vous avec un conseiller d’orientation qui lui proposera un « tremplin » pour sauter… hors de l’université ! Ou alors, il pourra se rendre aux « guidances », dont la gestion est souvent laissée à des étudiants de second cycle, n’ayant pas été formés pour remplir cette mission et reproduisant dès lors les méthodes pédagogiques auxquels ils ont été confrontés lors de leurs études.
Dans la continuité de ces initiatives, l’idée d’un test facultatif avant l’entrée dans le supérieur fait du chemin parmi les responsables académiques et politiques, histoire d’augmenter encore l’efficacité du processus de relégation.
L’avantage du système de « tests facultatifs » est qu’il donne l’apparence d’une scientificité à un mécanisme qui procède d’une escroquerie intellectuelle : présentant les savoirs comme indépendants, le dispositif académique comme neutre, ils permettent de persuader l’étudiant que l’échec est dû à ses capacités intrinsèques.
Au-delà de cet exemple éclairant et de manière plus générale, le dispositif pédagogique à l’université demeure ancré dans une doxa méritocratique. L’université prétend toujours traiter comme « égaux en droits » des étudiants inégaux de fait parce qu’inégalement préparés à la confrontation avec le discours universitaire. Ce faisant, elle entend sélectionner les plus « méritants » et les plus « doués », ce qui revient en réalité à opérer une sélection sociale sévère en la travestissant sous des dehors « objectifs ».
On voit dès lors que réduire les freins financiers d’accès à l’université n’a pas de sens pour réduire les inégalités sociales si une refonte simultanée du dispositif pédagogique n’est pas menée. En d’autres termes, pour garantir une démocratisation de l’université, il faut briser les mécanismes de la reproduction dans l’ensemble des dispositifs (d’action sociale, d’orientation et pédagogique) qui s’y articulent.
Que faire ?
Dans le cadre de cet article, il n’est pas question de proposer un catalogue de mesures concrètes. Néanmoins, j’aimerais suggérer quelques pistes de réflexion permettant de tendre vers une université démocratisée. Il va de soi qu’un tel projet s’éloigne fortement à la fois de la vision utilitariste de l’enseignement supérieur et en particulier du modèle d’université de marché actuellement très à la mode. Afin d’atteindre l’université démocratisée, il faut donc en finir avec trois concepts mystificateurs : le talent, l’effort, le mérite.
En finir avec la mystification du « talent », c’est renoncer à cette idée fortement enracinée que certains étudiants sont plus « doués » pour les études. Cela implique de refondre totalement les premières années dans l’enseignement supérieur notamment en diminuant l’exigence de « prérequis » à l’entrée de l’institution. Il est possible, dans de nombreuses matières, de reprendre les « outils de base » en les liant à une approche disciplinaire afin d’en expliciter clairement l’usage à l’étudiant. En parallèle, il faudrait mettre au point des mécanismes de guidance et de tutorat pensés pour permettre la transition entre enseignement secondaire et supérieur et présentés comme tels – ce qui implique d’intensifier les liens entre ces deux niveaux d’enseignement. Enfin, et plus fondamentalement, toutes les procédures d’évaluation nécessiteraient d’être profondément retravaillées pour en réduire la dimension arbitraire. Ce débat qui était central dans les revendications des étudiants de l’Université libre de Bruxelles en Mai ’68 a hélas été totalement obturé dans les réflexions sur la pédagogie universitaire, devenant un tabou manifeste en Communauté française de Belgique.
En finir avec la mystification de « l’effort », cela signifie d’arrêter de considérer les études comme un labeur et de demander à l’étudiant de souffrir pour atteindre le « Graal » de la connaissance. Concrètement, cela implique que les professeurs ne soient plus chargés d’évaluer ou plus encore, de sélectionner les étudiants mais bien de transmettre leur « passion » pour un domaine de recherche. Repenser les programmes d’études pour qu’ils permettent de véritables échanges entre les chercheurs et les étudiants dans cette dynamique de transmission d’un intérêt pour une discipline, ce qui suppose notamment de ne plus utiliser les cours de statistiques comme filtre en première année et de ne plus placer tous les cours intéressants dans le second cycle ! Cela signifie également la destruction pure et simple de tous les mécanismes institutionnalisés de relégation dont les systèmes de réorientation de type « tremplin ». Cela signifie enfin de ne plus promouvoir le job étudiant comme mesure de financement des études – et, en la matière, il faut noter que le Gouvernement fédéral s’apprête à suivre exactement la voie inverse.
Enfin, en finir avec la mystification du « mérite », cela signifie la suppression de toutes les contraintes académiques dans l’octroi des aides sociales. Cela signifie aussi de refuser les traitements faussement égalitaires des étudiants et de penser des mesures adaptées aux situations sociales difficiles. Une mesure de cet ordre mise en place à l’Université libre de Bruxelles a été l’accompagnement systématique des étudiants usagers du CPAS par des assistants sociaux du service social étudiant dans leurs démarches et leurs négociations avec leur CPAS. Une généralisation de ce type de pratiques semble une voie particulièrement intéressante en ce qu’elles signifient également pour l’étudiant accompagné qu’il est membre à part entière de la communauté universitaire et que l’université peut se mobiliser autour de lui.
De manière plus profonde, une université démocratisée ne peut se concevoir dans une société inégalitaire. Démocratiser l’université, c’est donc nécessairement la pousser à s’engager dans les combats sociaux.
[1] Bourdieu, P. et Passeron, J.-C. (1964) Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Paris : Editions de Minuit, et Bourdieu, P. et Passeron, J.-C. (1970) La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris : Editions de Minuit.
[2] Bayenet B. (2000), Le financement de l’enseignement universitaire en Communauté française, in Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1668-1669, Bruxelles : CRISP
[3] A titre d’exemple :
– Commission des Communautés européennes (1991), Mémorandum sur l’enseignement supérieur dans la Communauté européenne, Task force Ressources humaines, Education, Formation et Jeunesse, COM(91) 349, Bruxelles, décembre 1991.
– Commission Européenne (1995), Enseigner et apprendre : vers la société cognitive, Livre blanc sur l’éducation et la formation, DGXXII, Bruxelles.
– ERT (1989), Education and European competence in Europe, Bruxelles, février 1989.
– ERT (1995), Education for European : Towards the Learning Society, Bruxelles, 1995.
– UNESCO (1995), Policy Paper for Change and Development in Higher Education, Paris : UNESCO.
– World Bank (1994), Higher education : the lessons of experience, Washington DC : Banque mondiale.
– Thys-Clément, F., Weber, L., et Balling, M. (1997), Cinq pistes pour améliorer le financement des Universités, in CRE DOC, n° 2, février 1997.
– Pour une revue plus large des publications des différents lobbys : De Meulemeester, J.L. et D. Rochat (2001), Reforming Education and Training Systems : the European View, in Reflets et perspectives de la vie économique, tome XL, n° 4, pp. 89-104.
[4] Le principal auteur annonçant la post-massification est Guy Haug. Haug, G., "Visions of a European Future : Bologna and Beyond", contribution à la 11ème Conférence de l’European Association for International Education, Maastricht, 3 décembre 1999.
[5] Voir, par exemple, l’enquête Eurostudent 2000
Le cours de religion a-t-il sa place à l’école ? Enseigner une croyance en tant que telle et des dogmes fait-il partie des attributions de l’école ? Une distanciation face aux convictions (de quelque nature qu’elles soient [1]) n’est-elle pas une des conditions nécessaires à la construction de la personnalité des enfants dont l’école à la charge ?
« La nature et le rôle de l’enseignement religieux à l’école sont aujourd’hui l’objet de débats et, en certains cas, de nouvelles réglementations civiles, qui ont tendance à le remplacer par une étude du fait religieux en général, ou de morale et de culture religieuse, allant jusqu’à s’opposer au choix et à l’orientation que les parents et l’Eglise désirent donner à la formation des générations futures », ainsi débute la communication du Vatican aux présidents des conférences épiscopales sur l’enseignement de la religion à l’école [2].
Et, plus loin : « L’enseignement de la religion à l’école trouve sa place dans la mission évangélisatrice de l’Eglise [3] (…) Pour sa part, l’Eglise, exerçant le service (diakonia) de la vérité au sein de l’humanité, offre à chaque génération la révélation de Dieu, par laquelle nous pouvons apprendre les vérités ultimes sur la vie et sur le sens de l’histoire [4] ».
Les motivations de l’Eglise sont limpides ; il s’agit d’orienter l’éducation des enfants en fonction de ses souhaits, pour satisfaire à la mission qu’elle s’est attribuée, à savoir, l’évangélisation de la population. Selon le Vatican, l’école doit proposer un cours de religion pour que chaque élève ait la possibilité d’accéder au message catholique.
Une mission d’endoctrinement ?
Est-ce là le rôle de l’école [5] ?
Le cours de religion n’est évidemment pas le seul du cursus scolaire à être potentiellement porteur d’idéologie. Tout enseignement véhicule une part plus ou moins importante de subjectivité qui est fonction du programme scolaire, de l’école et du professeur qui enseigne la matière. Certains cours sont d’ailleurs régulièrement la cible d’attaques visant à y intégrer un contenu idéologique [6].
Le cours de religion se distingue cependant des autres disciplines en ce qu’il enseigne une croyance. Les autres cours s’en écartent radicalement puisqu’ils ont pour objet le développement d’aptitudes (intellectuelles, artistiques ou physiques), de la réflexion et du sens critique ainsi que la connaissance du monde qui nous entoure. Ces cours peuvent véhiculer (et le font souvent) certaines doctrines mais, contrairement, à l’enseignement d’une religion, l’idéologie n’en est pas la substance.
Condorcet [7] définissait ainsi la fonction de l’école : « Offrir à tous les individus de l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d’assurer leur bien-être, de connaître et d’exercer leurs droits, d’entendre et de remplir leurs devoirs (…) et par là établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi » [8].
Pour lui, « Si l’instruction doit devenir publique, l’éducation, en revanche, doit rester privée ».
Cette précision est fondamentale : « Il faut distinguer clairement l’éducation, qui comprend formation physique, affective, intellectuelle et morale en général, de l’instruction proprement dite, qui n’en est qu’une partie. Pour ce qui est de l’éducation au sens large, chacun a droit au respect de ses convictions métaphysiques. La famille, l’Eglise s’en chargent déjà. (…) Pour ce qui est de l’instruction en revanche, l’école doit prendre en main tous les citoyens, sans exception, et les instruire de tout ce qui rend la responsabilité possible, c’est-à-dire de ce qui érige et consolide la citoyenneté politique : lire, écrire, compter, comprendre le fonctionnement des institutions, sans quoi l’on remet à d’autres sa liberté de jugement et de choix, principes moraux de base reconnus par toute éthique » [9]
L’école détournée de sa fonction
Le but premier de l’école, si l’on se soucie de l’intérêt de l’enfant, est donc de former des individus capables de penser seuls et de permettre une égalité des possibilités à chacun d’entre eux.
Cet objectif est régulièrement détourné par divers acteurs (politiques [10], religieux, les entreprises [11], entre autres) et l’école actuelle (en tant qu’institution) reflète de moins en moins ces préoccupations [12].
Entre ses fonctions de simple instrument de reproduction des schémas sociétaux, de vivier de travailleurs qui doivent répondre aux besoins du marché du travail, d’outil de stratégie du pouvoir politique en place [13] entre autres, l’intérêt des élèves est particulièrement malmené et le rôle de l’école de plus en plus fréquemment dévoyé.
Toutes ces évolutions donnent l’illusion d’une diversification des possibilités de filières et, par là, du choix [14] de l’enfant (et/ou de ses parents). En réalité, elles déterminent de plus en plus tôt la vie de l’individu en tronquant la formation de base d’éléments indispensables à la construction d’une personne capable de penser par elle-même et des outils nécessaires à l’élaboration de choix futurs. On est bien loin des préoccupations de Condorcet.
La pensée sous tutelle
Ces intrusions multiples dans l’orientation de la formation à donner aux élèves atteignent leur apogée dans l’enseignement d’une croyance.
En la matière, qu’il s’agisse de l’interventionnisme de l’Etat, des autorités religieuses ou des parents, c’est le choix de l’enfant à penser par lui-même qui lui est confisqué ; l’élève, citoyen en devenir, est toujours soumis à une autorité supérieure.
La croyance ne s’impose pas, elle doit être le fruit d’un choix personnel. Un choix est consécutif à une collecte d’informations et à un processus de réflexion [15], éléments censés être apportés par le programme complet de l’école. L’Etat a fixé la maturité politique de l’individu à 18 ans [16], ne devrait-il pas en être de même de la maturité philosophique et religieuse ?
Si, a contrario, on décide que la propagation de croyances fait partie des attributions de l’école, où s’arrête-t-on ?
Dans cette optique, pourquoi (et au nom de quoi) limiter les religions enseignées aux seules religions dominantes [17] et, surtout, pourquoi restreindre les croyances aux seules religions [18] ? Pourquoi ne pas proposer un cours de platonisme, de positivisme, de nihilisme, d’ascétisme, de matérialisme, de déisme ou d’hédonisme (entre autres) dans la palette des convictions représentées ?
Manifestement, les croyances enseignées sont celles qui sortent gagnantes du rapport de forces à l’œuvre dans une société donnée et ne peuvent avoir comme conséquence que la reproduction de la société qui le génère.
Dans l’intérêt de l’enfant ?
Le pluralisme perverti
En outre, à partir du moment où les croyances ont droit de cité à l’école, pourquoi les limiter au seul cours ad hoc ?
On observe d’ailleurs des tentatives d’introduction d’une suprématie [19] de certaines croyances religieuses à l’école dans les programmes scolaires généraux de plusieurs pays européens [20]. D’une tentative originelle de pluralisme philosophique, on aboutit à une contamination de l’ensemble des cours par la croyance.
A ce sujet, il est intéressant de noter que seules les écoles publiques proposent le choix entre des cours de différentes religions et un cours de morale [21], les écoles confessionnelles ne proposent pas de pluralisme philosophique. De même, en Belgique, le cours de morale est dispensé par des enseignants désignés par les pouvoirs organisateurs de l’école publique tandis que ceux des cours de religion le sont par les organes chefs de culte respectifs [22]. Une « ouverture » à sens unique ? Dans l’intérêt de l’enfant ?
A ce propos, le point de vue du Vatican est édifiant ; il affirme : « le projet de l’école catholique est convaincant seulement s’il est réalisé par des personnes profondément motivées (qui) se reconnaissent dans l’adhésion personnelle et communautaire du Seigneur [23] ».
Le Vatican juge également indispensable que les enseignants de tous les cours des écoles catholiques soient de sa confession : le préfet de la congrégation pour l’éducation catholique [24] le martelait lors d’une conférence de presse au Vatican [25] : « Etre un bon enseignant ne suffit pas (…) Toutes les matières qui contribuent à la formation de la personne humaine doivent être accompagnées d’un témoignage de vie correspondant » [26].
A côté de ceci, il est important de rappeler que le cours de morale n’est pas à mettre sur le même pied que les cours de religion, il n’équivaut pas à un cours d’athéisme ; ne pas parler de Dieu n’est pas nier son existence.
Le cours de morale a la vocation de sensibiliser l’enfant aux valeurs humaines par la réflexion. En conséquence, dans la situation actuelle, où les cours de religion coexistent au côté du cours de morale [27], le remplacement du cours de morale par le cours de religion retire des éléments fondamentaux de la formation de l’élève.
Des solutions illusoires
Non seulement, l’enseignement d’une religion constitue une intrusion dans le libre choix futur de l’élève mais, avec la "pluralisation" croissante de la société, cette manière d’organiser les choses n’est pas tenable [28]. Cette difficulté se reflète dans les changements d’organisation de l’école opérés ces derniers temps par divers pays [29] et dans les recours de plus en plus fréquents introduits par certains parents pour dispenser leurs enfants des cours religieux et philosophiques.
De plus en plus de parents, ne se reconnaissant dans aucune des confessions proposées invoquent leur droit à la différence pour revendiquer un type d’école correspondant à leur image et voué à leur stricte reproduction. Des parents refusent que leurs enfants suivent les cours de religion et de morale [30]. En outre, certains enfants, inscrits à des cours de confession minoritaire, voient certains de leurs cours généraux supprimés étant donné les difficultés d’organisation et de financement de ces cours [31].
Dans l’intérêt de l’enfant ?
Une étude de la pensée plutôt que l’enseignement de croyances
Les résultats du projet de recherche de la Commission européenne, Redco [32], indiquent que les élèves à qui on enseigne une diversité de religions sont plus enclins à discuter de sujets religieux ou philosophiques avec des élèves issus d’un autre arrière-plan religieux ou convictionnel (que ceux qui ne reçoivent pas ce type d’enseignement) [33].
La solution ne réside-t-elle pas là ? Intégrer dans le cursus scolaire une histoire de la pensée qui inclue les courants religieux. D’une manière transversale, en intégrant ces éléments dans d’autres cours (comme le cours d’histoire, entre autres) ou par la création d’un cours obligatoire pour tous, dans l’enseignement public comme libre, qui passe en revue et étudie, de façon distanciée, la pensée dans un contexte historique, et qui englobe à la fois les différents courants philosophiques et religieux. Et qui remplace les cours de religion.
Il ne s’agit pas de faire de ce cours l’étendard d’autres convictions (telles que l’athéisme, par exemple [34]) ; il ne revient pas à l’école d’expliquer le non-connaissable, l’immatériel ni de mener des combats idéologiques en ce domaine.
Ce cours doit être neutre pour permettre à l’enfant de développer sa philosophie personnelle et à la société d’être composée d’individus critiques.
En cela, l’approche est primordiale ; par la confrontation des différents courants de pensée au programme scolaire, l’élève sera obligé d’adopter une démarche critique et analytique et développera sa réflexion. Il y gagnera également une meilleure connaissance de la diversité et, ce faisant, la capacité de se remettre plus facilement en question.
Ce cours ne doit pas remplacer le cours de morale mais venir compléter la formation générale de tous les élèves. Dans l’intérêt de l’enfant.
Conclusion
La présence du cours de religion à l’école reflète plus le poids politique de l’Eglise (et des autres religions) qu’une réflexion sur les matières à enseigner [35].
Le cours de religion, en tant que croyance enseignée et imposée, n’a pas sa place à l’école. Non seulement, il entrave la réflexion philosophique de l’enfant mais il engendre une confusion entre fait et croyance. Ce faisant, en lui imposant une idéologie, il le maintient dans un état d’immaturité et le déresponsabilise. Il provoque également une communautarisation a priori des élèves, avant même que ces derniers disposent de la capacité de réellement choisir une voie philosophique.
Il est grand temps de dépassionner le débat ; l’école n’est pas le lieu où doivent s’exprimer les clivages de la société mais bien celui où doit s’opérer l’émancipation des enfants.
Naturellement, le développement serein de la réflexion de l’élève est assailli par d’autres influences. Et des éléments supplémentaires de connaissance devraient être introduits dans le programme scolaire pour satisfaire pleinement à cette mission [36].
La croyance a cependant sa place dans l’histoire de la pensée (globale donc à la fois religieuse et philosophique). Il est important qu’elle soit enseignée. Mais de la même façon que les autres matières du cursus scolaire, avec recul. En ce sens, la distinction actuelle qui prévaut entre enseignement séculier et confessionnel n’a pas de sens.
« La mission de l’école, c’est de faire apprendre, en vue d’être un membre actif de sa société au lieu d’en être exclu (…) Le véritable but de l’enseignement, c’est l’émergence de la pensée personnelle, c’est-à-dire ‘le pouvoir d’examiner, de comprendre, de juger (Reboul, 1997, p.102) ; autrement, nous endoctrinons. En ce sens, ‘l’enseignement véritable ne va pas sans le développement de l’esprit critique (Reboul, 1984, page 158) » [37].
Eponine Cynidès
[1] Religieuses, philosophiques, politiques, etc…
[2] http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20090505_circ-insegn-relig_fr.html
[3] point 17
[4] page 9
[5] Le présent article s’intéresse à l’école primaire et secondaire, uniquement, qui correspondent, en gros aux années d’étude pendant lesquelles les élèves sont mineurs
[6] Par exemple, en France, la loi du 23 février 2005 prescrit d’enseigner « le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». Un « ‘devoir de mémoire’ bien amnésique » comme le dénonce la Ligue des Droits de l’Homme [[http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article767
[8] Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique (http://www.sceren.fr/laicite/pdf/Condorcet_rapport.pdf)
[9] Bernard Jolibert, « Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée, Paris, Unesco Bureau international d’éducation, vol. XXIII, n°1-2, 1993, p.201-213, http://www.ibe.unesco.org/publications/thinkerspdf/condorcf.pdf
[10] Pour ne citer que quelques exemples : dès 1969, l’enseignement rénové faisait son entrée certaines écoles belges (http://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/volltexte/2008/785/pdf/De_Keyser_Histoire.pdf), on évoque depuis quelque temps la suppression des cours de géographie et d’histoire pour la filière du bac scientifique en France (http://www.marianne2.fr/Exclusif-Chatel-veut-supprimer-l-histoire-geo-en-terminale-S_a182876.html) et certaines écoles belges ont récemment mis des cours de permis de conduire à leur programme (http://www.enseignons.be/actualites/2008/01/26/permis-de-conduire-a-l%E2%80%99ecole-ca-cale).
[11] Depuis la fin des années 80, l’enseignement se soumet de plus en plus aux demandes des entreprises, dans les pays industrialisés. Lire à ce sujet « L’école prostituée » de Nico Hirt, Bruxelles, 2001, Editions Labor / Editions Espace de Libertés
[12] Cette tendance prononcée n’épargne d’ailleurs pas les études supérieures (http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100408.OBS2098/dans-newsweek-la-fin-des-humanites.html)
[13] « Le dernier effet d’annonce de Nicolas Sarkozy, l’injonction de lecture de la lettre de Guy Môquet dans tous les lycées de France, à chaque rentrée scolaire, n’a rien d’étonnant et peut être interprété à travers une double grille de lecture : le pli désormais pris d’instrumentaliser l’histoire, dans une stratégie d’abord électoraliste, et aujourd’hui présidentielle (et) l’appel à une vision de l’école sanctuarisée et dont on renforcerait la mission civique, à charge pour elle de revitaliser le sentiment national (Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire, mai 2007, http://cvuh.free.fr/spip.php?article94)
[14] Cfr. infra, dans le chapitre suivant
[15] Le choix de l’enfant est évidemment limité et déterminé par un ensemble de facteurs tels que son milieu social, l’éducation qu’il reçoit, etc… Le présent article considère le choix comme les possibilités offertes en tenant compte de tous ces éléments
[16] Depuis le 28 juillet 1981, l’âge du droit de vote a été abaissé à 18 ans, en Belgique (http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=423)
[17] A ce niveau, se pose la question de la différence entre religion et secte. Ce thème, particulièrement vaste et complexe, ne sera pas abordé dans ce texte. On mettra juste l’accent sur la difficulté d’une classification uniforme (La religion des témoins de Jéhovah est reconnue par certains Etats (l’Allemagne et l’Autriche, entre autres) alors que d’autres la classent dans les sectes : http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moins_de_J%C3%A9hovah). Cela étant, plusieurs autres religions reconnues ne figurent pas dans la liste des religions enseignées dans les pays qui proposent des cours confessionnels
[18] En Belgique, la loi dite loi du Pacte scolaire du 29 mai 1959 impose aux écoles publiques d’organiser des cours de différentes religions et un cours de morale non confessionnelle. Actuellement, les cultes reconnus sont les religion s catholique, protestante, israélite, islamique et orthodoxe [[« Cultes et laïcité en Belgique », C. Sägesser et V. de Coorebyter, dossier du Crisp n°51, janvier 2000
[19] A tout le moins d’une mise sur un même pied de dogmes religieux et de faits scientifiques alors qu’il s’agit de registres nettement distincts
[20] En Italie, la ministre de l’Éducation a décidé de supprimer (en 2004) la théorie de l’évolution des programmes scolaires des écoles primaires, la remplaçant par des ‘narrations fantastiques sur les mythes des origines’. Dans le même « esprit », en 2005, la ministre de l’Éducation des Pays-Bas, Maria van der Hoeven a proposé d’organiser un débat entre les « tenants du darwinisme » et les partisans du créationnisme et du dessein intelligent (http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=8963. Pour une définition du créationnisme et de la théorie du dessein intelligent : Les dessous du dessein intelligent, La Recherche, Avril 2006, vol. n°396, p. 32-40). Les partisans évangélistes de ces thèses créationnistes sont virulents depuis belle lurette aux Etats-Unis et ont eu le temps de s’organiser ; « soutenus par la droite conservatrice au pouvoir, ils infiltrent les conseils des écoles, publient des essais et organisent des conférences » (Les dessous du dessein intelligent, La Recherche, Avril 2006, vol. n°396, p. 32). Déjà, en 1989, une fondation chrétienne conservatrice publiait le manuel « Of pandas and people », dans le but d’introduire la thèse créationniste dans les cours de biologie (http://fr.wikipedia.org/wiki/Kitzmiller_v._Dover_Area_School) A ce propos, Philip Johnson, professeur de droit à Berkeley, affirme « notre but ultime est d’affirmer que Dieu existe et de combattre Darwin » (Les dessous du dessein intelligent, La Recherche, Avril 2006, vol. n°396, p. 34 et 35)
[21] Dans les pays où ce cours existe. C’est le cas de la Belgique
[22] « Cultes et laïcité en Belgique », C. Sägesser et V. de Coorebyter, dossier du Crisp n°51, janvier 2000
[24] Le cardinal Zenon Grocholewski
[25] 2007
[27] En Belgique, par exemple
[28] « (…) peu de pays en Europe déclinent leur identité nationale de façon purement laïque. D’où l’organisation dans la majorité des écoles publiques de cours de religion (…) Ce qui n’empêche pas ces pays d’être confrontés, comme en France, à la sécularisation et à la ‘pluralisation’ religieuse des populations » (http://www2.cnrs.fr/presse/thema/475.htm)
[29] En voici quelques exemples. Depuis le mois de septembre 2008, le Canada a introduit un cours obligatoire « Ethique et culture religieuse » (qui couvre les religions suivantes : catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam, les spiritualités des peuples autochtones ainsi que le bouddhisme et l’hindouisme, pour tous les élèves du primaire et du secondaire. Ce cours remplace l’ancien schéma ; cours de religion (catholique ou protestante) ou de morale (http://radio-canada.ca/radio/maisonneuve/24092007/92376.shtml). L’Assemblée des évêques du Québec s’est ralliée au projet (http://www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets/2008/10/20/107565.shtml?auteur=2278).
En ce qui concerne la Grèce, pays où, historiquement, la religion orthodoxe a joué un rôle crucial dans la sauvegarde de la langue et de la culture grecques sous la domination ottomane, raison pour laquelle Eglise et Etat ont conservé des liens étroits (http://www.ciep.fr/ries/ries36b.php), le cours de religion orthodoxe était obligatoire jusqu’il y a peu dans l’enseignement public. Depuis le mois d’août 2008, une directive autorise le refus du cours de religion (http://la-croix.com/article/index.jsp ?docId=23455191&rubId=4078)
La France, quant à elle, privilégie un « enseignement transversal ». Depuis 1996, l’école publique a intégré, des éléments d’étude des grandes religions. Pas dans une discipline particulière mais intégrés dans les cours d’histoire, de français et d’instruction civique (http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2350972&rubId=786). A côté de l’école publique, la France dispose également d’écoles confessionnelles ; 16,7% des élèves français suivent un enseignement catholique (http://news.catholique.org/laune/16717-le-vatican-insiste-sur-l-identite-religieuse)
[30] En Belgique, le cours de morale ou des cinq religions proposées (cfr. supra) est obligatoire. Suite à des recours auprès du Conseil d’Etat, la chambre flamande a dispensé des élèves des cours de morale et religion des enfants de témoins de Jéhovah qui avaient déposé des recours (« Cultes et laïcité en Belgique », C. Sägesser et V. de Coorebyter, dossier du Crisp n°51, janvier 2000)
[31] Suite à la réforme « Onkelinx » de l’Enseignement primaire de 1997, pour des raisons économiques, l’organisation des cours ont été revues ; « on distingue désormais un cours majoritaire d’un cours minoritaire. (…) Les cours minoritaires ont été regroupés par degré. A côté d’une perte d’élèves importante, cela pose jusqu’à ce jour de graves problèmes d’organisation. Les enseignants se déplacent en moyenne entre 5 à 6 écoles. A la campagne s’ajoutent de longs trajets entre les différents villages. Ce sont surtout les cours minoritaires qui souffrent d’une attitude hostile de la part des différents pouvoirs organisateurs (communes, villes, provinces), des directions et des collègues d’école. Les élèves des cours minoritaires sont souvent retirés des cours généraux pour assister à leur cours de religion minoritaire ». http://www.cil.be/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=0
[32] 19 mars 2009
[33] http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/docannexe/file/5699/redco_recommandations_politique_publique.pdf
[34] « L’athéisme d’Etat a les mêmes conséquences dramatiques qu’une religion d’Etat. Il s’avère tout autant qu’elle, incompatible avec la démocratie ». « L’athéisme expliqué aux croyants », Paul Desalmand, France, 2007, Editions Le navire en pleine ville, p.223
[35] A ce sujet, deux articles complèteront le présent texte. Le premier traitera de la situation belge et, entre autres, du contexte politique qui a débouché sur la loi dite du Pacte scolaire. Un second texte analysera la montée des revendications créationnistes et les tentatives de les intégrer aux cours de biologie aux Etats-Unis, d’un point de vue historique
[36] Pour ne citer que cette matière, un cours d’instruction civique compléterait utilement la formation des élèves en les familiarisant au fonctionnement des institutions et en leur apprenant les bases des droits et devoirs du citoyen. A ce propos, Condorcet en appelait à « une instruction civique raisonnée ». Pour lui, l’école devait être « un organe de la République sans être un rouage du pouvoir politique en place »
[37] « La religion à l’école : un exemple de rapports ambigus entre les Eglises et l’Etat », Pierre Lebuis, Nouvelles pratiques sociales, vol. 9, n°1, 1996, p. 59-77, http://www.erudit.org/revue/NPS/1996/v9/n1/301348ar.pdf. Olivier Reboul est philosophe, spécialisé en philosophie de l’éducation : http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Reboul_(philosophe)
Dans la première partie de cet article, nous décrivions comment les entreprises, soutenues par les pouvoirs publics, préparent les cerveaux des élèves à un bon accueil de "l’esprit d’entreprise". Mais le monde patronal veut aussi peser sur les programmes des cours au profit de ses besoins en main d’œuvre. Comment et avec quel support, c’est l’objet de cette deuxième partie.
En Communauté française de Belgique, l’enseignement secondaire est entre autres constitué de deux types d’enseignement dont l’unique finalité est de former à un métier : l’enseignement en alternance et l’enseignement qualifiant (professionnel ou technique) [1].
En pratique, ces formes d’enseignement sont des filières de relégation. Autrement dit, les élèves n’y arrivent pas après un choix mûrement réfléchi mais bien parce que l’on ne leur laisse que cette possibilité [2].
Officiellement pourtant, les humanités professionnelles et techniques recouvrent les mêmes objectifs que ceux de l’enseignement général [3]. Et même plus, puisqu’au-delà de l’apprentissage de la citoyenneté responsable, de l’appropriation de savoirs, etc. a été ajouté un aspect professionnel. A l’issue de ces études, les élèves doivent pouvoir être formés à un métier. Tout cela avec le même horaire de cours que dans l’enseignement général... Les cours généraux ne sont donc qu’illusion et l’essentiel des programmes se consacre à l’apprentissage d’un métier. La tendance s’est encore renforcée au début des années nonante : (...) à l’objectif « social » de l’alternance va s’ajouter celui de contribuer à la « revalorisation de l’enseignement qualifiant en général » par le « rapprochement entre école et entreprise », objectif politique que tous les gouvernements vont inscrire à leur agenda [4]. Cumuler relégation [5] et vocation professionnalisante ne peut globalement aboutir qu’à une seule chose : la fabrication d’une main d’œuvre docile au profit des entreprises.
Les patrons se sont engouffrés dans la brèche. Non contents de faire leur publicité en dehors des institutions scolaires (journées portes ouvertes entreprises, ou autres Techno Rally), ils font pression depuis de nombreuses années pour que les programmes des cours soient adaptés à leurs besoins spécifiques. En parallèle, les entreprises mettent l’accent sur la formation en alternance, qui leur permet d’avoir de jeunes travailleurs sous-payés.
Adaptez les programmes !
L’organisation patronale flamande des classes moyennes , l’UNIZO, souhaite ainsi une refonte complète de l’enseignement. Elle s’est donnée pour mission de soutenir la transition d’un enseignement de la connaissance vers un enseignement de la capacité à faire les choses, de l’apprentissage de matières à celui des compétences et, enfin, du rôle d’enseignant vers celui de coach-accompagnant [6].
Même son de cloche en Wallonie. Essenscia Wallonie, le représentant patronal de l’industrie chimique, poursuit la concertation avec les instances de l’enseignement général, mais surtout technique et supérieur, afin de faire mieux connaître les besoins de l’industrie en matière de qualifications. [7]. Idem pour Agoria, la fédération de l’industrie technologique, dont une des missions vis-à-vis de ses entreprises membres consiste à développer des relations et réseaux entre l’enseignement et l’industrie afin d’adapter les programmes scolaires (enseignement secondaire et supérieur) aux besoins de l’industrie [8]. Et c’est sans surprise que les patrons de la distribution, regroupés au sein de la Fedis ont, eux aussi, demandé une meilleure adéquation de l’enseignement avec le secteur de la vente et du commerce. Tout en déplorant (en 2008) que les mesures d’économies dans l’enseignement ne permettent pas une mise en œuvre idéale de ces programmes. Alors que les patrons sont toujours les premiers à plaider pour des services publics aux effectifs plus restreints et aux missions moindres [9].
Modifier les programmes ? Mais nous le faisons depuis des années !
Ces multiples demandes n’ont pourtant pas de sens. Depuis 15 ans existe un outil dont l’unique objectif est de transposer les exigences des métiers actuels dans les programmes de cours à suivre par les élèves de l’enseignement qualifiant. Il s’agit d’une commission au nom quelque peu barbare : la Commission communautaire des professions et des qualifications (CCPQ).
Composée de représentants patronaux et syndicaux, de délégués des réseaux d’enseignement, d’enseignants détachés ainsi que d’experts issus d’autres opérateurs de formation (Forem, Promotion sociale, Classes
moyennes…), la CCPQ a ainsi décrit plusieurs centaines de métiers et a défini les bases de formation pour nombre d’entre eux. Si l’apprentissage d’un métier peut faire partie des missions de l’enseignement, ce ne devrait être qu’un objectif secondaire par rapport à à celui de fournir les outils de critique et et d’émancipation. Les cours généraux de français, de mathématiques, de sciences "exactes", techniques et humaines sont là pour ça.
Or, les cours généraux ont décliné dans la filière professionnelle. Et quand ils sont maintenus, ils sont adaptés à la sauce "compétence" : en d’autres mots, un cours de français sera donné dans le but de comprendre un devis, pas pour y découvrir la contestation sociale de certains nouveaux polars. Enfin la dimension métier ne retient que la compétence professionnelle et non ce qui l’encadre (comme l’existence d’organisations syndicales) [10].
Par ailleurs, si le ministre donne son aval, des formations peuvent aussi être établies en "urgence" pour répondre à des réalités économiques et professionnelles pointues, parfois très locales [11]. Le "bénéficiaire" de cette formation trouvera peut-être un boulot à sa sortie de l’école. Mais pour combien de temps ? Pour peu que le métier tombe en désuétude aussi vite qu’il n’a été créé ou que les peu nombreuses entreprises demandeuses tombent en récession et l’élève devenu travailleur ne sera sorti de l’enseignement que pour se retrouver dans un cul de sac professionnel.
Nico Hirtt résume : Officiellement, l’objectif poursuivi par le travail de la CCPQ est de " revaloriser les formations techniques et professionnelles en les rendant plus opérationnelles et plus humanistes ". Mais on cherche en vain une trace de cet " humanisme " dans les explications concrètes de la " revalorisation " (...) C’est bien le programme du patronat européen que l’on retrouve là. [12]. C’est à se demander ce que font les organisations syndicales et les "acteurs" de l’enseignement, présents au sein de la CCPQ.
Par les profils de formations de la CCPQ, ce sont les missions de base de l’enseignement qui sont remises en question.
Mais c’est aussi un pan important de la vie professionnelle qui est redéfini : celui de la formation. Qui s’en charge et qui la paie ? L’Etat, l’employeur, ou le travailleur ?
Des travailleurs à faible coût.
L’Etat (la collectivité, nous) assume le coût de l’enseignement et la formation des demandeurs d’emploi. Il en va autrement de la formation professionnelle. Par le biais des centres de formation rattachés à des secteurs professionnels, les travailleurs peuvent bénéficier de formation de mises à niveau. Ces centres sont cofinancés par les travailleurs [13] et les employeurs.
Restent les élèves qui ont un pied dans l’enseignement et un autre dans le monde du travail. II s’agit de l’enseignement en alternance, largement orienté par la CCPQ. Lors des périodes où le jeune travaille en entreprise, il a droit à une rémunération, [14].
Le monde patronal a très bien compris l’usage qu’il pouvait tirer de jeunes peu formés et fatigués de l’enseignement dispensé de manière "classique". En Région Wallonne, 5500 [15] élèves ont suivi une formation en alternance en 2008. A raison de trois ou quatre jours en entreprise, les entreprises disposent rapidement d’un travailleur supplémentaire pour une bouchée de pain, quand bien même il est en train de se former. D’autant plus que l’employeur du jeune en alternance bénéficie de primes fédérales et régionales conséquentes, multiples et variées [16]. Il est même en mesure de gagner de l’argent au bout du compte.
Des élèves formés exclusivement pour le marché du travail, qu’il est possible d’embaucher pour rien ou si peu avant d’avoir terminé leurs études. L’enseignement qualifiant est très loin de son "humanisme". Mais les patrons trouvent fort bien leur compte dans cette nouvelle niche d’exploitation, à milles lieues de la citoyenneté responsable annoncée par le Décret missions. Ou bien est-ce cela, la citoyenneté responsable ?
Gérard Craan
[1] Il faut noter que l’enseignement technique comporte aussi une filière de transition regroupée au sein des humanités générales et technologiques. Un descriptif de l’organisation de l’enseignement secondaire en Communauté française se trouve ici.
[2] Ou que leur milieu et construction sociale les y "contraint". Voir entre autres cette analyse de Géraldine André, La relégation à l’épreuve du regard socio-anthropologique. Sur la relégation vers l’enseignement qualifiant, consulter entre autres ce rapport (un peu technique) de la Commission de pilotage du système éducatif (pdf).
[3] Voir les articles 6, 24 et 34 du décret dit "missions" du 24/07/1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
[4] Alter Educ, Dossier 20 ans des CEFA. Entre socialisation et qualification, mai 2005, p.5.
[5] Ce qui signifie concrètement que les pouvoirs publics ont volontairement abandonné leur mission d’enseignement à une partie de la jeunesse, généralement la plus fragile et la plus pauvre. C’est un des moteurs de l’exclusion des plus faibles
[6] Traduction de : Onderwijsvernieuwing ondersteunen
UNIZO ondersteunt de overgang in het onderwijs van kennen naar kunnen, van leerstof naar competenties en van lesgever naar de rol van begeleider-coach.Source : site web ondernemende school.
[7] Source : site web d’Essenscia, priorités d’Essenscia Wallonie.
[8] Source : site web de la fédération patronale page consacrée à la formation.
[9] Lire par exemple un discours de l’Administrateur-délégué de la Fédération des Entreprises de Belgique, Rudy Thomaes (pdf).
[10] Lire le propos de Bernard Delvaux, chercheur au CERISIS, repris dans la Revue Démocratie, "Partenariat écoles-entreprises : un marché de dupes ?" - par Frédéric Ligot.
[11] Alter Educ, Dossier 20 ans des CEFA. Entre socialisation et qualification, mai 2005, p.12
[12] Nico Hirtt, La réforme de l’enseignement technique et professionnel en Communauté française de Belgique. Une mise en œuvre du programme de la Table Ronde des industriels européens.
[13] Par une cotisation versée par leur employeur mais qui peut être considérée comme une partie du salaire
[14] Qui n’est ni réellement un salaire horaire, ni tout à fait une indemnité.
[15] Secrétariat permanent de la formation en alternance, Statistiques 2009, données 2008 complètes.
[16] Voir également l’avis conjoint 1702 du Conseil Central économique et du Conseil National du travail (pdf).
Lorsqu’un enfant est "différent", parce qu’il souffre d’un handicap moteur, mental ou d’un "trouble instrumental" (dyslexie, problème d’attention...), il ne va généralement pas à l’école avec les autres. Le système scolaire belge organise un enseignement "spécialisé" ou "adapté" pour répondre aux problèmes spécifiques d’apprentissage de ces enfants. Cela semble être une bonne chose que l’école cherche à s’adapter aux difficultés de chacun. Mais pourquoi ne pas le faire dans une école ordinaire ? Par ailleurs, qu’est-ce qui préside à l’orientation d’un enfant dans l’enseignement "spécialisé" ? Comment ces enfants vivent-ils leur scolarité ? Rencontre avec le Dr Denis Verheulpen, neuro-pédiatre à Bruxelles et à Charleroi.
En Belgique, parallèlement aux réseaux ordinaires, il existe un enseignement spécialisé [1] qui a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques de certains élèves. Lorsqu’un enfant ne peut s’intégrer harmonieusement dans l’enseignement ordinaire ni suivre son rythme, l’enseignement spécialisé est censé pouvoir l’accueillir. Mais on peut se demander pourquoi il ne pourrait pas s’intégrer dans l’ordinaire, alors que dans certains pays [2], il irait en classe avec les autres. Il faudrait bien sûr investir massivement dans l’enseignement. Créer des classes plus petites. Installer des équipements adaptés. Former et payer correctement les enseignants. C’est un choix politique.
La Communauté française a voté en 2004 des dispositions relatives à l’intégration des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire [3]. Malheureusement, derrière les bonnes intentions, l’enseignement reste sous-financé et les "trajectoires budgétaires" ne laissent rien présager de bon. [4] Le budget de la Communauté française ne prévoit pas de dégager des moyens supplémentaires pour les enfants présentant des difficultés sans être scolarisés dans le spécialisé.
Et les enfants dans tout ça ? Pour certains ça va, ils sont bien entourés. On trouve dans les équipes pédagogiques beaucoup de personnes généreuses et motivées. D’autres enfants ont moins de chance, notamment s’ils proviennent des couches plus défavorisées et quand les parents sont eux-mêmes peu scolarisés. Ils galèrent dans des écoles qui ne les comprennent pas, qui ne donnent pas de réponse adaptée à leurs problèmes, et se sentent - à raison - exclus. Ceux-là finissent souvent par baisser les bras à l’adolescence et laisser tomber l’école.
Denis Verheulpen est neuro-pédiatre à Bruxelles et à Charleroi. Régulièrement, il se rend dans des écoles, va à la rencontre des centres PMS [5] et des associations de parents, donne des conférences avec toujours le même objectif : faire en sorte que l’entourage de l’enfant et notamment l’école reconnaisse le trouble dont souffre l’enfant et mette en place des stratégies d’accueil et d’apprentissage adaptées pour accueillir l’enfant plutôt que l’exclure.
En tant que neuro-pédiatre, vous voyez tous les jours des enfants et des adolescents atteints de maladies ou de troubles neurologiques. Quelles sont les difficultés d’apprentissage qu’ils peuvent éprouver à l’école ?
Mes patients sont très différents les uns des autres. Leur seul point commun à tous, c’est qu’il y a quelque chose qui, par rapport à ce qu’on considère comme « normal », dysfonctionne dans leur cerveau. Parmi les difficultés d’apprentissage classiques qui se présentent, les plus fréquentes sont des troubles de la concentration, dont les profils peuvent être très différents. Sans rentrer dans les détails techniques, vous avez par exemple des enfants qui ont du mal à traiter plusieurs informations en même temps, d’autres qui sont pris par leur précipitation, d’autres encore qui n’arrivent pas à se concentrer longtemps et leurs stratégies peuvent être très différentes.
Ensuite, il y a les troubles spécifiques de l’apprentissage comme la dyslexie, trouble d’apprentissage de la lecture, la dyscalculie, trouble d’apprentissage du calcul ou encore la dysphasie, trouble du développement du langage. Vous avez là des enfants totalement intelligents mais qui approchent la langue comme un quadragénaire commencerait à apprendre le chinois, c’est-à-dire d’une façon pas du tout naturelle, c’est poussif et laborieux.
Il y a également un trouble qui est moins connu même s’il est très fréquent à des degrés très variables : il s’agit de la dyspraxie, trouble de la construction du mouvement. Le mouvement est très important dans les apprentissages puisque dans l’écriture, par exemple, ont attend des enfants qu’ils écrivent et qu’ils aient en plus une belle écriture. Lorsque ce travail leur demande énormément d’énergie et qu’ils sont lents, leur apprentissage est rendu très difficile.
Enfin, je vois bien sûr aussi des enfants avec un vrai retard mental, présentant eux également des profils très différents. Pour eux aussi, il doit y avoir une place à l’école.
Quelle est votre appréciation par rapport la réponse que donne l’institution scolaire aux difficultés d’apprentissage de ces enfants ? Est-elle adaptée, comme l’indique son nom ?
Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Le système scolaire belge s’est adapté, avec beaucoup de bonne foi, en se centrant sur la mise en place d’un enseignement spécialisé, qu’on appelle maintenant "adapté", pour répondre à différents types de difficultés d’apprentissage ou d’intégration scolaire. Huit types d’enseignement spécialisé sont ainsi organisés (Voir encart ci-dessous). Les centres PMS sont censés aider les enseignants dans l’orientation des enfants, notamment vers un enseignement adapté, et faciliter les contacts entre l’école et les médecins, psychologues, logopèdes, psychomotriciens etc.
Le système est louable, et c’est bien mieux que la pure exclusion qu’on avait jusqu’au milieu du XXième siècle. Mais en pratique, comme je le dis parfois sur un ton un peu provocateur, on a remplacé le système de la grosse poubelle noire par celui du tri sélectif... L’orientation scolaire ressemble quand même souvent à une mise en sac poubelle, différent selon le cas, par les enseignants et les PMS. Souvent, les motivations sont très peu pédagogiques et tel qu’il est appliqué, le système est peu constructif - tout comme le système du redoublement en cas d’échec scolaire ou l’exclusion en cas de problème de comportement. Ce type d’orientation est souvent fait dans un esprit négatif et humiliant. Il y a beaucoup de maladresse, d’exaspération et un esprit parfois très « fonctionnaire » de la part d’enseignants. Tout ceci entraine des souffrances narcissiques, des problèmes de confiance en soi ou des rebellions contre le système.
Alors que, théoriquement, le système n’est pas le pire qu’on puisse imaginer, en pratique il s’accompagne de beaucoup d’injustice, d’incompréhension, de souffrance pour les enfants, les parents et aussi les enseignants.
Par ailleurs, on sait que la proportion d’enfants étrangers ou « issus de l’immigration » dans l’enseignement « adapté » est importante [6].
En effet, et il y a plusieurs aspects à considérer. D’abord, ça dépend fortement des personnes que l’on rencontre. Et c’est vrai en général : si on tombe sur quelqu’un d’idiot et de procédurier, on n’aura pas la même chance que si on rencontre quelqu’un de dévoué, d’intelligent et de souple d’esprit. Souvent les enfants avec des difficultés scolaires non-spécifiques (par exemple : « je ne suis pas très bon à l’école parce que mes parents parlent à peine français ») sont orientés vers l’enseignement spécialisé juste parce que c’est trop difficile pour les enseignants du secondaire qui ont devant eux des classes de trente ! Du coup, ces enfants se retrouvent dans un enseignement soi-disant adapté qui ne l’est pas du tout, qui n’apporte aucune solution au problème. Et, sans vouloir stigmatiser, il y a des centres PMS et des régions où c’est systématique.
D’autre part, force est de constater que dans la population immigrée, il y a beaucoup de personnes très peu instruites qui n’ont pas l’instruction nécessaire pour aider leur enfant en difficulté scolaire. A côté de cela, je rencontre également des parents qui répondent à l’échec scolaire de l’enfant en le brimant, voire en le battant. C’est un sujet très tabou mais c’est pourtant très présent dans plusieurs cultures présentes chez nous, y compris bien sûr « la nôtre », où c’est sans doute le plus tabou donc moins visible. Bref le problème est multiple, mais au sein de tout cela, il y a les a priori négatifs, un profond racisme « sans méchanceté », une certaine condescendance à la coloniale.
Qu’est-ce qui se passe quand un enfant cumule les troubles ?
Quand un enfant cumule les troubles, il cumule forcément les difficultés. Mais c’est très variable. J’ai des situations où, quand un enfant cumule les troubles, il est mieux entouré, mieux accepté, il comprend et accepte donc plus facilement sa situation. Les enfants qui en souffrent sont ceux dont les troubles ne sont pas reconnus, qu’ils les cumulent ou pas d’ailleurs. Par exemple, s’ils ont une dyslexie qui n’est pas reconnue, qu’ils sont traités de feignants et brimés par leurs professeurs. Parce que vous avez encore des enseignants qui croient, alors que ça n’a jamais fonctionné, que c’est en leur donnant des coups de pied au derrière que ça va aller.
J’imagine que vous voyez parmi ces enfants, dont les troubles ne sont pas reconnus, ou qui sont baladés de type en type faute de trouver leur place (voir encart ci-dessous), la tentation d’abandonner, de "décrocher" ?
Tout le temps. Parfois on peut reprocher cet échec au système d’enseignement lui-même, parfois aussi à l’attitude du PMS, des enseignants, ou des parents quand ils sont consultés. Il est certain que ce sont des domaines assez difficiles, que parfois on passe à côté de certaines choses importantes alors qu’on essaie de bien faire. Mais le fait est que, surtout à l’entrée dans l’adolescence, quand on passe sa vie à faire des efforts et à entendre "Fais un effort !" et que ces efforts ne sont pas fructueux, la prise d’indépendance vous pousse à baisser les bras. Et à ce moment-là, ça s’appellera de la "paresse". Moi, je ne connais pas grand-monde qui soit paresseux dans des domaines où il est compétent.
Est-ce qu’il existe des pays qui répondent mieux à ces difficultés d’apprentissage ?
Il n’y a pas beaucoup de pays "développés, démocratiques et industrialisés" où la prise en charge est moins bonne qu’en Belgique et en France. Pour l’anecdote, à l’école européenne, la seule section où il y a encore des redoublements, c’est la section francophone. Dans cette école, il y a des consignes, qui ont été réfléchies abondamment par des pédagogues européens, et qui concernent l’aide à apporter aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage, dans le but de les aider à obtenir leur baccalauréat européen [7] et à pouvoir enfin s’orienter vers un domaine où leurs compétences sont mises en évidence.Mais ces consignes ne sont pas appliquées dans le système scolaire belge. Au niveau universitaire, il y a plusieurs pages de consignes pour les étudiants avec difficulté spécifique d’apprentissage sur le site de la KUL [8], ce dont on n’a jamais entendu parler en Belgique francophone.
Disons que "le paradis" c’est en Finlande [9]. Il y a 20 ou 30 ans, contre l’avis de tout le monde, face aux railleries collectives des parents et des enseignants, on y a mis en place un système "zéro exclusion" dans lequel il y a de la place pour tout le monde, dans chaque classe. Les moyens, au lieu d’être alloués à des centres PMS ou des écoles spécialisés, ont été utilisés dans la création de classes plus petites, où les enfants travaillent par groupes de 4 ou 5, avec des systèmes et des médias d’apprentissage plus variés comme, par exemple, des ordinateurs à leur disposition en classe. Il y a des enfants pour qui c’est une aide énorme de pouvoir utiliser un ordinateur. Pour prendre note par exemple, quand ils ont une écriture illisible, ou en cas de dysorthographie sévère. Pourquoi ne pas pouvoir travailler avec un correcteur orthographique, alors qu’on le fera pendant toute sa vie ? Pourquoi jouer à faire une sorte de compétition où les gens en chaise roulante, les hémiplégiques devraient courir contre Usain Bolt ? Si Usain Bolt avait un caillou dans sa chaussure, il ne pourrait pas être champion olympique.
Le système finlandais met tout le monde en avant, en fonction de ses compétences. On n’insiste pas sur les faiblesses mais sur les talents. Que ce soit le foot, ou être le pitre de service, ou être très serviable et ramasser les papiers, ou avoir une très belle écriture et prendre note pour votre groupe, ce sera mis en évidence. De plus, les évaluations sont là pour évaluer, comme c’est théoriquement le cas chez nous, et pas pour éliminer. Il s’agit de voir où en est l’enfant, pas de donner les résultats d’une course de Formule 1. Il s’agit aussi d’évaluer le travail de l’enseignant, pas uniquement celui des élèves. Si l’enfant a deux échecs de suite, l’enseignant doit se justifier, trouver les raisons et les solutions. Mais les enseignants sont également mieux formés (ils ont tous un master) et sont mieux payés. C’est un tout autre système, une tout autre philosophie.
C’est une philosophie qui est socialement beaucoup plus acceptable, plus ouverte. Dans notre système, si bienveillant soit-il, l’enfant handicapé, à deux ans et demi - ou, s’il tombe sur une école maternelle très ouverte et disponible, à cinq ans et demi - disparait de la vie sociale. Il n’est plus à l’école avec les autres, il doit aller à l’école avec d’autres enfants handicapés, dans un ghetto de handicapés, où les choses se passent souvent très bien parce qu’il y a des gens magnifiques qui s’occupent d’eux, mais où il se sentira toujours à l’extérieur du vrai monde, de la vraie vie. Et l’évolution non pas du système d’enseignement, mais l’évolution non-philosophique de notre société fait que c’est une réalité pour des gens de moins en moins handicapés ou de plus en plus "normaux". La norme se restreint.
C’est assez représentatif du lissage que subit notre société. On parlait de compétition : il faut être compétitif, rentable, etc.
On va vers le clonage ! En particulier à l’école où il faut être lisse, sans surprise, malléable. Et ça forme de bons travailleurs flexibles, dynamiques, soumis et prévisibles. On vit dans une société qui cherche à faire disparaitre les originalités et à évacuer ceux qui ont des faiblesses. Malgré tout, j’ai l’impression que les gens qui ont été exclus injustement de l’enseignement ont plus de chance qu’il y a 50 ans de réussir à s’en sortir en mettant en avant leurs talents, leur créativité. Comme l’ont fait de tout temps les dyslexiques, des dysorthographiques et les dyspraxiques ! Edison, Benjamin Franklin, Wintson Churchill étaient des cancres parmi les cancres. Le père de Churchill disait que ses résultats scolaires de son fils étaient une insulte à l’intelligence. Quant à Edison, il s’est fait renvoyer de l’école à 12 ans parce qu’il était "débile".
Françoise Janssens
Les huit types de l’enseignement spécialisé
L’enseignement spécialisé est organisé, dans sa globalité ou partiellement, pour les enfants et les adolescents de 2 à 21 ans. Il se décline en huit types correspondant à différentes catégories de handicaps ou de troubles :
Type 1 : enfants atteints de troubles mentaux légers.
Type 2 : enfants atteints de troubles mentaux modérés à sévères.
Type 3 : enfants atteints de trouble de comportement.
Type 4 : enfants atteints de déficience physique.
Type 5 : enfants malades (type organisé en milieu hospitalier).
Type 6 : enfants aveugles et malvoyants,
Type 7 : enfants sourds et malentendants,
Type 8 : enfants atteints de troubles instrumentaux.
.
Des enfants "hors-norme". Témoignage.
Certains enfants cumulent les troubles. C’est le cas de Chloé. Âgée de 8 ans, elle souffre d’une maladie génétique. Les troubles liés à cette maladie sont multiples : hypotonie (diminution du tonus musculaire), dyspraxie (trouble du développement moteur), dysphasie (trouble du développement du langage), trouble de l’attention et hyperémotivité. En d’autres termes, Chloé est très maladroite, très distraite et très sensible. Sa maladresse irrite, sa distraction agace (et passe souvent pour de l’opposition), sa sensibilité décontenance. Notamment à l’école.
Son passage dans l’ordinaire fut plutôt rude. Rejetée par la plupart des enfants (quand on ne sait pas bien courir et qu’on articule laborieusement, on est exclu des jeux et des conversations), incomprise par certains enseignants, elle faisait figure d’extraterrestre. Les enseignants, ayant déjà en charge des classes surpeuplées, se sentaient désarmés. Pour son entrée en primaire, sur conseil de l’équipe éducative et médicale, Chloé est inscrite dans une école "individualisée" de type 8, à Bruxelles. Pendant deux ans, tout se passe très bien. Il faut dire que le cadre du type 8 est idéal : de plus petits groupes [10], des enseignants motivés, des méthodes actives et ludiques. Chloé progresse bien dans ses apprentissages mais également du point de vue de son développement physique : elle parle de mieux en mieux et devient autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Mais en janvier dernier, la direction fait part aux parents que l’école ne souhaite pas qu’ils la réinscrivent pour l’année scolaire prochaine. En cause : les structures d’accueil du type 8 ne répondraient plus aux troubles moteurs de la fillette, à savoir ses fréquentes chutes. L’école met en avant la "sécurité" et pousse les parents à inscrire leur fille en type 4 (déficience physique). Le problème, c’est que Chloé n’est pas infirme. De plus, ses troubles moteurs ne se sont pas aggravés depuis son inscription à l’école. Pourquoi l’exclure au bout de trois ans quand on l’a inscrite en toute connaissance de cause ? Son cas relèverait à la fois du type 8 (en ce qui concerne les troubles de l’attention) et du type 4 (pour les structures adaptées aux troubles moteurs). Or une telle formule n’existe pas. Chloé est un enfant "hors-norme". Son cas n’est pas isolé. De nombreux enfants cumulent les difficultés et leurs parents doivent souvent se démener seuls pour trouver une école qui accepte de s’adapter aux difficultés de leur enfant. Et rares sont les écoles ordinaires prêtes à mettre en place un projet pédagogique adapté.
Mais s’ils ne grandissent pas ensemble, comment ces enfants une fois devenus adultes pourront-ils vivre ensemble, se respecter, dépasser leurs différences ? Si l’on entend bâtir une société juste et solidaire, il faut permettre à nos enfants de grandir ensemble et d’apprendre ensemble l’égalité et la solidarité.
F.J.
[1] Le terme « spécialisé » remplace "spécial" depuis le décret du 3 mars 2004 (voir note 3). De même, on ne parle plus de « handicapé » : on dit « enfant ou adolescent à besoins spécifiques ».
[2] Comme en Finlande
[3] Décret du 3 mars 2004, modifié par le décret du 5 février 2009, disponible ici : http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28737_004.pdf (Pour les questions relatives à l’intégration : voir les articles 130 à 158). Le conseil supérieur de l’enseignement spécialisé a rédigé un VADEMECUM de l’intégration précisant le cadre politique, les intentions philosophiques du décret ainsi que les modalités pratiques pour la mise en œuvre de projets de partenariat entre les écoles spécialisées et les écoles ordinaires. Vadémécum disponible sur Enseignement.be http://www.enseignement.be/index.php?page=25197&navi%3D2431
[5] Centres psycho-médico-sociaux
[6] Voir à ce propos ce document de la Communauté française : "Publics de l’enseignement spécialisé : les élèves de nationalité étrangère" http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=1629&do_check=
[7] http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/specific_interest/special_needs/d_x_senxx_csn_0408_1_f.pdf
[8] Katholieke Universiteit Leuven
[9] NDLR : En tout cas jusqu’à 16 ans, quand l’obligation scolaire prend fin. Après, 56% des élèves passent au lycée, 38% dans l’enseignement professionnel, 2% suivent la 10ième année et 4% arrêtent (temporairement) leurs études (Chiffres : Claude Antilla, 2008 : http://www.ps1150.be/Texte/080518Finlande.htm ). L’enseignement secondaire supérieur est hiérarchisé. Ainsi, un lycée de haut niveau exige un 9 (sur une échelle de 4 à 10) dans certaines branches pour pouvoir s’inscrire. A la fin de la scolarité, un examen national d’inscription à l’enseignement supérieur est organisé. Sa réussite est nécessaire pour pouvoir accéder à l’enseignement supérieur.
[10] Maximum 15 enfants par classe.
Depuis septembre 2008, l’école Pédagogie Nomade, à Limerlé, dans la province du Luxembourg, propose une méthode d’apprentissage et un fonctionnement général d’établissement bien loin de ce que l’on trouve dans l’enseignement traditionnel. Après un an et demi, la période de rodage semble toucher à sa fin. Présentation de cette école pas comme les autres.
On peut, sans trop forcer le trait, parler de crise en ce qui concerne le monde de l’enseignement. Crise de financement [1], mais également crise existentielle. Entre le taux de décrochage, l’absentéisme, les sentiments désabusés, l’absence de nouvelles vocations et le changement de carrière au bout de quelques années de près de la moitié des jeunes professeurs [2], l’école semble devoir se réinventer. Certains rejettent la faute sur le manque de discipline des élèves, voire la démission de leurs parents, et prônent un retour aux ambiances du passé, avec souvent le fantasme du collège anglais en ligne de mire pour les plus radicaux.
D’autres y voient un problème structurel. Pour beaucoup d’entre eux, ce que refusent les élèves n’est pas l’apprentissage, mais l’école elle-même. La mise en scène ne fonctionne plus, comme un vieux tour de passe-passe éculé dont tout le monde connaît le truc. Les adolescents ont une maturité de plus en plus précoce, et leur offrir un cadre relativement identique de leur 6 à 18 ans sans réaction de leur part est beaucoup trop optimiste [3]. Sans oublier que désormais, grâce aux médias, les élèves connaissent les coulisses de l’école et de ses acteurs, humanisent les professeurs, éducateurs et directeurs, et de là se laissent moins impressionner par un statut qualifié de maître il n’y a pas si longtemps.
Ce statut était-il d’ailleurs enviable ? Doit-on postuler le refus du travail de l’élève, et le fouet comme moteur nécessaire ? L’école doit-elle offrir un cadre de soumission - tu n’auras pas de problème tant que tu fais ce que je dis sans discuter – et sembler préparer principalement à une vie professionnelle de subordonné ? On évoque souvent les missions de formation à l’autonomie et à la citoyenneté démocrate de nos écoles, mais l’institution fonctionne elle-même d’une des manières les moins démocratiques, et on n’y fait que peu confiance à l’élève [4], qui est avant tout un être à gérer et former plutôt qu’à épanouir.
Quand ce type de constats est approuvé, la volonté d’inventer un nouvel enseignement apparaît. Peut-être est-ce l’école qui est désormais inadaptée, au moins pour certains des élèves, et que le problème chez ces derniers peut être vu comme un trop plein de lucidité, d’intelligence, de volonté et d’autonomie plutôt que l’inverse. Ne serait-il pas intéressant alors d’explorer la voie de la confiance et de la responsabilisation ? C’est cette logique que les fondateurs de Pédagogie Nomade, école alternative située dans la commune de Gouvy, ont décidé de suivre.
Tout a commencé par la rencontre de deux mondes
D’un côté, on trouve l’ASBL Périple en la Demeure [5] basée à Limerlé, à quelques kilomètres de l’intersection entre les frontières belge, allemande et luxembourgeoise, dont la vocation éducative, écologique et culturelle fait ses preuves dans la région depuis une dizaine d’années. Même si certaines sensibilités et idéologies (telles que l’environnement, l’auto-gestion, l’échange et le partage, la méfiance vis-à-vis de la pensée dominante,...) sous-tendent toutes les réalisations de cette ASBL, c’est principalement un lieu d’action. Il s’agit d’abord d’un endroit de rencontre, construit au début des années deux mille à partir d’une vieille ferme en ruine, et dans lequel sont régulièrement organisés des ateliers, des concerts, des rencontres philosophiques,... Mais on y trouve également une brasserie où nait la bière Oxymore [6] ; un jardin, dédié à la culture propensive [7] ; ou encore quelques animaux d’élevage. Et une école secondaire depuis un an et demi [8].
De l’autre côté, il y a la faculté de philosophie de l’ULg, haut lieu de réflexion en Belgique particulièrement vivant ces dernières années, dont certains des doctorants avaient et ont toujours un grand intérêt pour les questions d’éducation et d’enseignement.
Le contact eut lieu en 2005. Rapidement, les initiateurs du projet se rencontrent sur certains points, en premier dans leur analyse de travers de l’enseignement dit traditionnel. Car si ce type d’enseignement ne reçoit pas une condamnation sans ambages de leur part, il leur semble pourtant qu’une alternative est possible, et même potentiellement bénéfique, au moins pour certains élèves qui s’en trouvent plus ou moins exclus. Les nouveaux amis se retrouvent également sur certaines réponses déjà apportées à cette question des travers, limites et erreurs fondamentales de l’enseignement traditionnel, qu’ils vont chercher dans la littérature (Jacques Rancière, René Char, Michel Foucault,...) autant que dans des projets déjà réalisés un peu partout en Europe et dans le monde (Lycée expérimental de Saint-Nazaire et Lycée autogéré de Paris en France, Barefoot College (collège aux pieds nus) en Inde,...).
Gestation et naissance de Pédagogie Nomade
Assez vite, la volonté de tenter eux aussi l’aventure apparaît, à la lumière du bagage qu’ils ont accumulé. De ce qui a fait ses preuves autant que ce qui semble avoir mené à des voies de garage. C’est le temps de l’approfondissement théorique, des brainstorming, des visites et des invitations, et de la rédaction du projet, qui durera presque deux ans. Le résultat sera le projet d’une école approchée principalement selon trois axes, empruntés au Lycée expérimental de Saint-Nazaire : un fonctionnement démocratique, impliquant un égalitarisme entre professeur et élèves ; l’autogestion ; et une approche pédagogique basée sur le décloisonnement des matières, l’apprentissage au travers d’ateliers et de projets, et l’ouverture de l’école au monde extérieur. (Voir cadre)
Il fallut encore un an et demi pour convaincre la Communauté Française d’accepter et de financer l’aventure [9]. Depuis, une soixantaine d’élèves de secondaire supérieur y sont inscrits, ou plutôt la font vivre, aidés dans leur gestion et leur apprentissage par une douzaine de professeurs (pour l’équivalent de huit temps pleins).
L’heure des premiers bilans
Tout n’est pas toujours rose à Pédagogie Nomade, bien sûr. Il faudra encore longtemps avant de pouvoir tirer des conclusions franches qui soient intellectuellement honnêtes, mais déjà certaines critiques et certaines réussites se font récurrentes. On fait en général à Pédagogie Nomade les mêmes reproches qu’aux autres écoles alternatives : le manque d’encadrement de l’élève, qui mène certains à un absentéisme conséquent. Ce à quoi il est répondu que si certains élèves sont absents à leurs débuts, une bonne partie d’entre eux réintègre l’école après quelques semaines, voire quelques mois passés en dilettante. Et qu’il vaut mieux un élève à 100% disposé, en pleine possession de sa volonté et de ses moyens, la moitié du temps qu’un élève en opposition ou en refus complet qui serait présent tout le temps.
On reproche aussi à ce genre d’école un taux de réussite relativement faible. Ce taux est peut-être faible par rapport à une école normale, mais est sans doute supérieur à ce que les élèves de l’école auraient atteint dans l’enseignement traditionnel, eux qui pour la plupart étaient en décrochage scolaire. De plus, certains d’entre eux se choisissent d’autres défis que l’obtention du certificat d’enseignement secondaire supérieur, comme la réussite d’un examen d’entrée dans une école supérieure, par exemple. Calculer un taux de réussite pertinent à Pédagogie Nomade est donc compliqué.
Au final, il semble que les élèves passés par ce genre d’enseignement ont en général une connaissance théorique et encyclopédique moins pointue (mais souvent plus large) que dans les écoles traditionnelles. Ils font par contre preuve d’une grande maturité concernant la gestion, la confiance en soi, la communication en groupe, la prise de parole et l’inscription dans un débat. Les partisans et les adversaires d’un tel type d’enseignement se renvoient donc dos à dos, incapables de s’entendre précisément sur les attentes prioritaires qu’on a de l’école (préparation à l’enseignement supérieur et à la vie active d’un côté, épanouissement, autonomie, capacité à vivre et travailler ensemble et curiosité intellectuelle de l’autre).
Il est clair aussi que les règles de l’école sont faites pour une école de quelques dizaines d’élèves et sont sans doute en l’état inadéquates pour de plus grands groupes, qui s’ils voulaient intégrer des principes que l’on trouve à Pédagogie Nomade, devraient les adapter à leurs tailles. Mais les échecs de PN (ndlr : Pédagogie Nomade), que ce soit dans la gestion, l’absentéisme, ou certaines relations avec le voisinage [10] se font déjà de plus en plus bénins, et laissent la place à des succès pédagogiques, culturels et humains de plus en plus visibles et indéniables. A l’heure d’une crise existentielle de l’enseignement traditionnel, on ne peut que souhaiter qu’un tel projet puisse amener quelques éléments de solution. Ou au moins sauver la scolarité de certains qui s’en étaient trouvés exclus.
Pierre Hère
Un fonctionnement différent pour une école à part
Le fonctionnement démocratique
Le premier axe sur lequel se base l’enseignement à Pédagogie Nomade est la recherche d’un fonctionnement démocratique de l’école. Ce qui implique en premier lieu une égalité de droits et de devoirs entre les professeurs et les élèves au sein de l’école. S’il existe effectivement une différence de fonction, personne à PN ne peut imposer son autorité, son agenda, ses sanctions, du seul fait de son statut. Le professeur offre son expérience, est un référent dans certaines matières pour l’élève, mais ne le dirige pas. Ce dernier doit prendre en main lui-même sa scolarité, placer ses propres échéances, et s’auto-évaluer à la lumière des commentaires de chacun. C’est une pratique mutuelle de la confiance. Et si certains prennent du temps à se mettre au travail, la majorité de ces élèves précédemment en décrochage mettent assez vite la main à la pâte, comme pour prouver que c’est un blocage plus qu’une fainéantise qui les a rendu « improductifs » jusque-là.
La volonté démocratique implique que les décisions concernant le fonctionnement de l’établissement se prennent de manière collégiale. Une matinée par semaine est consacrée à ces prises de décisions, dans un jeu presque parlementaire de propositions, de concertations entre élèves d’un côté, professeurs de l’autre, et de mise en commun et synthèse avant approbation ou rejet.
Et jusqu’ici, cela marche. La plupart des élèves osent s’approprier ce pouvoir et font montre d’une volonté d’assumer au mieux cette responsabilité. Ce fonctionnement semble également bénéfique quant à l’apprentissage de la confrontation de points de vue, la confiance en soi qu’il faut pour exposer les siens et l’approche intellectuelle nécessaire pour respecter ceux des autres et trouver une synthèse constructive et satisfaisante pour les différentes parties en jeu.
L’autogestion
À Pédagogie Nomade, il n’existe ni direction, ni secrétariat, ni équipe d’entretien ou de cuisine. Toutes ces tâches incombent aux élèves et professeurs. Un roulement existe pour que chacun ait à un moment ou à un autre la responsabilité de ces gestions. Le but est ici multiple : une appropriation pour chacun de l’école dans son ensemble ; un respect et un apprentissage des tâches d’entretien, d’administration, de restauration ; une portée concrète à leur action ; ... Tout le monde participe au fonctionnement global de l’école. Les soucis des élèves ne se cantonnent donc pas à leurs notes de cours et à leurs interros. A leur plus grande joie semble-t-il. [11]
Le décloisonnement
L’approche pédagogique à PN peut être présentée comme voulant « détruire des murs ». Détruire les murs entre classes et ateliers ou labos d’abord, par une pédagogie du projet, dans laquelle la valeur de la théorie réside principalement en ce qu’elle permet la réalisation, ce y compris la réalisation personnelle.
Destruction des murs entre les classes de matières différentes ensuite. Au travers des projets, les matières sont abordées en fonction de leurs complémentarités. Qu’un outil pédagogique pour la géographie, par exemple, soit rédigé en anglais, et le cours tourne en cours de langue. La collaboration entre professeurs est indispensable, et va même plus loin encore, certains d’entre eux suivant les cours de leurs collègues. Afin d’y apporter une vision « apprenante » qui permet d’en améliorer le didactisme, ou simplement par curiosité personnelle. Avec des résultats assez remarquables, quand on sait à quel point dans la plupart des écoles les professeurs rechignent ne serait-ce qu’à évoquer leurs cours avec leurs collègues. Cette collaboration, mais aussi les devoirs de l’autogestion et l’accessibilité pour des cours particuliers, incitent les professeurs à une présence à l’école plus grande qu’ailleurs [ce qui n’est pas pour plaire aux syndicats. On peut comprendre leur volonté de protéger les horaires d’une profession souvent éreintante, mais on s’étonne un peu de ce qu’ils ne semblent pas voir plus loin, c’est-à-dire que ce type de pédagogie mène très certainement à une plus grande sensibilité et une meilleure formation quant à la négociation sociale, de bonne foi, de bonne volonté, et ferme]. La plupart des professeurs, y compris engagés à temps partiel, approchent les quarante heures de travail par semaine mais ne s’en plaignent pas. Tous se disent beaucoup moins usés et beaucoup plus épanouis que lorsqu’ils travaillaient dans l’enseignement traditionnel. Pédagogie Nomade semble respecter les professeurs autant que les élèves.
Les derniers murs que Pédagogie Nomade veut faire tomber sont ceux entre l’école et le reste de la communauté. Plutôt qu’un endroit coupé du monde, l’école veut se donner de la consistance en s’inscrivant dans la réalité sociale, économique, culturelle, environnementale... Ainsi, les « nomadiens » aiment à recevoir des intervenants extérieurs comme à présenter leurs réalisations, et plus encore à ce que ces réalisations correspondent à un attente de l’extérieur. Le projet est d’ailleurs que le certificat d’enseignement secondaire supérieur [12] n’y soit obtenu qu’après la participation à un projet de six mois à l’étranger [13], en plus de la réussite des examens.
Si vous-même avez envie d’y faire un tour, vous pouvez prendre contact avec eux. Essayez simplement d’emporter avec vous un savoir ou un savoir-faire à partager, c’est l’obole qu’ils préfèrent faire payer.
P.H.
[1] dont les mesures « Robin des bois » et leur abandon est un énième épisode. Voir http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2010-04-29/le-decret-robin-des-bois-enterre-767228.php
[3] Il faut d’ailleurs remarquer que l’on attend à ce sujet une acceptation de la part de nos jeunes, ce que l’on ne demande pas à nos adultes. Qui trouverait prétentieux pour un travailleur de réclamer une promotion, de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux défis, après 5 ou 10 années passées au même poste
[4] Alors que beaucoup de psychopédagogues défendent l’idée que la confiance entraine l’autonomie, et doit donc la précéder dans une certaine mesure
[5] www.peripleenlademeure.be . On peut lire sur ce site la présentation de l’école Pédagogie Nomade
[6] Un oxymore est une figure de style qui associe deux mots sémantiquement opposés. Périple (avec son idée de voyage) en la Demeure (avec sa notion casanière) est un oxymore
[7] Terme inventé à PelD. La propension est « l’art d’aider les choses à devenir ce qu’elles ont tendance, naturellement, à devenir, sans les forcer ni les freiner » (http://www.peripleenlademeure.be/spip.php?article6)
[8] Les élèves peuvent s’inscrire à Pédagogie Nomade à partir de la quatrième secondaire. Aucun critère de sélection n’existe, ni aucun frais supplémentaire pour les parents
[9] L’école est officiellement une filière expérimentale de l’athénée de Vielsalm
[10] L’apparition d’un tel éléphant dans une si petite communauté se fait difficilement sans quelques heurts, même si l’accueil a presque toujours été plus positif que négatif de la part des riverains
[11] Pour l’anecdote, j’ai eu l’occasion de gouter la cantine de PN. Elle est incomparable à toutes les autres cantines que j’ai pu connaître, tant au niveau de la qualité des aliments que de leur préparation. Peut-être suis-je tombé sur les bonnes équipes ?
[12] Reconnu par la Communauté Française au même titre que n’importe quel CESS de l’enseignement général.
[13] ia des organismes du type d’AFS (http://www.afsbelgique.be/) ou de Quinoa (http://www.quinoa.be/) par exemple. Cette condition est pour le moment au frigo pour des raisons de complexités administratives et légales. Peut-être que l’arrivée du programme d’échange européen Comenius (équivalent du programme Erasmus pour les élèves de secondaire à partir de 14 ans) dès la rentrée prochaine permettra de faire avancer le schmilblick. (http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=comenius)
L’enseignement a toujours suscité un intérêt particulièrement marqué. Au-delà de l’aspect strictement pédagogique et méthodologique se pose également la question du rôle de l’école dans la société. A quoi sert-elle ? A quoi doit-elle servir ? Dans une vision émancipatrice, l’école devrait permettre aux adultes de demain d’acquérir non seulement des connaissances, mais également les outils nécessaires afin qu’ils puissent poser des choix de vie conscients. Or, on le sait, l’école constitue l’un des premiers lieux de reproduction sociale. Il est donc permis de s’interroger sur les valeurs et les discours qui y sont transmis dans nos « démocraties » capitalistes.
C’est la démarche de Gérard Craan qui, dans L’école (entre-)prise d’assaut, s’intéresse à la manière dont l’école, soumise à la logique et aux exigences du secteur privé, inculque aux enfants dès leur plus jeune âge « l’esprit d’entreprise ». Des entreprises qui poussent et parviennent adapter les programmes des cours de manière à satisfaire leurs propres besoins en future main-d’œuvre : ce point précis fait l’objet du second volet de l’article, L’école (entre-)prise d’assaut : deuxième partie.
Les contenus sont donc au centre d’importants enjeux sociaux, économiques mais également philosophiques. Eponine Cynidès s’interroge pour sa part sur la pertinence de l’enseignement de contenus religieux à l’école : enseigner les croyances et les dogmes liés à une religion fait-il partie des attributions de l’école ? A lire dans Cours de religion à l’école ; et si l’on se préoccupait de l’intérêt de l’enfant ?.
Face aux questionnements multiples et nécessaires sur le rôle de l’école, différents projets pédagogiques alternatifs sont mis en œuvre depuis des décennies. Pierre Hère nous présente l’un d’entre eux, né en Belgique en 2008 : Pédagogie Nomade. Une école différente, basée sur le fonctionnement démocratique, l’autogestion et le décloisonnement, qui permet dans bien des cas de récupérer des élèves en décrochage dans l’enseignement ordinaire.
Si les matières et leurs contenus reflètent et entretiennent les valeurs que veut transmettre la société, il en va de même pour la façon dont l’école trie et sélectionne les enfants et les adolescents. Les enfants continuent à fréquenter des écoles et à suivre des filières différentes en fonction de leur classe sociale ou de leur origine.
Certains enfants, parce qu’ils souffrent d’un handicap par exemple, connaissent également des difficultés à évoluer dans le cadre de l’école ordinaire. Ceux-là sont majoritairement orientés vers un enseignement dit spécialisé ou adapté. Un système louable dans ses intentions, mais qui ne va pas sans susciter certaines préoccupations dans sa mise en oeuvre. Un système à l’image du lissage imposé par une société qui exclut les faibles et les originaux. Christine Oisel a rencontré le Dr Verheulpen qui revient sur les enjeux et les problèmes liés à ce type d’enseignement dans "Martine va à l’école spécialisée".
Ce tri commence bien avant l’école. La question de l’accès aux études, particulièrement aux études supérieures, reste très largement posée. Renaud Maes dans L’accès à l’enseignement supérieur : à questions idiotes, réponses stupides montre comment les diverses approches suivies jusqu’à présent se révèlent inefficaces et suggère d’en finir avec trois concepts mystificateurs : le talent, l’effort, le mérite.
Et pour tous ceux qui, en fin de parcours scolaire, n’ont que les petits boulots ou le chômage comme horizon ? Eh bien, on utilisera cette Armée de réserve de travailleurs [1] pour fournir au patronat une main-d’œuvre bon marché et corvéable à souhait et ce au travers, notamment, de « plans pour l’emploi ». Le plan Activa : « On a tous à y gagner ». Vraiment ? C’est la question posée par Ariane Lévêque. Ce « plan d’embauche massif » permet aux employeurs qui engagent des chômeurs « difficiles à placer » de bénéficier de réductions de cotisations ONSS tandis que les travailleurs subissent une instabilité financière importante liée à une bureaucratie effrayante et restent assimilés à des chômeurs.
Merci à Arianne, Christine, Eponine, Gérard, Renaud pour leur participation à ce numéro.
Chris et Christine, pour l’équipe de JIM
Une fois n’est pas coutume, le numéro suivant du Journal Indépendant et Militant se voudra éclectique et ne sera pas consacré à une thématique en particulier. De nouvelles élections anticipées se profilent dans notre beau royaume. Ce sera sans doute l’occasion de s’interroger sur les raisons qui poussent certains à voter voire à se présenter aux élections et d’autres à s’abstenir. Nous vous proposerons également des témoignages très différents, comme le coup de gueule d’Ernestine qui en a marre d’être prise pour une secrétaire ou, pour ne pas perdre le fil avec le numéro qui se termine sous vos yeux, un témoignage consacré à une expérience sociale et pédagogique audacieuse : l’enseignement de la théorie de la domination et de la reproduction de Pierre Bourdieu à des lycéens des séries ES dans le bassin du 93, en France.
Rendez-vous le 23 mai prochain pour le premier article de ce numéro 9.
[1] K. Marx, Le Capital, Livre I, Chapitre XXV. Voir :
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-25-3.htm