|
Journal Indépendant et Militant
|
http://lejim.physicman.net/spip
|
|
Quand la violence (est) tue
Les maux des mots - Numéro 1 : "violence légale" /
lundi, 14 septembre 2009
/ Christine Oisel
|
Dans le cadre de ce numéro 1 consacré à la violence légale, arrêtons-nous un moment à la place accordée à « la violence » dans les discours dominants, notamment médiatiques. La violence « inacceptable » serait-elle du seul fait des délinquants et des criminels ?
Types de violences
Le terme "violence" apparait au début du XIIIème siècle, emprunté au latin classique violentia (caractère emporté, farouche) [1], et désigne tout comportement qui utilise la force afin de contraindre [2]. En fonction de la manière dont elle s’exerce, on parle de violence physique, sexuelle, morale, psychologique, verbale, matérielle... Selon le champ dans lequel elle s’exerce, elle peut être domestique, carcérale, scolaire, mais aussi sociale, économique, politique... En fonction des conséquences qu’elle entraine, on dit que la violence est légère ou grave.
La perception et l’acceptation de la violence diffèrent également en fonction du contexte dans lequel elle s’exerce et du statut de la personne qui l’exerce. Ainsi, dans certaines circonstances, la violence peut être le seul moyen de répondre à la violence, ce que l’on appelle la "légitime défense". En outre, la loi autorise certaines violences, notamment pour exécuter les décisions de justice, maintenir "l’ordre public", garantir "la sécurité des biens et des personnes" ou en cas de guerre. C’est ce qu’on appelle la "violence légale".
Médias et violence
La violence est omniprésente dans les médias. Il faut dire qu’elle agite les passions et cela fait vendre. La place qui lui est accordée dans les journaux en témoigne. Les faits-divers violents passent quasi-systématiquement devant l’actualité politique ou économique dans l’ordre des titres. En Belgique, pour prendre deux exemples évidents, les différentes affaires de pédophilie dans les années 1990 [3] ou le meurtre de Joe Van Holsbeeck [4] ont accaparé l’espace médiatique pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines d’affilée. A croire que le monde avait cessé de tourner. Il ne s’agit pas ici de diminuer la gravité des faits, mais de regretter l’appétit des médias pour ce type d’information, au point de laisser de côté des pans entiers de l’actualité.
Les violences liées à la contestation sociale sont elles aussi fortement médiatisées et dénoncées : émeutes dans les quartiers "chauds", dans les prisons ou dans les centres fermés, séquestrations de patrons, voitures brulées, casseurs, "black bloks",... Sans oublier les "preneurs d’otages" et "terroristes" que constituent les travailleurs des transports publics lorsqu’ils partent en grève [5]. Mais il y a tous les jours des grèves, des occupations, des actions en justice dont on ne témoigne pas ou peu. Les médias ne parlent le plus souvent des luttes sociales qu’au travers des dégâts matériels ou des tracas qu’elles occasionnent, pas en relation avec la violence économique à laquelle elles répondent le plus souvent.
Violence légale
Alors que certains actes violents font la une des journaux, d’autres formes de violence, pourtant bien réelle, passeraient presque inaperçues. Il s’agit de toutes les formes que peut prendre la violence légale.
La violence légale est d’abord celle de l’Etat et de ses institutions. Ainsi, celle de la police [6]. La loi l’autorise à utiliser certains formes de violence qui s’accompagnent d’une série de violences "annexes", sortant du cadre de la loi, connues mais rarement poursuivies (tutoiement, brutalité langagière, discrimination raciste lors des contrôles d’identité, passages à tabac...) [7]. Par exemple, lors de manifestations mouvementées, la violence des "casseurs" (jets de pierre, vitrines cassées...) sera mise en exergue et incriminée, notamment au travers de la presse. Par contre, les violences policières seront tues ou banalisées [8]. On nous dira que la police "a dû intervenir". Les matraquages, l’usage de lacrymogènes, d’auto-pompes et maintenant, en France du flash ball [9] et du taser [10], sans parler des coups de pied "bien placés", des clés de bras ou des insultes, sont pourtant des actes de violence. Mais exercée dans un cadre légal, on parle d’"opération de maintien de l’ordre" [11]
Un autre exemple : dans le cadre de la répression des sans-papiers, la loi autorise qu’on arrête, fouille, enferme parfois pendant des mois dans des prisons, puis qu’on expulse des adultes et des enfants, pour le seul motif qu’il n’ont pas de papier "en règle". Les sans-papiers qui "occupent" des lieux vides, parce qu’ils n’ont pas de logement ou qu’ils veulent rendre visible leur désespoir, finissent toujours par être brutalement "évacués" [12]. Cela constitue une belle flopée de violences, toutes légales, auxquelles on ajoutera les mauvais traitements que subissent ces personnes dans les "centres de rétention" et lors des expulsions [13], c’est-à-dire les violences "annexes", tolérées dans les faits et la plupart du temps impunies. Mais exercée dans un cadre légal, cette violence est banalisée et se dit : "reconduite aux frontières", "retour volontaire", "éloignement forcé" [14]
Suite au choc des attentats du 11 septembre 2001, les pays membres de l’Union Européenne, emboitant le pas aux Etats-Unis, ont renforcé leur arsenal "antiterroriste" en adoptant des lois liberticides [15], qui ont notamment permis à la police d’arrêter dans la plus grande brutalité et à la justice de maintenir en détention pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois des personnes, non sur base de faits mais en fonction de leurs convictions politiques, de leur engagement militant ou simplement de façon de vivre ou de leurs amitiés [16]. Mais dans un cadre légal, ces violences sont couvertes : il s’agit de lutter contre la "menace terroriste".
Nous pourrions continuer ainsi encore longtemps, la liste est longue. Les prisons, l’univers carcéral dans son ensemble engendre une violence extrême. Mais on en parle peu. Ou alors quand une association communique son rapport, toujours accablant, sur les conditions de détention, quand les gardiens font grève ou en cas d’émeute.
Nous pourrions aussi évoquer la torture et la peine capitale - toujours pratiquées, par exemple, par "la plus grande démocratie du monde" - ou encore, bien sûr, des faits de guerre. Nous y reviendrons bientôt.
Violence économique
Mais la violence légale n’est pas que politique et armée, elle se fait aussi économique. L’ordre économique mondial que nous subissons, à savoir le modèle capitaliste imposé et généralisé, est intrinsèquement inégalitaire et violent. Quand au nom de la rentabilité de l’entreprise, et pour accroître le profit des actionnaires, des travailleurs sont contraints de « faire des efforts », en acceptant des bas salaires, des cadences infernales ou des horaires empêchant toute vie de famille, quand ils sont licenciés ou quand des filiales de groupes sont fermées pour en ouvrir d’autres là où la main d’œuvre est soldée, c’est de la violence. Et des milliers de personnes la subissent de plein fouet chaque jour. Dans ce domaine également, le poids des mots est déterminant. On parlera, par exemple, de « flexibilité » ou de « restructuration ».
La mondialisation, c’est-à-dire l’extension du capitalisme « occidental » à l’ensemble de la planète, a exporté ces maux dans le monde entier. L’Occident fixe les règles du jeu économique, notamment au travers de ses institutions comme le FMI [17], la Banque mondiale ou l’OMC [18]. Cela constitue le prolongement d’une domination historique : les anciens colonisateurs deviennent bailleurs de fonds, et ils conditionnent l’octroi de toute aide à la soumission au système.
Les « PAS » (Plans d’ajustement structurel) [19], sont par exemple un programme de « réformes » économiques que le FMI ou la Banque mondiale imposent aux pays en grande difficulté économique pour bénéficier de prêts. Les PAS exigent notamment une politique d’austérité, une libéralisation totale du marché, une augmentation des droits des investisseurs étrangers ou la suppression des « entraves » au développement économique.
Dans une logique néolibérale de réduction des "coûts publics", les gouvernements des "démocraties" capitalistes fauchent dans les budgets sociaux, démontent le service public, favorisent l’intérêt des entreprises et des hauts revenus (notamment au travers de la fiscalité) et criminalisent la précarité en faisant, par exemple, la chasse aux chômeurs et en culpabilisant les plus faibles. Mais encore une fois, tout dépend de la présentation : les coupes dans le social et le démantèlement des services à la communauté sont appelés "réformes", les personnes précaires ou pauvres deviennent des "assistés" voire des "profiteurs".
N’oublions pas que la violence économique s’exerce également sur l’environnement. L’histoire économique et industrielle des XIX° et XX° a profondément bouleversé les habitudes de production, de distribution et de consommation, entrainant des conséquences dramatiques pour l’éco-système (pollutions, pillage des ressources naturelles, destruction de la biodiversité...) et la santé.
Appeler un chat un chat
Même s’il s’exerce dans un cadre légal, un acte de violence, qu’il soit physique (guerres, brutalités policières), psychologique (enquêtes intrusives de services sociaux, intimidations policières et judiciaires), économique (population précarisée), politique (opinion politique criminalisée), verbal (tutoiements, insultes), ou environnemental, reste un acte de violence.
Mais à la différence des autres formes de violence, son caractère légal implique d’une part qu’il n’est pas puni. Seules les violences "annexes" le sont parfois, et encore, si elles sont révélées et suffisamment médiatisées [20], si la personne a les moyens de prouver qu’elle a été victime d’agression (témoins, film, etc.) ou si elle est morte, ce qui implique normalement un devoir d’enquête.
D’autre part, une fois "légale", la violence n’est plus nommée comme telle, masquée par l’épaisse tenture que constitue la novlangue : les euphémismes [21], les ambigüités [22], les connotations [23] permettent de défendre l’indéfendable. Pour signaler des violences policières, on parlera de "bavure" (qui sous-entend que ce type de violence est exceptionnel) ou de "débordement" (qui suppose une insuffisance des effectifs). Pour rapporter des violences de guerre, on dira "pertes collatérales" (plus présentable que "civils tués" ou "école bombardée") ou "frappes chirurgicales" (suggérant que le bombardement est propre et précis). La pauvreté, la précarité et l’insécurité engendrées par le système sont quant à elles dissimulées derrière la neutralité de termes comme « réorganisations » ou « délocalisations » (supposant un réaménagement pratique, "réaliste") annoncées.
Pour les personnes qui subissent ces violences, cela revient à refuser ou à dévaloriser leur statut de victime, ce qui constitue une violence supplémentaire. Par rapport à celles qui reçoivent l’information ainsi présentée, cela conduit à banaliser la violence légale et donc à s’y résigner.
Le discours dominant, dans lequel nous baignons depuis l’enfance, et que la plupart des médias d’information reproduisent sans autre forme de procès, c’est d’abord le discours "d’en haut". Qu’il blâme et criminalise les violences liées à la contestation sociale, qu’il utilise la peur pour imposer sa ligne, qu’il dissimule ou diminue ses propres violences, tout cela fait partie d’un processus de consolidation de l’ordre existant. "La résignation est un suicide quotidien". Et la résistance commence par l’examen du langage : traquer ce qui se cache derrière les mots et appeler un chat un chat.
Christine Oisel
[1] Le composé antonyme "non-violence" n’apparaitra que dans les années 1920, sur base de l’anglais non violence
[2] Voir une définition complète : http://www.cnrtl.fr/definition/violence
[3] Affaires Dutroux, Fourniret
[4] 12/04/08
[5] Pour, rappelons-le, défendre leurs droits et la qualité des services publics
[6] Lire à ce propos l’article de Gérard Craan, "La longueur de laisse détermine la liberté d’action du policier", à suivre dans ce numéro 1 du JIM
[7] Lire par exemple le Rapport d’Amnesty International sur l’impunité des violences policières en France (avril 2009) : http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR21/003/2009/fr
[8] Elles sont par contre signalées lorsqu’elles sont commises pas des gouvernements "hostiles" (par exemple l’Iran)
[9] Arme incapacitante : lanceur de balle en caoutchouc. Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Flash_ball
[10] Pistolet délivrant une forte décharge électrique. Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistolet_%C3%A0_impulsion_%C3%A9lectronique
[11] Avec la généralisation des téléphones portables intégrant la fonction photo ou vidéo, les manifestants témoignent de plus en plus régulièrement, par le biais d’internet, des violences policières qu’ils ont subies. Par exemple, dans le cadre des manifestations menées en marge du sommet dit "de l’intégration" à Vichy (novembre 2008), ou en opposition à l’Otan à Strasbourg (avril 2009), les médias ont largement rapporté et grossi la casse occasionnée par les manifestants. Fort peu des provocations et des violences policières, qui n’ont pourtant pas cessé aux dires de nombreux participants et témoins. Certains ont publié des vidéos pour montrer et dénoncer les agressions passées sous silence. Voir par exemple cette vidéo enregistrée par un(e) participant(e) à la manifestation de Strasbourg et postée sur Youtube. On y entend distinctement les manifestants demander aux forces de l’ordre d’arrêter de leur jeter des pierres et de garder leur calme : http://www.youtube.com/watch?v=1UIEYkTWf80
[12] Lire à ce propos l’article "Chasse à l’homme estivale dans les rues de Bruxelles", à suivre dans ce numéro 1 du JIM
[13] En Belgique, la "technique du coussin" a été rendue publique suite à l’émoi provoqué par la mort de Semira Adamu, une nigérienne de 20 ans qui fuyait un mariage forcé dans son pays, tuée lors de son expulsion par la police belge qui l’a étouffée avec un coussin, le 22 septembre 1998.
[14] La directive dite "Retour" du Parlement européen (18/06/08) s’inscrit dans le processus de mise en place d’une politique d’immigration. Cette directive entend "favoriser le retour volontaire des immigrants illégaux et établir des standards minimaux en matière de durée de rétention et d’interdiction de retour, mais aussi un certain nombre de garanties juridiques. Les Etats membres restent libres d’appliquer des normes plus favorables." Lire la directive : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=FR&type=IM-PRESS&reference=20080616IPR31785
[15] Lire à ce propos les articles que Fiona Wallers consacre à ces lois (la première partie, "Pour mieux comprendre les lois liberticides…", sera publiée jeudi) et les deux interviews qui y sont liées ("La lutte antiterroriste : un processus continu de répression " et "La construction de l’image : élément de la répression"), à suivre dans ce numéro 1 du JIM
[16] Par exemple, les "affaires" Secours rouge en Belgique - erronément appelée "affaire ex-CCC" dans la presse (juin 2008), et Tarnac en France (novembre 2008).
[17] Fonds monétaire international »
[18] Organisation mondiale du commerce
[19] Egalement appelés "prêts d’ajustement structurel" ou "prêts d’ajustement sectoriel"
[20] Par exemple, les humiliations et les tortures infligées par des militaires américain(e)s dans la prison d’Abu Ghraib en Irak, rendues publiques grâce à des photos-souvenirs prises par les tortionnaires eux-mêmes
[21] Mots qui servent à masquer ou à minorer une idée en renvoyant à des connotations moins négatives
[22] Caractère équivoque d’un mot
[23] Charges positives ou négatives d’un mot
Pour entamer notre dossier sur les nouvelles lois liberticides, que vous pourrez découvrir dans les jours qui viennent, voici un bref aperçu des quelques « nouvelles » mesures d’application en Belgique, qui montrent un renforcement des contrôles, des lois d’exception et des limitations des libertés. Ensemble, et grâce à un fonctionnement particulier de la sphère politique et judiciaire, elles constituent un véritable arsenal "anti-terroriste".
Pour mieux comprendre...
La loi relative aux infractions terroristes
La loi du 19 décembre 2003 introduit de nouvelles infractions dans le Code pénal, pour créer un nouvel arsenal « adapté » aux infractions dites terroristes.
Définition de l’infraction terroriste
Une infraction terroriste est définie comme l’infraction qui de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.
Cette définition s’applique à toute une série de faits : l’homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires, la prise d’otage, l’enlèvement, la destruction ou la dégradation massive, le détournement aérien ou marin, certaines infractions liées aux explosifs et armes, les infractions liées aux armes bactériologiques, nucléaires ou chimiques et aux toxines, la destruction ou la dégradation d’une infrastructure, la libération de substances dangereuses, la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale, et la menace de réaliser l’une de ces infractions [1].
La définition est très large et comporte de grandes possibilités d’interprétation. Ainsi, dans plusieurs mouvements sociaux, la lutte légitime peut être dure. Des grèves dans des institutions de fourniture d’énergie sont-elles réellement du terrorisme ? La dégradation d’une façade lors d’une manifestation demandant la hausse des salaires, est-elle du terrorisme ? [2]
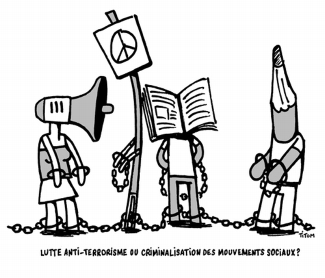
Un autre point pose question : la notion d’intention, comme on le lit ci-dessus commise intentionnellement dans le but d’intimider… C’est cela qui détermine si l’infraction peut être qualifiée de terroriste. Or il est impossible de donner un sens suffisamment précis et univoque à la notion d’intimidation, au caractère indu de la contrainte exercée sur les pouvoirs publics, ou au fait de déstabiliser gravement les structures sociales fondamentales d’un pays ou d’une organisation internationale [3]. Ces termes sont eux aussi sujets aux interprétations les plus diverses.
On le voit, l’application dépend de l’interprétation. Certains actes seront légitimes, d’autres pas, selon le bon vouloir du Parquet et des autorités : (les différents acteurs du processus de répression antiterroriste sont brièvement décrits plus bas). Selon la volonté politique dominante. [4]
Définition du délit de participation
La définition ne concerne pas l’appartenance à un groupe terroriste, mais bien la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris la fourniture de matériels, d’informations, de financement d’une activité du groupe.
Comment définir le groupe terroriste ? Est-ce que soutenir un groupe qui lutte à l’autre bout du monde contre une dictature par les armes est un délit de participation à un groupe terroriste ? Comment définit-on d’ailleurs la participation (diffusion de tracts ? possession de numéros de téléphone ?) ?
La loi ne donne pas de réponse. L’interprétation est encore une fois maximale…
Les méthodes particulières de recherche ou MPR
La loi portant sur les méthodes particulières de recherche et d’enquête, adoptée en 2003 par le Parlement belge, étend et renforce les techniques d’intervention des fonctionnaires de police et du Procureur du Roi. Annulée partiellement par la Cour d’Arbitrage, elle sera modifiée en 2005 [5].
Avec une ampleur jamais atteinte auparavant en Belgique, la loi autorise l’utilisation de méthodes particulières de recherche conférant des pouvoirs exorbitants aux services policiers et au Parquet en ce qui concerne leur mise en œuvre, lors d’enquêtes réactives, mais aussi, et surtout, proactives.
Mais en réalité, il s’agit de la légalisation de méthodes dont l’utilisation est probablement aussi ancienne que la police elle-même [6]. Elles fournissent une base légale aux méthodes policières, dont certaines étaient secrètes et d’autres illégales [7].
Les méthodes particulières de recherche couvrent des techniques telles les observations dites « discrètes », les infiltrations, l’utilisation d’indicateurs, ou encore la surveillance d’habitations privées.
1. Contrôle des services de police
Le premier point qui pose sérieusement question est celui du contrôle des services de police lors de la mise en œuvre d’enquêtes. Le mécanisme de contrôle de l’opportunité de recourir aux méthodes particulières d’enquête et de recherche, ainsi que de la régularité de leur exécution, est confié uniquement au Procureur du Roi. Or, le Procureur du Roi n’est pas soumis à l’impartialité…Enfin, sur la base d’un dossier confidentiel, la Chambre des mises en accusation n’a qu’un contrôle formel quant à la procédure [8].
2. Dossier non accessible à la défense
Le dossier reprenant les résultats des méthodes particulières appliquées est confidentiel. Même pendant le jugement, la partie civile n’a pas accès à ces données. Le juge de fond statue à partir d’un dossier incomplet, car il n’a pas, lui non plus, accès à ces informations.
3. Immunité pour les forces de police
Les forces de police peuvent jouir de l’immunité pour les infractions qui pourraient être commises dans le cadre de méthodes particulières de recherche. C’est l’excuse légale pour toute infraction « absolument nécessaire » commise par la police. L’accord du procureur du Roi peut être obtenu APRES l’infraction, rétroactivement… [9]
4. Mesures attentatoires à la vie privée
D’autres méthodes de recherche particulièrement attentatoires à la vie privée sont créées par la loi : l’interception du courrier, qui pourra s’effectuer pour le courrier concernant la personne suspectée, et non seulement envoyé ou reçu par elle, (les infractions pouvant même être minimes) ; les visites domiciliaires et saisies, qui pourront être systématisées (le Parquet pourra perquisitionner de sa propre initiative et sans contrôle) ; les mesures de « contrôle visuel discret » qui seront facilitées (c’est à dire le placement de caméras ou d’émetteurs, la saisie de documents, la fouille des lieux,…).
En 2009, la Commission justice du Sénat adopte sans sourciller un avant-projet de loi qui légalise de la même manière les méthodes des services de renseignements….
Le Protocole Aznar et le Mandat d’arrêt européen
Depuis la révision de la loi sur les étrangers [10], la Belgique ne peut plus être un pays d’accueil pour un réfugié « politique » européen poursuivi dans un autre Etat européen. La Belgique est aussi tenue de livrer ces personnes aux autorités européennes qui le demandent. En d’autres termes, on ne peut accuser les autorités d’un pays européen de torture, de manquements dans les droits de la défense etc. pour s’opposer à une extradition.
Il faut remonter à 1997 : les pays membres de l’Union européenne adoptent le protocole dit Aznar [11], du nom du si peu progressiste premier ministre espagnol de l’époque, et rédacteur du texte.
Ce protocole dit que : Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les Etats membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires de l’asile [12].
Adopté dans une décision cadre européenne en 2004, il a été intégré en Belgique en décembre 2005 lors de l’adaptation de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers.
Outre la difficulté pour certains ressortissants étrangers de pouvoir être accueillis légalement en Belgique (les minorités Roms, par exemple), ceux qui sont surtout visés sont, dans l’esprit des autorités espagnoles de l’époque, les personnes poursuivies dans un Etat membre pour des activités désignées comme terroristes. José Maria Aznar dénonce l’incohérence entre principes d’asile et demandes d’extradition, prétextant que des Etats membres de l’Union européenne, accordant l’asile à des terroristes d’ETA – discours de l’intolérable sanctuaire français, et opposition frontale vis-à-vis des autorités belges dans l’affaire Moreno Garcia- reconnaissent de la sorte ces activités délictueuses un caractère politique et introduisent une forme de « prime » à l’impunité pour les terroristes [13].
Le système d’extradition classique va aussi être remplacé par le Mandat d’arrêt européen. Celui-ci exige de chaque autorité européenne une reconnaissance automatique des demandes d’extradition faites par l’autorité judicaire d’un autre pays.
Les centaines de prisonniers politiques passés par les jugements et les geôles espagnoles, grecques, italiennes ou françaises apprécieront : les pays européens sont des vraies démocraties…
Fiona Wallers
Parquet fédéral
Sa création est récente : 2001. Certains l’appellent le « super-parquet ». Il a été mis en place pour coordonner les enquêtes qui ont une portée nationale, celles qui ont une dimension internationale. Il est seul compétent pour poursuivre en matière de crime organisé et de terrorisme. Il est composé des procureurs fédéraux (dont ceux spécialisés en matière de terrorisme). Il bénéficie de certains avantages de la loi sur les MPR. Il interprète les dispositions en matière terroriste pour poursuivre. Il est étroitement contrôlé par le Ministre de l’Intérieur.
Juge d’instruction
Il mène l’enquête à la demande du Parquet. Il y a aussi des juges d’instruction « spécialisés » en matière de terrorisme.
Police judiciaire
Elle dispose notamment d’une section spécialisée dans le terrorisme. Et dans ce domaine, elle peut utiliser légalement les moyens permis par l’adoption de la loi sur les MPR.
Sûreté de l’Etat
C’est un service de renseignement. Il pourrait bénéficier de la légalisation de certaines de ses méthodes, à l’instar de la police judiciaire.
Ocam, ou Organe de coordination pour l’analyse de la menace
Composé d’agents issus des services de renseignement, de police, de la mobilité et des transports, des douanes, des finances et des affaires étrangères, il doit livrer des analyses à propos de la lutte antiterroriste et propose la fixation du niveau d’alerte en matière de terrorisme. Il est placé sous l’autorité des Ministres de la Justice et de l’Intérieur.
Fiona Wallers
[1] Article 137 du Code pénal, §§ 2 et 3
[2] Une précision est inscrite dans la loi :« Une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste. » . Cependant, « Ce simple rappel des droits consacrés n’empêche évidemment pas les abus qui pourront se commettre avec la nouvelle loi ». Loi antiterroriste ou la criminalisation de la résistance à l’injustice ? , Mathieu BEYS et Thomas MITEVOY, Progress Law, juin 2005
[4] On lira avec intérêt les Documents parlementaires, Rapport de la Commission Justice du Sénat, 3 décembre 2003, , et aussi Loi antiterroriste ou la criminalisation de la résistance à l’injustice ?, op. cit.
[5] Loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes de recherche et quelques autres les méthodes d’enquête, modifiée par la loi du 27 décembre 2005
[6] Maïté de Rue, Christian de Valkeneer, Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête, Ed Larcier, 2008
[7] Voir Jean-Claude Paye, "L’arbitraire, base d’un nouvel ordre de droit", Toudi, mai-juillet 2006, et : Méthodes particulières d’enquête : la loi à nouveau sanctionnée par la Cour constitutionnelle, Syndicat des avocats pour la démocratie, Communiqué de presse du 20 juillet 2007
[8] La Chambre des mises en accusation est une instance d’appel : il n’y a donc pas de recours contre ses décisions.
[9] Pour nuancer, ceci n’est vrai que pour des délits encourant une peine inférieure à celle que les policiers tentent de mettre en évidence (d’où l’intérêt d’augmenter les peines pour les cas de « terrorisme »)
[10] Loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
[11] Intitulé officiellement Protocole sur le droit d’asile des ressortissants des pays membres de l’Union européenne, Traité d’Amsterdam, 1997, Protocole annexé au Traité constituant la Communauté européenne. Le télécharger en pdf. Voir également à ce propos : Emmanuel-Pierre Guittet, "Ne pas leur faire confiance serait leur faire offense. Antiterrorisme, solidarité démocratique et identité politique", dans Culture et Conflits, Antiterrorisme et société, Cultures et conflits, Ed L’Harmattan, 2006
[12] Ibid. Antiterrorisme et société, Cultures et conflits, Ed L’Harmattan, 2006
[13] ibid.
Les lois antiterroristes ont ému les défenseurs des libertés et des droits fondamentaux, et les militants actifs dans les luttes contre les inégalités et l’injustice. La violence légale trouverait là son application la plus dure. Comment se cache la répression de la contestation derrière la traque au « terroriste » ?
Cet article est la première partie d’un dossier, qui se clôturera le 21 et le 22 septembre par les interviews de Laurent Bonelli et de Jean-Claude Paye, tous deux sociologues et spécialistes de la question.
Nous ne savons pas où cet attentat-suicide était envisagé. 12 décembre 2008 : la police judiciaire belge arrête à l’aube 14 personnes. Elles sont suspectées d’appartenir au réseau Al-Qaida et de s’apprêter à passer à l’acte de façon imminente. Il pourrait s’agir d’une opération au Pakistan ou en Afghanistan, mais il ne pouvait être totalement exclu que la Belgique ou l’Europe puissent avoir été une cible [1]… Et comme l’affirme très sérieusement le procureur fédéral belge Johan Delmulle, ces informations, liées au fait que le sommet européen se déroule en ce moment à Bruxelles ne laissaient évidemment pas d’autres choix que d’intervenir aujourd’hui [2].
242 policiers auraient pris part à 16 perquisitions selon Glenn Audenaert, directeur de la police judiciaire de Bruxelles.
Un an plus tôt : 21 décembre 2007. Ce matin-là, 14 personnes sont aussi arrêtées. Officiellement, rien ne filtre sur les raisons du coup de filet. Selon le Parquet de Bruxelles, l’enquête présentait suffisamment d’éléments ayant permis leur arrestation. Dans la foulée, le niveau d’alerte terroriste s’appliquant au territoire belge est relevé, le feu d’artifice du 31 décembre est annulé. Il y a de quoi s’inquiéter, d’autant plus que très peu d’informations semblent parvenir à la population pour expliquer l’opération du Parquet et de la police. Un projet d’évasion de l’islamiste Nizar Trabelsi ? Des indications des services de renseignements américains ? Las, les suspects n’auront été privés de leur liberté que quelques heures cette année-là. Mais à Bruxelles, les mesures de sécurité accrues restent en vigueur pendant des semaines.
Ces deux évènements se déroulent à un an d’intervalle. Les scénarios se ressemblent, tant par les méthodes policières, que par l’opacité des explications fournies par les autorités belges. En 2007, lorsque les « suspects » sont relâchés, ce n’est pas une surprise, déclare-t-on au Parquet de Bruxelles. Le même qui criait au loup la veille. En 2008, les inculpations ne concernent que moins de la moitié des interpellés…
Ces interrogations vont se trouver en quelque sorte renforcées par un rapport du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité R). Dudit rapport, on retiendra que le Procureur fédéral avait manifestement agi seul ou presque, les services de renseignements ayant été écartés de la discussion « secrète ». Le Ministre lui-même n’a pas été informé des détails de l’alerte… Et le rapport du Comité R de conclure : « La question est de savoir s’il est indiqué, en pareilles circonstances, d’avoir une confiance aveugle dans l’appréciation du procureur fédéral. » [3]…
Comment la Belgique s’est-elle trouvée, à ces deux occasions au moins, dans des situations d’exception ? Qu’est-ce qui a déterminé les relèvements des niveaux d’alerte, l’ampleur des perquisitions, etc. ? Les explications présentées à la presse quelques semaines plus tard ne lèvent pas le doute. L’enquête concerne ce que l’on appelle la filière afghane [4]. Six des 14 personnes arrêtées fin 2008 sont certes poursuivies pour appartenance à un réseau terroriste. Les inculpés présenteraient des liens étroits avec des organisations étrangères d’entraînement militaire en Afghanistan. Plusieurs d’entre eux y auraient suivi des entraînements…
Mais on reste sur sa faim. Car très peu d’éléments matériels étayent les affirmations du Parquet. D’ailleurs, et surtout, les éléments présentés ne peuvent que difficilement être vérifiés. Il a été question d’un attentat imminent, commis par un réseau Al-Qaïda en Belgique, sur des installations chimiques, explique l’avocat Christophe Marchand, en charge de la défense de certains inculpés. L’information vient des services secrets américains et est invérifiable [5]. Leur participation à des entraînements militaires en Afghanistan est tout aussi difficile à établir.
Pourrait-on imaginer que ces personnes, tout en étant convaincues de l’idéologie des Talibans, ne soient mêlées à rien d’autre que l’impression de tracts ou à une manifestation de soutien aux populations afghanes ? Quelles sont les preuves récoltées par les autorités belges, autres que les instructions transmises par les services de renseignements américains ? Pourrait-on imaginer que certains s’entraînaient en Afghanistan pour combattre les forces de l’OTAN ? Ou qu’un attentat était prévu en Afghanistan ? Au nom de quoi la Belgique étend alors sa compétence en dehors de son territoire ?
L’exemple de la filière afghane nous permet de poser trois questions, à notre avis, essentielles à propos des lois antiterroristes et de leur application.
1. Qui est visé ?
2. Sur quels éléments se base une instruction terroriste ?
3. C’est quoi exactement le « terrorisme » ?
1. Le parquet et la police ratissent large
Plusieurs enquêtes sont menées par le Parquet fédéral depuis l’adoption des lois antiterroristes en Belgique. Sans surprise, ce sont les islamistes qui jouent les têtes de gondoles. La première condamnation concerne Nizar Trabelsi. Accusé d’avoir préparé un attentat visant la base militaire de Kleine Brogel, il écope de 10 ans de prison en 2004. Aujourd’hui, Nizar Trabelsi risque l’extradition vers les Etats-Unis [6]. Suivent plusieurs enquêtes à propos d’une filière d’envoi de combattants islamistes en Irak (GIMC) en 2007 et, plus récemment, celles à charge des personnes accusées de participer à la filière afghane, en 2008. Enfin, il y a le dossier Belliraj : des « complices » du belgo-marocain pourraient être extradés vers le Maroc, sur la base d’aveux probablement obtenus sous la torture…
Certains de ces dossiers ont fait l’objet d’un traitement médiatique ; peu ont suscité l’indignation. Mais c’est un tort. Car les poursuites du Parquet fédéral ne vont pas s’arrêter à la traque de méchants islamistes.
Depuis l’adoption des nouvelles lois (voir : Pour bien comprendre), on assiste au renforcement pratique d’un véritable arsenal. En 2003, des manifestants liégeois - dangereux activistes - se voient poursuivis pour association de malfaiteurs… pour l’organisation d’une manifestation pacifique deux ans plus tôt, lors de la tenue d’un sommet européen en Belgique. Ils apprennent que des méthodes particulières d’enquête et de recherches leur ont été appliquées, article relatif aux "mis sur écoute". En 2004, des militants Belges se sont vus inculpés du chef de participation à un groupe terroriste, pour avoir traduit et diffusé en public un communiqué du DHKP-C turc [7] ; en 2005, deux militants basques sont extradés vers l’Espagne, alors qu’un an plus tôt, la Belgique refusait de livrer quiconque aux autorités espagnoles, car elles étaient soupçonnées de pratiquer la torture dans l’affaire Moreno-Garcia [8] (lire l’interview de Laurent Bonelli, à paraître le 22 septembre) ... En 2008, cinq membres du Secours rouge belge sont arrêtés lors d’une véritable mise en scène policière. Inculpés pour participation aux activités d’un groupe terroriste, on avait retrouvé leurs photos dans le jardin de militants italiens poursuivis en Italie…
On le voit, le Parquet et la section terroriste de la Police fédérale ne chôment pas. Et ratissent large.
Pour ceux qui ne sont pas encore choqués par l’étendue (connue à cette heure…) du zèle policier, quelques explications sur les méthodes utilisées par les nouveaux « justiciers » de la démocratie libérale pour avoir le champ libre de réprimer, dans le deuxième article à paraître demain :
"Quand ils sont venus chercher un communiste personne n’a rien dit …"
Fiona Wallers
[1] Le Soir 13 décembre 2008
[2] ibid.
[3] Le Soir, Cafouillages à tous les étages, 23 juillet 2009
[4] Les personnes poursuivies sont accusées d’avoir mis en place une filière de recrutement de combattants Vers l’Afghanistan, d’avoir participé à ces entraînements, et d’avoir projeté un attentat en Belgique ou ailleurs
[5] Le Soir 4 février 2009
[6] Le Soir du 25 juin 2009
[7] l’affaire dite du DHKP-C remonte à 1999, les premières inculpations étant ‘association de malfaiteurs’
[8] Pour les détails voir cette information du Secours Rouge
Les lois antiterroristes ont ému les défenseurs des libertés et des droits fondamentaux, et les militants actifs dans les luttes contre les inégalités et l’injustice. La violence légale trouverait là son application la plus dure. Comment se cache la répression de la contestation derrière la traque au « terroriste » ?
L’article précédent donnait par l’exemple un échantillon de l’ampleur de la violence légale des lois antiterroristes Quand ils sont venus chercher un juif....
Continuons par l’examen de l’application pratique des lois liberticides…
Cet article est la deuxième partie d’un dossier, qui se clôturera le 21 et le 22 septembre par les interviews de Laurent Bonelli et de Jean-Claude Paye, tous deux sociologues et spécialistes de la question.
Le Parquet et la section terroriste de la Police fédérale ne chôment pas. Et ratissent large. Pour ceux qui ne sont pas encore choqués par l’étendue (connue à cette heure…) du zèle policier, quelques explications sur les méthodes utilisées par les nouveaux « justiciers » de la démocratie libérale pour avoir le champ libre de réprimer.
2. Sur quels éléments se base une instruction terroriste ?
Sur quels éléments de preuve se base l’instruction terroriste ?
Dans l’affaire de la filière afghane, nous avons vu que les principaux éléments sur lesquels se base l’instruction ne sont pas vérifiables. Ils proviendraient d’informations transmises par les services secrets américains. Ce n’est pas, à notre connaissance, le seul dossier où cela arrive. Nizar Trabelsi, déjà jugé et condamné en Belgique, doit être extradé aux Etats-Unis pour y être … rejugé. Quelles sont les raisons invoquées par le Parquet ? Il y a quelques mois, l’avocate de Nizar Trabelsi s’exprimait en ces termes : Il nous est pratiquement impossible de le vérifier. Des extraits, seulement, de procès-verbaux sont fournis par les Américains, […] et quand on en demande d’autres, on nous répond que c’est impossible “parce que ces documents appartiennent à des autorités étrangères”. Nous ne pouvons donc pas évaluer le sérieux de la demande américaine ; et, dès lors, nous devons faire une confiance aveugle au parquet fédéral belge qui la relaye [1].
Or, une chose jugée ne peut l’être une seconde fois, et il est impossible de savoir si les Américains ont des éléments différents de ceux pour lesquels Trabelsi a déjà été jugé.

Les nouvelles pratiques et lois antiterroristes permettent ainsi à la machine répressive de s’étendre. Le délit de « participation aux activités d’un groupe terroriste » en une des notions centrales. Il n’est même pas nécessaire d’avoir des preuves matérielles d’une implication dans la commission d’actes violents, ou d’en « préparer ». Le contact, quel qu’il soit, avec un groupe qualifié de terroriste suffit aux poursuites. C’est sur cette base-là qu’ont été poursuivis des islamistes [2], mais aussi certains sympathisants du DHKP-C, ainsi que les 4 membres du Secours Rouge belge.

Or, dans le cas du Secours Rouge, on ne sait pas ce que les photos des inculpés faisaient dans le jardin d’un « terroriste » italien. Quelle que soit la nature de la relation qui existait entre ces militants d’extrême gauche ou certains d’entre eux, et peu importe l’absence de preuves, l’interprétation que le Parquet fait de la loi est maximale.
Dans le cas des sympathisants du DHKP-C, il est clair que Bahar Kimyongur, par exemple, n’a jamais été lié à la préparation d’actes violents. Son activité était parfaitement légale… Incroyable, lorsqu’on pense que les personnes poursuivies risquent des peines extrêmement lourdes : de 5 à 10 ans de prison.
En termes juridiques, la loi est incomplète et doit être interprétée (Voir Pour bien comprendre). C’est dans les prétoires que, techniquement, vont se dessiner ses contours (voir notre interview de Jean-Claude Paye, à paraître le 21 septembre). C’est ce qu’on appelle la jurisprudence. L’instruction terroriste se base sur l’interprétation d’une loi volontairement floue. Et les nouvelles du front ne sont qu’à moitié bonnes…
Car le Parquet est en guerre. Et chaque bataille lui permet de renforcer son emprise sur l’interprétation de la loi. Un premier procès lui a (partiellement) donné raison : il s’agit de celui de la filière irakienne, appelé le procès GMIC. Les condamnations des membres présumés de cette filière ont consolidé la vision que le Parquet se fait de la loi [3], à savoir un instrument idéologique à portée extraterritoriale. Mais, encore une fois, cela ne vaut pas que pour les islamistes. Dans quelques semaines, le nouveau procès des sympathisants du DHKP-C va s’ouvrir le 14 octobre [4]. Au cas où la Cour suit le Parquet dans son argumentaire, la jurisprudence répressive de la loi sera renforcée dans la définition de la participation à un groupe terroriste (diffusion d’un communiqué) ainsi que dans les aspects extraterritoriaux [5].
Dans l’affaire du Secours Rouge (dont les inculpés ne sont pas encore au stade du procès – mais ça ne saurait tarder…), les enjeux sont un peu les mêmes pour notre super-Parquet. Il s’agit de condamner ces militants sans preuves, sur base d’une interprétation maximale de la notion de « participation aux activités d’un groupe terroriste ». Cette condamnation acquise, voilà notre loi, déjà pas mal carrée sur les bords, qui va se voir renforcée.
Voilà les faits... Mais c’est quoi finalement ce concept de terrorisme ? Qu’est-ce qui se cache derrière ? Nous essaierons d’en expliquer l’essence politique dans la dernière partie de cet article :
"Quand ils viendront nous chercher..."
Fiona Wallers
[1] Le Soir, 4 février 2009
[2] Voir à propos de la condamnation des membres du GMIC l’analyse du Comité T, Rapport 2008, p.14, et la Carte blanche dans Le Soir du 6 mai 2008
[3] voir le Rapport 2008 du Comité T, et à propos de l’affaire du DHKP-C, l’article de Jean-Claude Paye, La Belgique précise sa loi antiterroriste, juillet 2009, [http://www.lejpb.com/paperezkoa/20090703/145283/fr/La-Belgique-precis...
[4] Pour rappel (pour ceux qui sont arrivés à suivre la saga) la Cour d’Appel de Bruxelles, dans un quatrième jugement, a demandé la modification des charges concernant certains prévenus. Pour la Cour, la Parquet aurait été trop loin en accusant Bahar Kimyongur d’être le « dirigeant d’un groupe terroriste ». La requalification en « membre d’un groupe terroriste » a été demandée. Pas question de se réjouir : les charges revues à la baisse semblent calibrées pour qu’une condamnation puisse être portée.
[5] Le DHKP-C est un groupe armé agissant contre le pouvoir répressif de l’Etat turc, voir à ce propos Les droits humains en République turque, Rapport 2009, Amnesty international, http://www.amnesty.org/fr/region/turkey/report-2009
Les lois antiterroristes ont ému les défenseurs des libertés et des droits fondamentaux, et les militants actifs dans les luttes contre les inégalités et l’injustice. La violence légale trouverait là son application la plus dure. Comment se cache la répression de la contestation derrière la traque au « terroriste » ? Les deux articles précédents tentaient de montrer la réalité des lois antiterroristes, et leurs enjeux juridiques. Nous terminons ici en tentant de montrer l’étendue de la répression pour les mouvements de gauche.
Cet article est la troisième partie d’un dossier, qui se clôturera le 21 et le 22 septembre par les interviews de Laurent Bonelli et de Jean-Claude Paye, tous deux sociologues spécialisés dans l’étude des lois liberticides.
3.Qu’est-ce que le terrorisme ?
Après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, les mesures antiterroristes adoptées (ou simplement « améliorées ») dans plusieurs pays ont été justifiées presque partout par la nécessité de protéger les populations contre les horreurs des actions violentes d’islamistes.
A bien y regarder, il s’agit bien d’un gros mensonge. Nous ne sommes pas les seuls à l’avoir découvert, mais voici quelques éléments… de preuve.

Premier élément : les mesures qu’on a voulu vendre comme une nouveauté nécessaire, à cause du danger islamiste mondial, ne le sont pas du tout.
En effet, des mesures très dures de lutte contre les actes « terroristes », dont les inculpations sans preuve matérielle et des durées de garde à vue étendues, existent depuis les années quatre-vingt en France [1]. En Espagne, la lutte contre les militants basques n’a pas été inventée en 2001 : l’état d’exception et les tortures seraient généralisés dans les poursuites.
Certes, la loi de 2003 en Belgique introduit des modifications dans le code pénal. C’est nouveau. Mais ce qui est remarquable c’est que les délits soi-disant visés étaient déjà réprimés par d’autres lois. Ici, les peines encourues sont beaucoup plus lourdes, et surtout, l’interprétation est plus grande.
Deuxième élément : les islamistes jouent parfaitement le rôle d’épouvantail pour une population effrayée par les attentats meurtriers aux Etats-Unis, ou par les combats lointains en Afghanistan. Mais on a vu qu’ils étaient loin d’être les seuls touchés. En France, l’affaire Tarnac (ainsi que d’autres poursuites et arrestations) démontrent aussi que ces législations sont utilisées contre la mouvance dite « de gauche ». Ce n’est pas par hasard que le 13 juin 2008, l’ancienne Garde des sceaux (Ministre de la justice) en France a rédigé une circulaire à tous les procureurs de France pour attirer l’attention sur « la multiplication d’actions violentes […] susceptibles d’être attribuées à la mouvance anarcho-autonome ». La direction des affaires criminelles demande ainsi aux magistrats saisis de telles affaires d’« informer dans les plus brefs délais la section antiterroriste du parquet de Paris » en vue d’un « dessaisissement à son profit » [2].
Des altermondialistes belges, des militants d’une organisation turque de gauche, des membres du Secours rouge ont aussi été des cibles.
Rien d’étonnant à cela, la police et la Sûreté observaient, surveillaient les groupes ou les individus militants depuis très longtemps. Sauf qu’ici, ce qu’on constate, c’est que la loi permet les poursuites. Et que certains espèrent des condamnations.
Troisième élément : l’argument principal, qui est la chasse aux islamistes qui voudraient s’attaquer à des innocents en Belgique, est contredit par les faits. On l’a vu, dans le procès de la filière irakienne, comme dans les poursuites engagées contre les membres présumés de la filière afghane, l’accusation est centrée sur des activités de recrutement et d’entraînements à l’étranger. Les présumés terroristes se voient reprocher d’avoir l’intention de se battre en Afghanistan ou au Pakistan [3].
Il s’agit là de l’une des manifestations les plus « étonnantes » de la nouvelle loi : l’extraterritorialité. En effet, dans ces dossiers, les prévenus sont poursuivis sur la base de leur appartenance présumée à des groupes étrangers, agissant en dehors de la Belgique, (dans le cadre d’une guerre qui peut s’apparenter à de une lutte pour la libération nationale.)
Dans une carte blanche écrite au moment du procès des personne présumées appartenir à la filière irakienne, des chercheurs et défenseurs des droits de l’Homme se demandaient : Ce ne serait donc pas les caractéristiques intrinsèques d’un combattant qui feraient de lui un criminel, mais simplement le fait qu’il est désigné comme tel par l’administration américaine. C’est le pouvoir que se donne celle-ci de nommer un ennemi comme un terroriste que conforte le tribunal. Cette reconnaissance l’intègre dans un ordre de droit impérial [4] [5].
Extraterritorialité et définition politique du terrorisme
Ces éléments sont explicites. Ils nous amènent à conclure que les lois antiterroristes, ainsi que la batterie de mesures de recherches et de surveillance (souvent proactives) définissent une tactique des autorités publiques face aux actes politiques. Car le pouvoir se donne ici la possibilité de définir la « moralité » d’un acte politique, qu’il soit posé sur son territoire, ou à l’étranger.
La situation dans laquelle se trouvent les sympathisants du DHKP-C en est aussi un exemple. La lutte de ce groupe politique a comme objectif le pouvoir turc ; les actions violentes qu’il a mené ne se déroulent que sur le territoire turc. C’est donc bien une définition « morale »qui détermine la condamnation des actions de ce groupe [6]. L’exemple de la lutte du FLN algérien, celle de Nelson Mandela en Afrique du Sud ou plus actuellement celle de militants palestiniens pour la libération de leurs terres ont été qualifiées de terroristes. Les poursuites politiques se basent sur des lois d’exception, et aboutissent alors à des peines très lourdes [7].
Ces lois et mesures d’exception s’inscrivent dans une redéfinition globale du droit pénal. Celui-ci devient un instrument puissant au service des rapports de force de la géopolitique mondiale. Les attentats du 11 septembre ont permis aux Etats-Unis d’imposer leurs conceptions du bien et du mal au monde entier. Les lois et autres mesures antiterroristes en étaient le vecteur…[Lire notre interview de Jean-Claude Paye].
Du concept d’ennemi de la liberté à la criminalisation des mouvements sociaux.
La lutte contre le terrorisme, telle qu’elle se développe depuis les attentats du 11 septembre, introduit un renversement total des perspectives qui fait apparaître les droits fondamentaux comme obstacles à la « sécurité » et leur restriction comme un moyen nécessaire pour protéger les citoyens du terrorisme défini comme menace principale de la « démocratie » [8]. C’est de cette manière que les questions principales, qui concernent les libertés de pensée, d’expression, d’association, de manifestation sont occultées. La loi généralise les procédures d’exception, elle ne porte pas sur des faits, elle ne s’attaque pas à des délits matériels. Cela lui permet d’élaborer une « image » définie politiquement du « terroriste ». On peut alors dire que La définition même de l’infraction terroriste introduit un concept flou dans le droit pénal qui peut donner lieu à des interprétations très différentes selon les orientations politiques du moment (et celle de la personne appelée à juger) [9].
Malgré les mises en garde formulées avant l’adoption de la loi antiterroriste en Belgique, les activités des mouvements sociaux sont donc bel et bien susceptibles d’être visées. Les poursuites contre des militants de gauche, sans aucun élément de preuve quant à leur implication dans l’élaborations d’actes violents, en témoigne [10].
Si aujourd’hui les autorités ont du mal à s’attaquer aux mouvements organisés, la lutte pour la consolidation de la loi par la jurisprudence, les mesures attentatoires aux libertés, construisent petit à petit un système puissant de répression.

L’urgence est là. Le 14 octobre, le procès en appel contre les sympathisants du DHKP-C sera ouvert ; dans quelques mois, les 4 inculpés du Secours Rouge seront fixés sur la poursuite des accusations de "participation aux activités d’un groupe terroriste"...
Pour que les lois liberticides ne fassent pas taire les militants et tous ceux qui critiquent la violence sociale, comme nous, il s’agit de se battre.
Fiona Wallers
[1] Voir Interview de Laurent Bonelli
[2] Nouvel Observateur, 31 juillet 2008
[3] Les éléments concernant une attaque des membres présumés de la filière afghane sur le sol dur le sol belge semblent non-vérifiables, voir la première partie de notre article
[5] Voir aussi Comité T Rapport 2008 : Ces derniers auraient agi dans le but non pas de lutter contre l’occupation américaine de l’Irak, mais d’y fonder un Etat islamique. Or, il s’agit ici d’une appréciation tout à fait subjective de faits de violence que même la communauté internationale a des difficultés à qualifier clairement.
[6] Et cela malgré les condamnations récurrentes du régime turc pour sa politique en termes de libertés et droits fondamentaux, voir à ce propos Les droits humains en République turque, Rapport 2009, Amnesty international
[7] Il est à ce propos intéressant de se rappeler les obstacles surgis lors de la mise en place de la loi de compétence universelle en Belgique en 2003, loi qui a été fortement limitée quelques mois après son adoption..., voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence_universelle
[8] Emmanuel-Pierre Guittet, Antiterrorisme et société, Cultures et Conflits, Ed L’Harmattan, 2006
[9] Axel Bernard, Les lois antiterroristes menacent nos libertés, in Ensemble, Journal du Collectif contre l’exclusion n°63, Sept-oct. 2008
[10] Lire aussi dans ce numéro 1 l’article de Didier Brissa sur les "mis sur écoute"
Jean-Claude Paye est sociologue. Depuis le début des années 2000, il se consacre à l’étude des lois antiterroristes en Belgique, et aux évolutions des lois liberticides aux Etats-Unis, comme Vers un Etat policier en Belgique, (Editions EPO, 2000) et Global War on Liberty (Telos Press, 2007).
Plus récemment, il s’est concentré sur la construction de l’image du terroriste et aux modifications du rapport entre le citoyen et l’Etat : Les inculpés de Tarnac, un renversement et L’affaire Tarnac, ou le règne de l’image
(Le titre est de la rédaction)
Le 11 septembre 2001 représente-t-il une césure dans l’élaboration des lois antiterroristes ?
Les lois antiterroristes s’inscrivent dans une modification de l’ordre pénal qui débute avant le 11 septembre 2001 et avant la généralisation des mesures antiterroristes. On constate qu’il y a une modification du rapport police/justice et du rapport entre la justice et les citoyens bien avant le 11 septembre.
Il suffit de voir en Belgique la loi sur la police unique ou la loi sur l’enquête proactive, qui est déjà un ancêtre de la loi antiterroriste.
Quels sont les réels objectifs poursuivis par cette accélération dans l’adoption de lois répressives ?
C’est une modification d’une forme d’organisation du pouvoir. C’est dire qu’on construit une nouvelle forme politique de dictature, où il n’ y a plus aucun cran d’arrêt à la toute puissance du pouvoir. Avant, la loi était quelque chose qui mettait un frein, une barre à la toute puissance du pouvoir. C’était toujours une question de rapports de force, mais un rapport de force qui était permanent. Ici, ce qui change dans la structure de la loi, c’est que la loi contient elle-même sa propre dérogation. On arrive dans une forme d’écriture du droit qui est une forme tout à fait subjective qui se substitue à l’ancienne forme qui était une forme objective.
La loi antiterroriste est vraiment le prototype même de cette subjectivation du droit parce qu’au minimum, elle crée des délits d’intention. Elle crée aussi des délits d’appartenance, c’est-à-dire que l’on est poursuivi non pas parce qu’on a commis un délit particulier ou quelque chose d’objectif, mais parce qu’on appartient soi-disant à une organisation qui, elle-même, est désignée comme terroriste. Et cette mesure d’appartenance est très large : ça peut être des contacts occasionnels ou fragmentaires. C’est donc le juge qui décide s’il y a appartenance ou pas et sa marge d’interprétation est maximale.
Mais il y a des pays qui vont beaucoup plus loin, tels que les Etats-Unis, la Grande Bretagne. On criminalise au-delà de l’intention qui est attribuée. On crée ce qu’on appelle un délit d’atmosphère.
Cet élément a-t-il été adopté par l’Union européenne ?
Sur le continent, on essaie de faire passer ce genre de choses par le biais de la jurisprudence, c’est-à-dire par les procès.
On peut prendre l’exemple du procès DHKP-C.
Dans les jugements qui condamnent, comme le premier jugement d’appel, les considérations sont intéressantes parce qu’elles disent explicitement que tout ce qui donne connaissance sur les positions d’une organisation désignée comme terroriste peut, à son tour, être considéré comme un acte terroriste.
C’est-à-dire que toute parole qui s’écarte de la politique étrangère du gouvernement belge, vis-à-vis de mouvements de libération nationale par exemple, pourrait être considérée comme un acte terroriste.
Donc on fait au niveau d’un procès, d’une jurisprudence, des choses qui sont très proches de ce qui se fait en Angleterre, dans la loi. En Angleterre par exemple, des gens ont été poursuivis pour incitation directe au terrorisme pour avoir énoncé publiquement le nom des soldats anglais morts en Irak… Là on crée aussi une atmosphère favorable au terrorisme, on incite les gens à combattre donc c’est de l’incitation indirecte.
Est-ce que cette loi vise des mouvements particuliers ?
La loi antiterroriste moderne est différente des lois antiterroristes qui existaient auparavant. Avant, par exemple en France ou en Angleterre, il existait des lois antiterroristes qui visaient à s’attaquer à des mouvements déterminés. Ici, les nouvelles lois antiterroristes ne visent pas des mouvements déterminés, ne visent pas un ennemi intérieur, mais l’ensemble de la population.
Le plus bel exemple est une loi américaine, le Military Commissions Act, qui est adoptée en 2006. Cette loi, qui est en fait un acte constitutionnel mondial, permet à l’exécutif américain de désigner comme ennemi ses propres citoyens ou tout citoyen d’un pays avec lequel les Etats-Unis ne sont pas en guerre. On devient ennemi parce qu’on est nommé comme tel. D’ailleurs il n’est pas nécessaire de dire pourquoi, ni d’avoir de preuve. Ça c’est la notion d’ennemi combattant illégal [1]. Là, on voit à quoi sert la loi antiterroriste : redéfinir le rapport qui existe entre les gens et l’Etat.
Le pouvoir de l’Etat se transforme en pouvoir de dictature, par le contrôle total…
Il n’y a rien qui s’oppose à lui, c’est une dictature.
Les attentats du 11 septembre s’inscrivent dans une psychose. Les Américains ne cherchent pas à être crus. L’objectif n’est pas de créer une fausse conscience, mais de créer le délire. Le fait lui-même devient objet de délire.
Les attentats du 11 septembre servent à renforcer cette structure psychotique et à engendrer le délire. Si le pouvoir dit « vous êtes terroristes », il n’a même pas à expliquer pourquoi ou à énoncer quelque fait.
On voit que l’appareil judiciaire aménage son propre droit pour que le Military Commissions Act aie force de loi dans les pays européens. Par exemple, le procès français et le procès belge sur les filières kamikaze et irakienne ont créé une jurisprudence.
Ces lois ont comme but une extraterritorialité totale et un contrôle non pas seulement du territoire national …
L’extraterritorialité n’est pas quelque chose de nouveau. Toutes les lois antiterroristes américaines depuis la fin des années septante se sont toujours donné une compétence extraterritoriale. Le droit d’aller faire des coups d’Etat dans des pays, de prendre des gens de les enlever pour pouvoir les incarcérer et les juger aux Etats-Unis.
L’exemple de Tarnac en France, qui est symbolique, la lutte nationale contre des gens qui s’écartent de ce qui est admis par le pouvoir : est-ce que c’est l’un des buts des lois antiterroristes ?
Ce qui est intéressant dans Tarnac, c’est la fabrication de l’image. L’image du terrorisme ici c’est une image pure ; c’est-à-dire qu’il n’y a aucun rapport avec les faits matériels. On a attaqué des gens qui n’ont commis aucun acte. Ils se positionnent simplement comme gens qui se trouvent à l’extérieur de la société, et contre l’Etat.
C’est une image parfaite, et donc elle est parfaitement réversible.

L’Etat dit « ce sont des terroristes qui menacent l’intégrité de l’Etat » et eux ils se disent « nous sommes l’ennemi intérieur tout puissant qui faisons chanceler l’Etat ». Donc vous voyez ici que les deux parties sont dans la même image.
Le pouvoir ne choisit pas les gens au hasard. Pour pouvoir généraliser le dispositif antiterroriste, on a besoin d’avoir des groupes « relais ». Et cela se fait en s’attaquant aux islamistes, aux sympathisants du DHKP-C.
Mais dans le cas de Tarnac, on crée aussi un autre type d’image, qui signifie que le pouvoir nous dit à travers ça exactement ce que le pouvoir dit aux Etats-Unis par le biais de la loi : on a le droit de tout faire.
Le groupe de Tarnac parait la proie idéale pour être « bouc émissaire » ; mais certains syndicalistes sont aussi poursuivis, avec d’autres lois. Est-ce que la volonté de contrôle de l’Etat s’attaque seulement aux islamistes et aux gens de Tarnac, ou alors aussi aux mouvements sociaux etc. ?
Ils s’attaquent aux deux de façon différente. L’attaque contre les mouvements sociaux ou ce qu’il en reste n’est pas une attaque médiatisée. Et la construction de l’image a pour but de nous enfermer dans la psychose mais elle a également pour but de faire écran aux faits, c’est à dire à tous les gens qui sont arrêtés et aux mouvements sociaux réels.
Où en sont les jurisprudences en Europe ?
On va toujours de plus en plus loin. La loi elle-même crée des notions d’incitation au terrorisme, puisqu’avec la jurisprudence on arrive à la notion d’incitation indirecte, de soutien indirect au terrorisme. Donc, les lois antiterroristes se renforcent.
Le rapport aux faits devient de plus en plus lâche et incertain. Et on arrive dans un droit subjectif pur.
Ce qu’on sait depuis longtemps, c’est que l’appareil judiciaire reste tout de même divisé, la preuve dans le procès DHKP-C. Ça reste peut-être le seul élément qui offre une petite résistance à toute l’évolution du droit pénal au niveau européen. Et on sait cela depuis 15 ans, depuis que le but du pouvoir est de mettre au pas l’appareil judiciaire. Liquidation du juge d’instruction en France, réduction de ses prérogatives en Belgique, on augmente celles du parquet tout en le contrôlant d’avantage. Tout va dans le sens d’une instrumentalisation de plus en plus étroite du pouvoir judiciaire. Pour liquider les résistances partielles à cette tendance liberticide.
Propos recueillis par Fiona Wallers
[1] ndlr qui permet de ne pas leur appliquer la troisième Convention de Genève
Interview de Laurent Bonelli, sociologue et maître de conférences en science politique à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre. Il est notamment l’auteur de La France a peur. Une histoire sociale de « l’insécurité » (La Découverte, 2008) et a co-dirigé, avec Didier Bigo et Thomas Deltombe, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme (La Découverte, 2008).
Est-ce qu’il faut voir dans les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis l’origine des lois antiterroristes en Europe ? Est-ce qu’il y a dans ce domaine une nette césure depuis cette date ?
La plupart des législations antiterroristes ne datent pas, loin s’en faut, des attentats du 11 septembre 2001. Il existe une tradition qui varie selon les pays, mais la plupart des pays européens ont été confrontés aux questions de violence politique de manière bien antérieure, que ce soit dans les années ‘70 avec les mouvements radicaux d’extrême gauche, que ce soit dans les années ‘80 avec la question moyen-orientale.
Prenons l’exemple français : l’essentiel du dispositif était en place dès le milieu des années ’80. En Espagne, le traitement des attentats de 2004 va très largement s’inscrire dans la continuité du dispositif qui était déjà en vigueur dans la lutte contre l’ETA.
Mais qu’est-ce qui a changé alors ?
Les changements les plus importants se sont déroulés aux Etats-Unis après le 11 septembre, par la mise en place d’une architecture nouvelle : le Department of Homeland Security, le vote du Patriot Act, etc.
En Europe, rien d’aussi radical, si ce n’est l’affirmation progressive du rôle de la Commission européenne, après les attentats de 2001, puis ceux de Madrid en 2004 et de Londres en 2005. Cela va se traduire par l’adoption de directives antiterroristes (sur la liste des organisations concernées, la lutte contre le recrutement, radicalisation ou la propagande, etc.), de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent ou contre le financement du terrorisme. Ca va être aussi un certain nombre d’accords bilatéraux que va passer l’Europe avec le Etats-Unis, par exemple dans le cadre des PNR, les Passenger Name Records, l’échange d’informations sur les compagnies aériennes.
C’est une occasion, une carte que va jouer la Commission européenne pour exister politiquement, notamment vis-à-vis des Etats-Unis.
Pourquoi n’y a-t-il pas eu au niveau national une opposition face à ces lois qui posent problème au niveau de leur interprétation et de leur application ? Quels sont les intérêts en jeu ?
Ce qui se passe au niveau national reste différent de ce qui se passe au niveau européen. Les continuités, je le disais, l’emportent très largement. En Espagne, il n’y a eu absolument aucune modification. Et pas même à partir des attentats de mars 2004, si ce n’est dans l’affectation d’effectifs policiers supplémentaires dans les sections « terrorisme international ».
En France, les modifications n’ont eu lieu qu’en 2007, avec la fusion des services de renseignements. Mais ça n’a rien à voir avec le 11 septembre. Ce sont des logiques plutôt économiques.
En Angleterre, des mesures avaient été prises dès 2000.
Les dynamiques nationales restent largement autonomes, mais le 11 septembre a servi d’accélérateur, si bien qu’on peut parler des mesures prises au nom du 11 septembre. Et partout en Europe, elles vont dans le même sens : le renforcement des capacités de contrôle, l’utilisation de plus en plus répandue de systèmes d’interception, de systèmes de contrôles des communications etc., et l’extension, plutôt continue également, des pouvoirs de police et de collecte de renseignements ; et, bien sûr, de diminution des droits de la défense. Un affaiblissement qui se traduit notamment par l’allongement des gardes à vue, des périodes durant lesquelles les avocats ne peuvent pas avoir accès à leur client, l’utilisation du secret défense pour un certain nombre de données qui sont ensuite utilisées devant les tribunaux, etc.
La condamnation sans preuves
Mais il y a quelque chose d’important et de nouveau : c’est l’intention comme preuve…
Ce n’est pas nouveau. Mais l’une des tensions qui existent sur la question de l’antiterrorisme, c’est qu’il y a deux logiques de police qui sont parfois contradictoires.
L’une est celle de la police criminelle qui consiste à identifier, et à amener les preuves devant le juge de la culpabilité d’un individu dans la commission de tel ou tel type de crime ou de délit.
La seconde, la logique de renseignement, est toute autre. Elle suit une dynamique préventive et va bien au delà de la précédente. Il s’agit de collecter des informations sur ce qui se passe dans toute une série de secteurs de la vie sociale ou politique, pour déceler ce qui pourrait porter atteinte à l’ordre politique, social ou tout simplement public. De là la surveillance des syndicats, des mouvements militants, et bien sûr des groupes radicaux, même s’ils n’agissent pas sur le territoire (le MRTA [1] péruvien en France par exemple). A la différence de leurs homologues de la police judiciaire, les services de renseignements n’ont pas le souci de la preuve.
Et la lutte antiterroriste est au carrefour de ces deux logiques.
Les services antiterroristes ne peuvent guère se permettre d’intervenir après l’attentat. Ils essaient d’intervenir en amont. Or la question est :" comment pouvez-vous intervenir sur des choses qui ne se sont pas encore produites ?"
Il y a plusieurs options.
Après le 11 septembre, les Etats-Unis ont a choisi la logique guerrière, avec l’attaque de l’Afghanistan puis de l’Irak. Mais aussi une logique de renseignement poussée à son paroxysme. On n’a plus le souci d’apporter la preuve, plus le souci de la présomption d’innocence, plus le souci des débats contradictoires. Ça se traduit comment ? Par des enlèvements. On enlève des gens sur le territoire d’un pays étranger, on les torture, et on peut les détenir de manière indéfinie – à Guantanamo, Diego Garcia [2] ou ailleurs – sans leur reprocher formellement quoi que ce soit. Les Britanniques ont fait la même chose qu’à Guantanamo.
A l’inverse, vous avez la logique très judiciaire, ce qu’on a pu observer en Espagne.
Enfin, vous avez une voie médiane comme en France, où s’est élaboré ce qu’on pourrait appeler la neutralisation judiciaire préventive. C’est-à-dire un usage judiciaire des suspicions des services de renseignement. Le fer de lance de cette conception est l’incrimination d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ou AMT. C’est une notion très large, qui permet de punir de 10 ans d’emprisonnement – et la loi de 2006 l’a porté à 20 ans – l’appartenance à un groupe d’individus qui veut ou qui pourrait commettre des actions violentes. Ca permet de mettre ces personnes en détention préventive durant l’enquête, pour une durée qui peut aller jusqu’à 2 ans. L’éventail est très ample et les services de renseignement l’utilisent pour donner un coup de pied dans la fourmilière, comme ils disent, c’est-à-dire pour arrêter, de manière très large, des "suspects".
La plupart des mis en examen n’arrivent pas au procès. Ils sont innocentés au cours de l’instruction ; ils étaient là parce qu’ils avaient le numéro de quelqu’un dans leur carnet d’adresse, etc.
L’AMT est néanmoins présentée par ses partisans comme un formidable outil pour déstabiliser les réseaux radicaux et pour mettre à mal leur logistique. C’est parfois vrai, mais cela pose question. D’abord, elle autorise l’incarcération des personnes contre lesquelles les éléments à charge sont légers, puisqu’elle repose le plus souvent sur des intentions et non sur des faits. Selon les chiffres du Ministère de la Justice, parmi les 358 personnes qui étaient en détention (détention provisoire comprise) pour une incrimination terroriste en 2005, 300 l’étaient pour AMT. Et si l’on s’intéresse à l’ensemble des condamnations pour AMT de 2003 à 2006, on s’aperçoit que cette dernière apparaît comme infraction principale (c’est-à-dire qu’elle n’est pas accompagnée d’une infraction de nature criminelle) dans la moitié, voire dans les quatre cinquièmes des cas selon les années. C’est-à-dire qu’on n’a rien de plus grave à leur reprocher…
Et ça concerne, en termes de condamnations, entre 50 et 70 personnes par an.
Quelles sont les organisations les plus visées ? On imagine que se sont les organisations islamistes…
C’est curieux, mais l’AMT va très largement être utilisée contre les militants basques, corses, et puis islamistes.
C’est qu’il y a une autre mesure qui les touche directement. Ce sont les expulsions et les interdictions du territoire français.
…Et donc on les expulse vers le Maroc et l’Algérie où l’on pratique la torture…
Oui, pour les Basques et les Corses c’est plus compliqué …
On a vu avec le groupe de Tarnac que ces lois sont utilisées pour toucher des groupes de personnes de gauche ou contestataires…est-ce que des instructions sont données pour surveiller des groupe des gauche ?
Il y a d’abord une dynamique bureaucratique, que les événements de Tarnac ont illustrée clairement. Les mesures exceptionnelles à bien des égards qu’emploient les forces de l’ordre contre des Basques, des Corses ou des islamistes soulèvent rarement autre chose que de l’indifférence. D’où la tentation de les étendre à d’autres groupes. Mais là, il y a eu une levée de boucliers qui les a surpris… Finalement l’exception ne semble marcher que lorsqu’elle se déploie sur des groupes construits comme menaçants. Et dans le cas de Tarnac, personne n’a vraiment cru réellement à cette « dangerosité ».
La deuxième chose concerne ce qu’on peut appeler un effet de cliquet : les textes s’accumulent dans un sens répressif et on ne revient pas en arrière. Si bien qu’une fois que la législation existe, on est tenté de l’utiliser au-delà du groupe initial qu’elle visait. En France, on a créé un fichier pour les empreintes génétiques des délinquants sexuels les plus graves. Puis, graduellement, le fichier s’est étendu à un ensemble de plus en plus vaste de crimes et délits. Aujourd’hui un outrage et rébellion peut vous conduire à donner vos empreintes génétiques…
A propos de Tarnac, on est dans un contexte politique qui, avec une crise sociale qui se développe, est un contexte particulier. Avec de surcroît une faiblesse organique des partis de gauche institutionnelle. Les partis socialiste et communiste ont pendant très longtemps pu donner une forme d’encadrement à la révolte, ce qu’ils sont bien incapables de faire aujourd’hui.
La résurgence de formes de violence radicale comme on a pu en apercevoir avec la mobilisation anti CPE ou anti-OTAN constituait donc une menace plausible pour le gouvernement conservateur.
Enfin, je rajouterai un troisième élément qui est un élément plus conjoncturel. Il y a eu une fusion des Renseignements Généraux et de la DST (la Direction de la Surveillance du Territoire), les deux services de renseignement politique internes. C’est plutôt la DST qui a pris l’ascendant et eu les postes importants. Dans ce contexte, les Renseignements Généraux ont tenté de réagir en montrant que ce qui était important, c’était la question de l’extrême gauche, qui, heureux hasard, était de leur compétence exclusive... On peut aussi voir dans l’affaire de Tarnac une tentative pour réévaluer bureaucratiquement leur position.
Condamnation idéologique de la violence
Est-ce que ces mesures sont utilisées pour la surveillance des syndicats ?
Pas nécessairement. La surveillance des mouvements sociaux est ancienne, et ne nécessite pas forcément le recours à des techniques spécifiques. Par contre, c’est le rapport des institutions à la violence politique et sociale qui se modifie. Il est intéressant de voir qu’aujourd’hui, on qualifie de groupes terroristes des groupes qui, il y a encore une quinzaine d’années, étaient considérés comme des militants politiques, des résistants, des insurgés ou des combattants de la liberté. Des groupes comme le PKK, qui n’ont aucune activité violente sur le territoire allemand, y sont désormais poursuivis car ils prônent la violence pour servir ses idées politiques. Des textes similaires existent en Grande-Bretagne.
Qu’est ce qui est à la base de telles décisions ? Est-ce la classe politique, ou est-elle dépassée par les impératifs d’autres groupes ?
Je crois que c’est un mouvement général tant au niveau européen que national. Il faut revenir au milieu des années ‘90 au moment de la constitution de l’espace européen comme espace politique. Et là il faut revenir sur le protocole Aznar – du nom du Premier ministre espagnol de l’époque – qui a réussi un tour de force extraordinaire. C’est celui d’affirmer qu’il ne pouvait pas y avoir de violation des droits politiques en démocratie et que comme tous les Etats européens étaient des démocraties, le statut de réfugié politique ne pouvait pas exister entre Etats de la communauté européenne…
Le fond de l’affaire concernait une querelle entre la justice belge et le gouvernement espagnol, à propos de la question basque. La première refusait d’extrader vers l’Espagne deux militants supposés d’ETA. Les Belges disaient : nous n’avons aucune garantie que ces gens ne pourront pas être torturés, ni qu’ils auront un procès équitable... Le contexte était celui de la révélation de l’existence des groupes antiterroristes de libération (GAL), des véritables escadrons de la mort para-officiels qui avaient exécuté des Basques en France à la fin des années 1980. Aznar a eu gain de cause, et plus aucun Européen ne peut être reconnu comme réfugié politique dans un autre pays de l’Union…
Au niveau intérieur, les violences collectives sont de plus en plus réprimées. C’est notamment ce que l’on voit dans les manifestations, où, pendant très longtemps l’action des forces de l’ordre était de maintenir l’ordre, c’est-à-dire de canaliser les protestataires et de circonscrire le plus possible les violences. Aujourd’hui, on essaie d’arrêter les manifestants violents et de les faire condamner. Six syndicalistes de l’usine Continental de Clairoix viennent ainsi d’être condamnés à de la prison avec sursis pour le saccage de la sous-préfecture de Compiègne en avril dernier. Et ce type de jugement est de plus en plus fréquent.
Est-ce qu’il y a déjà eu une utilisation d’éléments des lois antiterroristes contre des syndicalistes en France ?
La marge est très ténue. Théoriquement, rien n’empêcherait d’utiliser l’association de malfaiteurs en relation avec entreprise terroriste contre des syndicalistes qui menacent de faire exploser leur usine. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. La régulation de la violence politique dépend avant tout des rapports de forces politiques. C’est une dimension fondamentale. On aurait tort de penser que la lutte antiterroriste, c’est juste attentats versus répression policière ou militaire. La question antiterroriste, c’est aussi tout un ensemble de mesures de négociation : des mesures de clémence pour des activistes emprisonnés, une modification de posture diplomatique etc. Il y a tout un éventail de mesures (l’exemple récent de la libération de l’auteur de l’attentat de Lockerbie en atteste). Donc ce qui joue, c’est le rapport de force politique. Aussi longtemps que vous avez un mouvement plutôt structuré, plutôt fort, ce qui est encore le cas du mouvement syndical, c’est plus compliqué d’utiliser des dispositifs antiterroristes. C’est par contre beaucoup plus facile sur des groupes minoritaires…
Comment voyez-vous la suite ? Comment vont se faire les modifications dans l’application des ces lois ?
En 1980, à l’époque de l’adoption de la loi "sécurité liberté" qui prévoyait le passage de la garde à vue de 48 à 72 heures, la gauche, et notamment le PS, hurlait au fascisme : « ces lois sont plus liberticides que Vichy » s’écriaient des députés. En 2006, le même Parti socialiste s’est courageusement abstenu lorsque les lois antiterroristes ont fait passer la garde-à-vue à 144h… Il y a 25 ans, personne n’aurait pu prévoir l’inflation sécuritaire que connaissent les démocraties occidentales... Ce qui veut dire que rien n’est jamais écrit et que sur ce terrain comme sur les autres, l’avenir de nos sociétés dépendra des luttes pour le construire.
Propos recueillis par Fiona Wallers
[1] ndlr : Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, mouvement de guerilla communiste né en 1984
[2] ndlr : Atoll britannique de l’Océan indien abritant une base militaire américaine
Quand les législations dites « contre le crime organisé » sont détournées pour s’attaquer aux militants.
(les intertitres sont de la rédaction)
Même si de grandes mobilisations l’on précédée, on considère généralement l’organisation à Seattle à 1999 de manifestations d’opposition à la réunion du G8 comme point de départ des mobilisations altermondialistes au nord de l’hémisphère. Sur le plan européen, ce n’est pas seulement le G8 mais aussi les grands sommets de l’Union européenne qui rythment les mobilisations de toutes les forces qui contestent l’instauration d’un ordre néolibéral à l’échelle planétaire.
Au second semestre 2001, c’est à la Belgique qu’échoit la présidence de l’U.E. A cette occasion, elle compte organiser trois sommets sur son territoire, dont le premier, devant réunir les ministres des finances et du budget des différents états-membres (ECOFIN), doit se tenir à Liège, ville de Didier Reynders, déjà alors sinistre des finances du royaume…
Une ville assiégée... Mais par qui ?
Du côté des autorités belges et liégeoises, l’ambiance est plutôt à l’inquiétude, voire à la panique, suite à la fois à l’ampleur croissante des mobilisations et de leur radicalité, mais aussi à la multiplication des incidents qui les émaillent : fruits de « vrais fauteurs des troubles » et « d’anarchistes autonomes » ou provocation des tenants de l’ordre ? Bien des lignes ont été écrites sur les fameux « Black Blocks » sans pour autant jamais pouvoir éclaircir les choses entre la réaction de groupes radicaux face à une hyper-mobilisation policière et infiltrations dans les manifestations [1].
Dans les milieux militants liégeois, l’ambiance est à la mobilisation. Suite aux récents événements de Gênes (e.a. mort de Carlo Giuliani, un manifestant abattu par la police [2]), il y a de fortes pressions des autorités pour que, si manifestation il y a, celle-ci ne se tienne pas simultanément au sommet lui-même. Pression à laquelle cèderont à la fois organisations syndicales et ONG’s, dont ATTAC qui organisera la veille du sommet, une journée d’étude à l’Université de Liège, dont le campus du Sart-Tilman situé dans la proche campagne hors la ville…
Différents groupes associatifs et partis de gauche refusant l’ukase des autorités sur la date de la manifestation –d’autant plus que celles-ci mettent en place une large « zone rouge », rendant inaccessible les lieux à proximité du sommet – créent donc un collectif organisateur pour la mise en place d’une manifestation durant le sommet lui-même. Il s’appellera « S22versD14 » en référence à ce que cette première manifestation à Liège le 22 septembre 2001 serve de mobilisation en faveur de la manifestation principale contre le sommet de clôture de la présidence belge prévu le 14 décembre 2001.
Ce collectif se choisit des porte-paroles : Arnaud Leblanc (Indymédia), Raoul Hedebouw (PTB) et moi-même (collectif « A Contre Courant ») et entreprend de solliciter auprès du Bourgmestre [3], toutes les autorisations nécessaires. Pour ce faire, les porte-paroles le rencontrent à plusieurs reprises, en même temps que quelques responsables de la zone de police. Définition du parcours, conditions de la manifestation, sont négociées pas à pas. Celle-ci réunira quelques milliers de personnes et se déroulera sans le moindre incident. Arnaud Leblanc recevra de surcroît les félicitations de Willy Demeyer, le Bourgmestre…
Des méthodes (très) particulières
Deux ans plus tard (2003), les trois porte-paroles et un preneur de son de la RTBF (associé au dossier au seul titre d’être le propriétaire d’une péniche-salle de concert ayant servi pour une soirée musicale commémorant les victimes des répressions policières à Gènes) se voient adresser par le Palais de justice de Liège une convocation en Chambre du Conseil visant à statuer sur leur éventuel renvoi devant un tribunal… du chef d’accusation d’association de malfaiteurs…
Chacun de son côté, un peu éberlué, se disant qu’il devait s’agir d’une homonymie ou d’une erreur, se rendra au tribunal pour consulter son dossier et constater qu’il est bel et bien personnellement concerné ! En effet, sous l’impulsion d’une plus haute autorité, la police et le parquet ont ouvert une enquête préventive quant à l’organisation des manifestations pouvant avoir lieu contre l’ECOFIN. N’ayant rien d’autre à se mettre sous la dent afin de justifier de leur utilité, ils ont adressé une requête à une juge d’instruction afin de pouvoir nous appliquer des méthodes particulières d’enquête (principalement des écoutes). Pour ce faire, ils ont présenté à la juge une affiche de concert, un tract (invitant à une réunion publique et comportant nos numéros de téléphones comme contact), un rapport de police sur l’observation de la tenue dudit concert et, last but not least, un rapport de synthèse des analyses des polices danoises et italiennes (suite à Göteborg et Gènes). Ce sont ces éléments qui ont permis à la juge d’estimer, a priori, qu’elle avait des éléments déterminants ne laissant aucun doute sur le fait que nous constituions bien une « association de malfaiteurs », éléments nécessaires pour qu’elle puisse autoriser le recours à des méthodes proactives d’enquêtes à notre encontre.

La Chambre du Conseil rendra rapidement une ordonnance de non-lieu tout en stigmatisant à la fois la légèreté des autorités judiciaires ayant autorisé le recours à de telles méthodes et le fait que celles n’avaient pu que nuire à nos droits constitutionnels garantissant tant la liberté d’expression que de manifestation…
Quand les crocs altermondalistes rayent le Parquet
Trois ans (2006) s’écoulent à nouveau, pour voir un nouveau pli de justice arriver dans les boîtes aux lettres de nos 4 « malfaiteurs »… Ne se trouvant pas encore assez ridicule, le Parquet ayant fait appel de la décision de la Chambre du Conseil, nous sommes cette fois convoqués devant la Chambre des Mises en Accusation qui doit statuer sur notre sort… Après consultation de notre dossier, nous n’y découvrons pas une seule ligne d’instruction supplémentaire par rapport au premier dossier. Rien, que dalle, nada !!! Nos avocats ne voient qu’une seule explication à cela, l’appel ne porte pas quant au fond, mais aux motivations qui tançaient sévèrement le Parquet…
C’est donc dans une mise en scène ubuesque que nous nous retrouverons au tribunal face à un procureur dénonçant la paranoïa de ses propres services et l’inopportunité de nous poursuivre pour quoi que ce soit vu la vacuité de son dossier… ne laissant plus ainsi pour tâche à nos avocats que de conclure en réclamant que la Chambre des Mises en Accusation veuille bien reprendre à son compte les motivations de la décision de la Chambre du Conseil, ce qui sera fait prestement par le Président du Tribunal qui ajoutera ce commentaire : « c’est la deuxième fois seulement je rencontre une telle situation en 25 ans de carrière, le parquet aurait bien mieux à faire que de me faire perdre mon temps ! »
Pour nous aussi, cela commençait à bien faire et l’acharnement du Parquet contre nous, plus d’autres désagréments (dont, entre autres, le constat que même après jugement, la mention « connu pour des fait d’association de malfaiteurs » restait associée à nos noms dans les dossiers de la police), nous ont décidés à ne pas laisser cette affaire sans suite.
En parallèle, nos avocats pensaient que les motivations répétées de nos jugements nous fournissaient amplement matière à déposer une plainte contre l’Etat belge, pour faute. Cela méritait à la fois un temps de réflexion et des démarches afin de permettre une telle entreprise, car nos avocats nous annonçaient à la fois des délais pouvant potentiellement aller jusqu’à une décennie de procédure et un coût de plusieurs milliers d’euros. Mais il nous a semblé que la nécessité de concourir à l’établissement d’une jurisprudence interdisant l’usage de telles méthodes policières à des fins politiques et notre volonté que d’autres ne connaissent pas les mêmes désagréments pour le simple exercice de leur droit, nous ont motivé à poursuivre l’Etat belge en justice. Dans mon cas, le soutien financier et politique de mon employeur, la Régionale FGTB de Liège-Huy-Waremme fut un élément déterminant quant à la possibilité d’entamer une telle action.
Le 9 septembre 2008, un peu moins de 7 ans après les faits, un tribunal civil de Liège a tranché, définitivement espérions-nous, sur la validité de notre plainte. Et c’est une triple victoire qu’il nous concède :
Premièrement, le tribunal reconnaît qu’il y a eu faute dans le chef du magistrat instructeur lorsqu’elle autorisa l’usage de méthodes proactives contre nous. Ensuite, qu’il y a eu faute également au niveau du Parquet lorsqu’il fit appel du premier jugement, nous entraînant inutilement dans de longues procédures.
Enfin que pour ces fautes, et leurs conséquences sur nos vies, l’Etat était en devoir de nous indemniser non seulement des frais de justice que nous avions encourus mais aussi du dommage moral qu’il nous avait causé. Espérons maintenant qu’un tel jugement puisse faire jurisprudence ; qu’il motive d’une part les législateurs à revoir leur copie sur ces législations d’exception que sont les lois sur « les organisations criminelles et les maffias » et « antiterroristes » qui autorisent des pratiques d’enquêtes et des dérives largement attentatoires aux droits démocratiques ; qu’il puisse servir aussi aux militants qui subissent de plus en plus fréquemment les assauts de plus en plus outranciers d’une certaine justice de classe, revancharde et politiquement orientée à droite, qu’on a vu se manifester ces dernières années dans de multiples affaires (conflit de Clabecq, huissiers munis d’astreintes devant les portes d’entreprises en grève, accusation d’association de malfaiteurs contre les militants de Greenpeace, affaires Bahar Kimyongur et Abou Jahjah, et tout récemment le dossier ubuesque des militants du Secours Rouge).
Le Parquet n’est pas (encore) laminé
Malheureusement pour nous, à l’extrême limite du délai légal, l’Etat a fait appel de la décision. Le nouvel avocat de l’Etat entendant démontrer à la cour que l’Etat ne peut être condamné sur la forme, car il aurait raison sur le fond (à savoir que nous sommes bel et bien une « association de malfaiteurs »…). Les avocats des deux parties ayant déjà échangé leurs arguments dans le courant du premier semestre 2009, nous sommes dans l’attente du jugement pour novembre prochain… Confiants en nos positions, nous l’attendons avec impatience, la partie adverse n’ayant apporté pas un seul élément neuf mais tentant désespérément d’éclairer sous un jour paranoïaque et criminel nos démarches citoyennes.
Même s’il ne semble que de « principe », même s’il entraîne des procédures de longue durée, même s’il ne remet pas en cause les injustices fondamentales d’un système judiciaire à l’image des rapports de forces de notre société, j’espère que notre combat illustre l’utilité de se mobiliser et de combattre de l’intérieur l’ennemi sur son propre terrain… Ne fut-ce aussi que parce que cela donne aux magistrats qui n’ont pas encore cédé aux pressions des courants dominants l’occasion d’exprimer une justice qui s’attache à la défense les valeurs et les droits fondamentaux de la démocratie.
Didier BRISSA
Militant Altermondialiste.
Ndlr : différents documents, dont les décisions juridiques sont disponibles sur le site des "mis sur écoute".
[1] Toujours est-il qu’en 2001, à Gènes, dans une ruelle à l’arrière des manifestations, l’auteur de ces lignes a personnellement assisté à la descente de combis de la police italienne de personnes visiblement déguisées en « black blocks ». Mais en toute complicité avec la police en uniforme également présente.
[2] Voir entre autres le récent arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
[3] Soit l’Autorité locale responsable pouvant délivrer ou non l’autorisation de manifestation
Témoin direct des multiples évacuations des sans-papiers les 30 et 31 juillet dernier, Cédric nous décrit ce qu’il a vu et entendu : injures, coups de matraques, agressions, chasses à l’homme. Pour les grands médias, l’évacuation s’est déroulée sans incidents. Mais ils n’ont pas vu le reste, rassurés par les porte-paroles policiers.
Les faits
Les 30 et 31 juillet 2009, près de mille travailleurs sans-papiers ont été jetés à la rue par la police de Bruxelles qui a méthodiquement liquidé toutes les occupations de sans-papiers combattants. Seuls trois ou quatre “citoyens réguliers”, passant là par hasard, ont pu témoigner de ce qui s’est passé ces deux jours et porter maigre assistance à une poignée de clandestins.
Et pour cause, les dates étaient bien choisies... En termes de calendrier nous sommes après les deux instructions ministérielles qui prévoient pour l’une qu’on régularise (une seule fois) les personnes qui entrent dans des critères relativement restrictifs, pour l’autre, que les personnes qui n’entreront pas dans ces critères soient expulsés du territoire [1]. Cet été, les travailleurs associatifs et les militants qui soutiennent habituellement les sans-papiers et qui ont obtenu une conclusion provisoire à des années de lutte, ne sont pas sur la brèche. Les “responsables” politiques, à quelque niveau que ce soit, sont en vacances.
Le coup d’envoi de l’opération de police est donné le 30 juillet vers six heures du matin. Une vingtaine de camionnettes de la police de Bruxelles-Ville débarquent boulevard de l’Empereur où quatre cent quatre-vingts travailleurs sans-papiers campaient et réclamaient leur régularisation. Surpris dans leur sommeil, ils sont violemment évacués à coups de matraques et de gaz lacrymogène. Deux arrestations ont lieu, ces personnes seront relâchées dans l’après-midi. Nombre des occupants sont blessés, certains s’éparpillent dans la ville et trois cent se rassemblent derrière l’ancienne gare de la Chapelle.
Alertés de ce chambardement, quelques personnes tentent de leur porter assistance. Pour l’heure, l’inquiétude des sans-papiers porte sur la recherche d’un lieu d’hébergement pour le soir même. Une première tentative dans un bâtiment vide de la rue d’Arlon, se solde par une réponse policière d’une brutalité injustifiable. A l’issue de ce premier essai, sept personnes sont emmenées en ambulance, dont deux qui ont été défenestrées. Les crises d’asthme se comptent par dizaines. Où qu’ils aillent ensuite, ils sont reçus par des pelotons de police survoltés. Les injures racistes et les menaces fusent. Des charges sans raison apparente se succèdent avant que la police se retire et revienne à nouveau. De six heures le matin à vingt heures, ces personnes ont été littéralement harcelées dans les rues de Bruxelles.
Agenda politique
Le 30, l’ordre de mission de la police est clair et précis : évacuer le boulevard de l’Empereur et empêcher l’accès au centre-ville. Les pourparlers qui ont eu lieu entre les quelques citoyens présents et la hiérarchie policière ne laissent pas de doute sur la nature de l’opération. Il ne s’agit nullement de rafles en vue d’expulsions, pas plus que d’opération de contrôle. L’Office des Etrangers est étranger à l’action. Il s’agit "simplement" d’en terminer avec l’occupation. Une ordonnance d’évacuation a été rendue sur requête unilatérale en extrême urgence le 13 juillet et le Bourgmestre de la Ville attend le 30 pour faire procéder à l’évacuation.
A cette date, l’administration communale, le Parti Socialiste [2], l’Office des Etrangers et les ministères compétents sont absolument injoignables. Dans les jours qui suivent, chacune des occupations bruxelloises, notamment à Schaerbeek et à Saint-Josse, subissent le même sort. Si bien qu’aucun des foyers historiques de la contestation des sans papiers n’existe plus au début du mois d’août. Si ces opérations quasi simultanées n’ont concerné qu’un service de police, elles mobilisent au moins trois administrations communales. Dans cette configuration et ces conditions de concordance de temps, il est difficile de ne pas imaginer que ces actions n’ont pas été politiquement coordonnées. Un agent de police témoigne d’ailleurs anonymement qu’au moment de la première évacuation, les autres sont déjà planifiées. L’ampleur de la mobilisation policière ne peut d’ailleurs pas laisser supposer le contraire.
Il est donc probable (et cette précaution de langage est un peu surfaite) que les autorités politiques en charge des questions relatives à l’immigration clandestine aient décidé d’enterrer le problème politique. Une directive pour légitimer toutes les expulsions à venir, une autre établissant des critères de régularisation, pour pouvoir prétendre avoir répondu aux critiques d’inertie faites aux gouvernements successifs.
En réalité, aucune politique d’immigration (autre que le désastre humain et social que nous connaissons déjà) n’est mise en place. Au plus, une mesure ponctuelle qui contentera une poignée d’étrangers clandestins, laissera sur le carreau la majorité d’entre eux et réservera aux cohortes de nouveaux arrivants les conditions “d’accueil” qui fondent cette originalité occidentale : misères sociales, exploitation dans le travail, aucun accès aux droits humains même les plus élémentaires, traque, peur, enfermements, violences, expulsions.
La police ne fait pas de politique… …mais quand même.
Quand dans le règlement d’un litige aussi éminemment politique, le seul interlocuteur présent est la police, elle n’a pas vraiment le choix sinon de prendre des options politiques. Ici se croisaient la politique générale et la politique de comptoir.
D’un côté, la hiérarchie ne pouvait contourner la recherche d’une solution à la présence dans les rues de Bruxelles d’un si grand nombre de personnes. Les disperser purement et simplement était illusoire, ils n’avaient nulle part où aller. Il a donc fallu trouver une alternative. En l’occurrence, compter sur une présence citoyenne pour se débarrasser du problème. Ce choix est d’ailleurs relativement légitime puisque les ordres donnés par l’autorité politique sont en réalité inapplicables sur le terrain et qu’il n’y a pas de mandat pour aller au-delà de la liquidation (solution de relogement, enfermement en vue d’expulsion du territoire…). La question s’est donc posée de savoir si les sans-papiers seraient en sécurité après avoir investi un autre bâtiment. Et, corollairement, si la chasse à l’homme allait se poursuivre toute la nuit. Il était évident que la réponse à la première question devait être oui, puisque l’opération n’était pas prévue pour durer. Une partie de la violence et de la colère des agents armés se devait d’ailleurs peut-être au surcroît d’heures supplémentaires imprévues ce jour. En fin de soirée, les agents ont rejoint leurs pénates et les sans-papiers ont trouvé un abri de fortune. Jusqu’au lendemain.
D’un autre côté, les agents en uniformes armés de leur matraque, développaient à l’égard des travailleurs sans-papiers, une rage et une agressivité difficilement compréhensibles. Mais les propos et comportements racistes qu’ont subis les sans-papiers sont aussi d’ordre politique. Ils étaient le résultat de la libre expression politique de personnes qui doivent s’abstenir quand elles revêtent l’uniforme et la neutralité qu’il suppose : « Servir et protéger / Neutralité et bienveillance ». Outre les brutalités physiques, c’est en hurlant « j’vais t’faire regretter l’envie d’avoir quitté ton pays », « sale macaque » ou « avion, avion » que les agents chargeaient les sans-papiers. Dans un contexte social et politique où les étrangers clandestins sont traités tels des sous-hommes, sans droit ni légitimité d’être, il n’y a rien d’étonnant à ce que le racisme primaire se voie pousser des ailes parmi les agents qui sont censés faire respecter la loi.
La question de la relation entre la troupe et sa hiérarchie lorsqu’il s’agit de brutalité policière reste entière. Une clé de compréhension de cette journée de terreur vient de cette observation in situ : chaque fois que les responsables hiérarchiques de l’opération policière arrivaient sur les lieux, les violences cessaient. Aucune violence n’eut jamais lieu en leur présence. Difficile de tirer des conclusions immédiates à l’observation de ce phénomène. Est-ce que la troupe se cache de sa hiérarchie pour verser dans l’illégalité et l’outrance ? Par jeu ? Est-ce que cette partie clandestine du travail des agents procède d’une entente tacite et que la hiérarchie ne peut en être témoin ? Cette violence fait-elle partie d’une stratégie établie ? Est-elle le fait d’une discrète volonté politique d’une partie du corps de police ? Y avait-il des ordres ? Venant de quel niveau de pouvoir ? Nous ne le savons pas, mais cependant, le fait est.
Pour ne pas conclure
Le 31 juillet, le groupe de deux cents qui restait de l’occupation du boulevard de l’Empereur quitte son abri de fortune et intègre l’ancienne librairie Agora au 330 avenue de la Couronne, à Ixelles. “Echaudés” par leurs récentes expériences d’expulsions, les occupants se signalent au bourgmestre faisant fonction (celui-ci qui n’avait pas d’occupation à évacuer sur sa commune, était présent). Avec l’aide du curé de l’église du Béguinage, ils prennent une assurance responsabilité pour le lieu et les occupants. Ils contactent le propriétaire (un agent immobilier qui attend un permis de détruire) et signent avec lui une convention qui leur permet de disposer des lieux jusqu’au 15 octobre. A présent, la police d’Ixelles encadre et contrôle l’occupation de l’Agora avec une apparente bienveillance. Cependant, nous pouvons être sûrs que lorsque viendra l’ordre d’évacuation, les sourires s’effaceront et la police fera son travail.
Depuis cette date, et plus encore depuis le début du ramadan, ce groupe de sans-papiers militants est livré à lui-même. Sauf de façon très ponctuelle, il ne reçoit aucune aide politique ou logistique de la part des citoyens, militants ou travailleurs associatifs. Et pour cause, ses derniers croulent sous les dossiers de régularisation à constituer pour les “régularisables potentiels”, sans doute un bénéfice secondaire de l’agenda politique évoqué plus haut.
Les alternatives sont maigres pour les sans-papiers de l’Agora, dont de nombreux sont “hors critères”. Une solution est de se replier sur soi-même, et de prendre acte du tarif établi par l’Etat belge : 50 jours de grève de la faim = une carte orange. Une autre est de prendre acte du naufrage du mouvement des sans-papiers, et de prendre en main la reconstruction d’une lutte nationale qui, si elle est menée avec finesse, intelligence et nouveauté, aboutira peut-être un jour à l’imposition d’une politique d’immigration cohérente et acceptable en terme de droits humains. Cette branche de l’alternative nécessite cependant une forte mobilisation citoyenne. Mobilisation qui est actuellement à son niveau le plus bas depuis la dernière régularisation de 1999-2000.
La question qui reste pendante : est-ce que toutes celles et tous ceux qui, depuis 1996, se sont battus pour une politique d’immigration respectueuse des droits humains, vont accepter de se laisser dicter leur calendrier de lutte par le ministère de l’immigration et les logiques institutionnelles, au gré des annonces et des situations d’urgence artificiellement créées ?
Cédric
Les grands médias ont largement ignoré ces scènes de chasse à l’homme, se contentant des discours rassurants des autorités policières. En voici quelques exemples :
– Lire l’article du Soir relatif à l’évacuation à Bruxelles-Ville
– Lire la dépêche reprise sur le site de RTL concernant le départ des sans-papiers d’un bâtiment schaerbeekois
– Voir le reportage de RTL relatif à l’évacuation du Bd de l’Empereur
– Plus nuancés, des "mini-reportages" disponibles sur le site de RTL-TVI de même que le reportage final évoquent une intervention musclée pour le délogement des sans-papiers de l’immeuble place Saint-Lazare. Mais seuls les "mini-reportages" donneront la parole aux sans-papiers, le reportage final se contentant de la parole du chef de corps et du bourgmestre. Voir ce reportage et les vidéos annexes.
Gérard Craan
[2] Dans la majorité à Bruxelles-Ville, et Saint-Josse, ces deux communes ayant également des bourgmestres PS. Par ailleurs, le "13, Boulevard de l’Empereur" est, rappelons-le, le siège du PS devant lequel s’étaient "installés" des sans-papiers
Pourquoi une manifestation tourne-t-elle mal alors que la précédente avait été sagement encadrée par les policiers ? Pourquoi telle police locale est-elle réputée pour sa brutalité, alors que telle autre non ? Pourquoi les autorités politiques sont-elles souvent "injoignables" lorsque ça cogne ? Pourquoi la "bavure" n’en est-elle pas vraiment une ?
Dans un récent article, Cédric évoquait la prise de responsabilité politique du corps de police lors "d’évacuations" de sans-papiers. L’absence des autorités politiques (bourgmestre ou collège de police s’agissant de la police locale [1]) durant ces évacuations manu polici a fortement restreint le contrôle des ces opérations. Les "débordements" [2] ont, selon notre journaliste indépendant et militant, été nombreux : injures, racisme, matraquages et même défenestrations. Nul doute qu’une enquête sera exigée pour "faire toute la lumière" sur ces allégations.
C’est que de l’ordre politique du maïeur au coup de matraque du pandore, la chaîne hiérarchique est complexe. Mais maîtrisée. De sorte que chacun, du flic moustachu de base au bourgmestre en passant par le chef de corps, y trouve son compte.
Le "chèque en gris" où de l’usage mesuré du gourdin
Différentes lignes de conduite guident l’action policière. La plus évidente est la loi, dont la loi sur la fonction de police [3] et plus encore les textes [4] relatifs aux droits fondamentaux, contraignants, que chacun doit respecter : liberté d’association, de réunion, d’opinion, de manifestation, etc .
De l’autre côté, le travail quotidien du policier l’amène à suspendre les droits fondamentaux des personnes qu’il contrôle, arrête, interroge ou encore, évacue, matraque, brutalise, arrose. On pourrait penser que tout cela repose sur une législation sans failles, adéquatement codifiée. Et que dès lors qu’on entre intact dans un commissariat et qu’on en ressort amoché, ce sera avant tout parce qu’on se sera cogné en cellule, qu’on s’est rebellé [5], et enfin, peut-être parce que le policier s’est emporté. La "bavure" quoi. Jamais ! Ô grand jamais ! un ordre ne vient d’en haut intimant de brutaliser une personne ou un groupe de personnes.
Tout simplement parce qu’il n’est pas besoin de donner de consignes très détaillées. Il suffit de donner à l’action policière une marge de manœuvre et d’interprétation. Les mandats qui sont donnés à la police prennent la forme d’un chèque en gris. La signature et les montants consentis sont sont, d’une part, assez imprécis pour fournir au ministre qui l’émet le motif ultérieur d’une dénégation possible de ce qui a été effectivement autorisé ; ils sont toutefois suffisamment lisibles pour assurer le policier qui reçoit le chèque d’une marge de manœuvre dont il pourra, lui aussi, plausiblement affirmer qu’elle lui a été explicitement concédée. Et de conclure que les deux parties se protègent en établissant la base d’un litige sans fin [6].
La pratique ? Un chèque en gris qui ne laisse pas de bois
Appliqué aux évacuations des sans-papiers des 30 et 31 juillet [7], le chèque en gris peut nous aider à comprendre. Imaginons.
Après quelques éventuelles vaines [8] tractations avec les sans-papiers quant à leur évacuation volontaire avant la fin juillet [9], ordre aura été donné de procéder à l’évacuation par la contrainte.
Nous avons cherché à en savoir plus sur la transmission effective de cet ordre d’évacuation. Contactée, la commune affirme que le Bourgmestre agit au cas par cas. Mais qu’il y a toujours un ordre du bourgmestre ou du collège de police, transmis par écrit au chef de corps. Il mentionne entre autres que les sans-papiers évacués ne doivent pas être arrêtés s’il n’y a ni rébellion, ni violence. Pour leur éviter un signalement à l’Office des Etrangers et une possible expulsion nous explique l’attaché de presse, Nicolas Dassonville. Il y a donc une attitude politique des autorités communales qui est officiellement très claire. Là où nous entrons dans la zone floue, c’est que la Ville affirme avoir pris contact avec les associations de défense des sans-papiers 24 heures au préalable afin d’aviser les sans-papiers de leur évacuation prochaine. Au départ très vague, l’attaché de presse du Cabinet du Bourgmestre a finalement lâché quelques noms d’associations. Si ce ne sont les réunions de concertation liées à l’organisation de manifestations, aucune d’entre elles n’affirme avoir été en contact avec les services maïoraux concernant la gestion d’une évacuation future. Le Comité d’action et de soutien des sans-papiers nous a répondu ne plus avoir de contact avec la commune depuis plusieurs mois et que jamais il n’a été question de prévenir les sans-papiers d’une évacuation. Le CIRé, cité par la commune, a même dit ne pas soutenir les occupations.
Par ailleurs, Nicolas Dassonville affirme ne pas du tout avoir eu d’échos [10] concernant des actes de violence de la police. Si c’est le cas, les sans-papiers peuvent toujours déposer plainte. Et de compléter que vu les contacts très réguliers avec les associations (ndla : dont nous venons en fait de démontrer la vacuité), nous aurions été au courant. En fait, ce que souhaite nous montrer la commune, c’est qu’elle prend ses responsabilités politiques et prétend humaniser les évacuations tandis que la police est censée appliquer les ordres. Et que dans la négative, les "dérives", "bavures" et autres "débordements" sont du chef de la police elle-même.
Mais selon un conseiller communal, le bourgmestre de Bruxelles-Ville ne contrôle pas toujours les actes de sa police. Et que lorsqu’il agit, c’est plutôt pour tempérer celle-ci. Par ailleurs le contrôle sur la police locale de la zone est une zone nébuleuse où conseil de police et conseil communal se renvoient le ballon.
Nous sommes en plein dans l’application pratique du chèque en gris : faute d’ordres, personne n’est responsable.
Avec un ordre de mission incomplet, la police agit et "prend des responsabilités" qui ne lui ont été ni interdites ni demandées. Coutumière des évacuations de sans-papiers [11], elle se doute que sitôt évacués, ils trouveront place ailleurs.
Mais en ce 30 juillet, un accord gouvernemental sur une régularisation partielle [12] d’environ 25.000 personnes a été trouvé depuis quelques jours [13]. Qui plus est, cette régularisation, si elle laisse des dizaines de milliers de sans-papiers dans l’ombre de la clandestinité, est applaudie par une grande part du mouvement associatif [14] plaidant pour une régularisation. Pour la police, le mouvement n’a donc plus de raisons d’être, ses constituantes humaines non plus. Et elle a les mains libres pour les chasser et les décourager de s’installer ailleurs. Couplée au racisme, aux heures supplémentaires des flics en poste, à la déshumanisation du sans-papier, cette marge de manœuvre pourrait sans peine expliquer la brutalité policière [15].
De cela, nous devons sans doute retenir que la police est aux ordres, surtout quand elle n’en a pas.
Gérard Craan
[1] La plus haute autorité de la police fédérale est le Ministre de l’Intérieur ; pour la police locale, il s’agit du bourgmestre dans sa commune.
[2] Voir la chronique linguistique de ce mois de Christine Oisel consacrée à la violence
[3] Loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
[4] Tels la Constitution Belge ou la Convention européenne des Droits de l’Homme, toutes deux contraignantes
[5] Nous reprenons ici les propos du directeur pour le pôle France d’Amnesty International : Nous avons effectivement reçu ces dernières années un nombre important et croissant de plaintes de particuliers assurant avoir été victimes de représailles sous la forme de plaintes pour "outrage" ou "rébellions" de la part des policiers qu’ils accusaient de mauvais traitement. Les magistrats interrogés par Amnesty le constatent aussi et certains reconnaissent qu’ils ont tendance à accorder naturellement plus de crédit au détenteur de l’autorité publique. que l’on peut retrouver en intégralité ici.
[6] Ce concept a été développé par Jean-Paul Brodeur dès le début des années 90’. Il est appliqué en Belgique par Smeets S. et Tange C : "pour un équilibre démocratique des contrôles. Le contrôle sur la police", in Pour suite d’enquête... Essais sur la police et son rôle dans notre société, ss dir. Duhaut et al., 2001, pp 103-131
[7] Ainsi qu’à la chasse à l’homme qui les a immédiatement suivie
[8] Pour les sans-papiers, ne pas disposer d’un espace est le meilleur moyen de passer inaperçu et donc de ne pouvoir militer pour une régularisation. Sans espace, pas de papiers. A défaut de proposer une alternative crédible et de ne discuter que des modalités "sécurité, hygiène, ordre public" d’une occupation temporaire les autorités attaquent de front le mouvement, que ce soit voulu ou semi-conscient
[9] Les sans-papiers occupaient un bâtiment vide et un terre-plein en face du boulevard de l’Empereur, siège du PS, depuis le 9 juillet
[11] Pour rappel, la dernière régularisation de masse remonte à 1999-2000, diminuant ponctuellement le nombre de sans-papiers en Belgique. Les flux migratoires ne se tarissant pas, les sans-papiers ont recommencé leurs actions dès 2003. Ces actions prennent la forme de manifestations, d’occupations, de grèves de la faim. C’est ainsi que diverses églises, universités, propriétés d’Etat, lieux symboliques, bâtiments vides, voire à l’abandon ont servi d’espace de visibilité aux sans-papiers. Les occupations, même avec accord du propriétaire des lieux, sont généralement temporaires. Au cours de ces six dernières années, la police est régulièrement intervenue pour déloger les sans-papiers
[12] Parce que basée sur des critères stricts, parce que très complexe. Voir le vade-mecum des autorités à ce sujet
[13] Lire cette dépêche RTBF/Belga
[14] lire par exemple le communiqué du Forum Asile et Migrations, dont font partie la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers ainsi que la CSC et la FGTB.
Par contre, la Ligue des Droits de l’Homme a publié une carte Blanche dans le Soir où elle s’interroge sur le rôle de soupape de sûreté de cette régularisation.
[15] Pour un exemple de traitement inhumain et dégradant par la police (selon le Comité P) à l’égard des sans-papiers où, la aussi la responsabilité de chacun était diffuse, lire un rapport annexe du Comité P 2007-2008 (pdf)
Quelle légalité et quelle légitimité pour quelles violences dans nos geôles ? [1] Le fait de « légaliser les prisons » revient-il à garantir les droits des détenus, et/ou à légitimer le monde pénitentiaire et institutionnaliser la violence de la prison ? Quelques idées non consensuelles ...
(les intertitres sont de la rédaction)
Les prisons belges sont-elles régulées par le droit ? Cette question, en apparence naïve, ne l’est pas. Jusqu’en 2005, le monde pénitentiaire, enclin, par sa fonction même de privation de liberté, à limiter les droits humains, n’était régi par aucune loi. Seules des circulaires ministérielles détaillaient son mode de fonctionnement, c’est-à-dire ce que détenus et agents pouvaient faire, etc. ( le principe en prison est le suivant : tout ce qui n’est pas explicitement permis est interdit).
Depuis 2005, il existe une loi « concernant l’administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus », communément appelée Loi Dupont, du nom de son auteur. Nous poserons cinq remarques et interrogations quant à cette loi.
Un monde sans lois ?
1. Il peut paraître incroyable que l’univers des prisons n’ait, jusqu’en 2005, jamais été réglé par une loi dans notre pays. Cependant, le fait de se lancer dans un processus législatif pourrait, dans le contexte carcéral, revenir à légitimer une des violences institutionnelles et un des rapports de pouvoir dégradants les plus intenses existant au sein de notre société. La réalité pénitentiaire, c’est non seulement la privation de liberté, mais c’est aussi le surpeuplement (parfois trois personnes dans 12m² et un matelas à même le sol, seulement deux douches par semaine pour certains), le désœuvrement (beaucoup de détenus passent la plupart du temps enfermés en cellule sans rien faire à part regarder la TV et dormir), la misère sexuelle, un climat de tension permanente, la menace constante de brimades, d’insultes, etc. [2] Le fait de légiférer en matière carcérale pourrait tant permettre de limiter les abus de pouvoir que d’entériner et d’accepter cette situation et l’état des lieux désastreux des prisons. En ce sens, l’établissement d’une loi pénitentiaire ne pourrait-il pas être vu comme un révélateur d’un « consensus pragmatique » sur l’existence des prisons, leur situation de délabrement ou le rapport de sujétion et de dépendance totale qu’il instaure ?
2. La loi a-t-elle fondamentalement changé l’univers carcéral ? Hélas, les articles de loi n’entreront en vigueur qu’en fonction d’arrêtés royaux de mise en application. Résultat : il y a très peu de parties de la loi en vigueur. Force est donc de constater que la loi n’est pas appliquée et qu’elle s’est moulée à l’une des grande caractéristiques du monde pénitentiaire : l’immobilisme.
3. Sans rentrer dans les détails de la loi et de son contenu, notons (de manière non exhaustive) quelques parties qui sont entrées en vigueur :
– les principes généraux de la loi (limitation des effets préjudiciables de la détention, participation, normalisation, réparation, réinsertion) [3]. Cette partie de la loi, pour les observateurs internes de la prison, est très franchement de l’ordre du néant quant à sa réelle mise en œuvre.
– la rémunération des personnes exerçant les fonctions de cultes, autrefois bénévoles (ce qui nous semble une bonne chose même si leur nombre demeure restreint),
– les mesures d’ordre et de contention particulières en détention.
Ce dernier point est spécifiquement intéressant : il s’agit de légiférer sur les régimes de détention spéciaux, pour les personnes incarcérées considérées comme « dangereuses » (dont lesdits « terroristes »). Cette question particulière pose à nouveau, en écho et de manière concentrée, les mêmes questions générales que pour l’ensemble de la loi. D’une part, on peut considérer positivement le fait de disposer d’un cadre légal censé limiter l’arbitraire et garantir le droit des détenus sur un sujet sensible (au niveau des conditions de détention) comme les régimes de haute sécurité. Mais d’autre part, le fait de légaliser ces régimes ne participe-t-il pas à les légitimer ? Dans les faits, depuis l’entrée en vigueur de cette partie de la loi, deux « quartiers haute sécurité » ont ouvert leurs portes à Lantin et Bruges. Si la durée de détention en régime de ce type est censée être limitée, il arrive qu’elle soit renouvelée sans arrêt (ex : Nizar Trabelsi – il faudra tout de même qu’on m’explique comment un être humain à l’isolement peut faire du prosélytisme...). Et ces régimes demeurent arbitraires, décidées par le chef d’établissement. Ainsi, un détenu qui change de prison peut très bien changer de régime de détention, ce qui pourrait porter à croire que, malgré la loi Dupont, une personne serait peut-être plus ou moins dangereuse selon l’endroit où elle se trouve et l’appréciation du directeur auquel elle a affaire...
Un discours vieux de trois siècles
4. Il est par ailleurs frappant et questionnant de constater que le discours officiel sur les prisons, sur leur évolution et sur leur amélioration demeure identique et récurrent depuis .... le 18ème siècle et la révolution française. Ainsi, rappelons-nous de la belle histoire de nos livres d’école sur la prise de la Bastille par le peuple ? A l’époque, ceux qu’on appelle les tenants d’un discours « humano-utilitaristes » prônent une peine efficace, plus humaine et moins arbitraire. Aujourd’hui, quel est le slogan du Ministère ? « Justice. Humaine et équitable ». A quelle fin ? Le coeur de la « vision » de la prison est, selon un discours maintes fois répété par l’Administration Pénitentiaire, uniquement centré sur des objectifs de management (dont on sait que le maître mot est l’efficacité). [4]
5. On aura compris que nombre de décideurs plaident pour l’efficience des établissements pénitentiaires. La prison serait un mal nécessaire et il n’est pas bon ton de remettre en question son existence. Mais quel est le but de prison ? Aujourd’hui, après avoir porté un idéal de punition (18ème siècle) puis de traitement de l’être humain par l’enfermement cellulaire (19ème siècle), l’institution pénitentiaire a subi une critique sévère (deuxième moitié du 20ème) qui a largement érodé toute vision idéale de la prison [5]. A l’heure actuelle, comme d’ailleurs inscrit dans la loi, on assiste à un réel cumul des fonctions attribuées à la peine de prison : contention, protection de la société, réinsertion, normalisation, réparation, réhabilitation, réadaptation etc. Bref, une polysémie de la peine.
En conclusion, parallèlement à la juxtaposition des fonctions attribuées au monde carcéral, l’instauration d’une loi pénitentiaire peut, quelque part, apparaître comme une façon de légitimer, en soi et pour soi, la prison, tout en faisant l’économie d’une réflexion de fond sur le sens et la place de la taule dans la société. Et ce, paradoxalement, à l’heure où l’on réclame plus de sécurité et moins d’impunité alors que la population carcérale a augmenté de 74% depuis 1980 – sans augmentation parallèle de la délinquance [6]. Cherchez d’où vient la violence ... même si l’on a beau jeu de toujours critiquer l’Etat. La question qui se pose relève sans doute davantage de l’existence-même de cette prison, qui a largement perdu son sens, et du rôle de la sanction et de la punition dans notre société. Une société en collectivité comporte des risques qu’elle devrait peut-être avoir le courage d’assumer.
Fifi Brindacier
- Mise en Détention préventive : processus par lequel une personne est mise en prison avant jugement et avant condamnation. Rappelons que ces personnes sont présumées innocentes bien que le traitement en maison d’arrêt relève de traitements inhumains et dégradants selon le Comité de Prévention de la Torture et des traitements inhumains et dégradants du Conseil de l’Europe. [7]
La détention préventive a été multipliée par 2,5 de 1980 à 2005.
1/3 des personnes mises en détention préventive sont sans-papiers. - internement : processus de privation de liberté pour quelqu’un qui a commis une infraction et qui est considéré comme irresponsable de ses actes. Il est mis en annexe psychiatrique en prison en attente de place en établissement psychiatrique fermé.
Le nombre d’internés a augmenté de 70% en 10 ans en prison.
Le nombre de détenus a augmenté de 74% depuis 1980.
Les libérations conditionnelles sont passées de l’ordre de 1000 à 400 en moins d’une dizaine d’années.
En 25 ans, le nombre de peines de 5 ans et plus a été multiplié par 10. [8]
[1] cf. CARTUYVELS, Y., « Réformer ou supprimer : le dilemme des prisons », in DE SCHUTTER, O. et KAMISKI, D, L’institution du droit pénitentiaire, Ligue générale de droit et de jurisprudence et Buylant, Paris, 2002, pp. 113-133.
[2] constats émis par de nombreux travailleurs sociaux en prison menant la plupart de leurs entretiens, à la demande du détenu, au sein même de leur cellule
[3] MARY, P., La nouvelle loi pénitentiaire, retour sur un processus de réforme (1996-2006), Courrier hebdomadaire du CRISP, 2006, n°1916.
[4] voir le rapport annuel 2008 de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires, en ligne sur le site du SPF Justice, sous la rubrique « Publications »
[5] KAMINSKI, D., « Les droits des détenus au Canada et en Angleterre : entre révolution normative et légitimation de la prison », in DE SCHUTTER, O., KAMINSKI, D., L’institution du droit pénitentiaire, Ligue générale de droit et de jurisprudence & Bruylant, Paris, 2002, pp. 91-113.
[6] Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires, Rapport annuel d’activité, Bruxelles, 2000 et 2007 ; VANNESTE, C., Les chiffres des prisons. Les logiques économiques à leur traduction pénale, Paris, L’Harmattan, 2001 ; VANNESTE, C., « Pénalité, criminalité, insécurité et … économie », in MARY, P., PAPATHEODOROU, T., Délinquance et insécurité en Europe : vers une pénalisation du social ?, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 47-95.
[7] Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2006. http://www.cpt.coe.int/fr/etats/bel.htm
[8] Voir les travaux de l’Institut National de Criminalistique et Criminologie en la matière ; VANNESTE, C., les chiffres des prisons bruxelloises, le détenu : un citoyen comme un autre !, colloque organisé au Parlement Bruxellois, 13/03/08.
Trente-sept ans, ingénieur, père de famille, Stéphane vit en Belgique. A l’université, il était engagé dans les luttes étudiantes. Depuis lors, il milite principalement pour la défense des sans-papiers. Il participe également à des manifestations d’opposition à l’Otan [1] et à des campagnes d’opposition à la présence d’armes nucléaires américaines illégales en Belgique [2]. Nous l’avons interrogé sur ses motivations et en tant que témoin de manifestations "violentes", notamment celles menées en marge du sommet de l’Otan à Strasbourg-Kehl (31 mars – 5 avril 2009). Son témoignage met en lumière d’une part la nécessité actuelle d’être "créatif" pour défendre ses idées, dans une société où la répression de la lutte sociale se durcit et se fait de plus en plus violente. D’autre part, il revient sur la manière dont cette répression engendre la violence.
Bombes nucléaires américaines en Belgique : "un déni de démocratie complet"
Parlons d’abord de ton engagement contre la présence d’armes nucléaires américaines en Belgique. Quels sont les motifs de ton opposition ?
Je participe à la campagne de désobéissance civile contre les armes nucléaires (Bombspotting) principalement parce que pour moi, dans le cadre belge, on assiste à un déni de démocratie complet. Nous avons des armes nucléaires basées à Kleine-Brogel qui sont américaines et le Parlement belge s’est déjà prononcé contre leur présence. Mais les traités internationaux prévalant sur les lois nationales, ces bombes restent là. Le traité est secret donc on ne connait même pas exactement les termes de l’accord. Et on participe ainsi, en Belgique, à la préparation d’un crime de guerre ou de crime contre l’humanité puisque la possession d’armes nucléaires et la menace de leur emploi est déjà considéré comme un crime de guerre voire un crime contre l’humanité [3].
En quoi consiste la campagne Bomspotting ? Quels en sont les moyens d’action ?
Le principe de Bomspotting en Belgique est l’action totalement non-violente, c’est-à-dire une contestation citoyenne de désobéissance civile qui a pour but de faire voir ce qui est invisible. Les armes nucléaires américaines basées à Kleine-Brogel sont rejetées par le Parlement, rejetées par à peu près tous les partis politiques, mais elles sont là et on n’en parle pas. On n’en parle pas sauf quand on arrive, par de l’activisme, à mettre la situation en lumière. On se rend compte que les manifestations ne fonctionnent plus, puisqu’on n’a plus le droit d’aller manifester là où il y a du monde. Alors, pour rendre visible ce qui est invisible, il faut maintenant être créatif. L’idée de Bomspotting c’est d’aller faire des inspections civiles à Kleine-Brogel pour essayer de trouver les indices de la présence d’armes nucléaires, voire de bloquer l’une ou l’autre base. Au moins, ce jour-là, on ne pourra pas utiliser les armes nucléaires et on perturbera de manière significative le fonctionnement de l’Otan. Bomspotting est une campagne qui a lieu chaque année et qui dure depuis plusieurs années, qui consiste à porter plainte contre la présence de ces armes, à les dénoncer dans les médias et symboliquement, à essayer de pénétrer sur les terrains militaires. En Belgique, il est bien sûr puni par la loi de pénétrer sur un terrain militaire mais les tribunaux correctionnels se sont déclarés incompétents. Donc, ce n’est passible que de la Cour d’assises. Evidemment, on n’a jamais trainé aucun militant devant le jury populaire d’une Cour d’assises parce que cela offrirait une tribune formidable au Forum voor de Vredeactie, qui organise Bomspotting, et de manière générale aux milieux pacifistes pour dénoncer ce déni de démocratie complet.
L’Otan, "facteur d’instabilité et d’insécurité"
Tu te mobilises de manière plus générale contre l’action de l’Otan. Pourquoi ?
Je considère que l’Otan est plus un facteur d’instabilité et d’insécurité que le contraire, malgré ce que la plupart des médias laissent penser.
Il suffit de voir les guerres que l’on mène actuellement en notre nom, comme en Afghanistan, où l’armée cherche des terroristes en bombardant des villages et en tuant des civils ! D’une manière beaucoup plus globale et générale, c’est aussi pour moi la défense d’une vision du monde dans laquelle je ne me reconnais pas du tout et qui ne me plait pas du tout. L’Otan est une association militaire qui a pour but de défendre les intérêts et la domination de quelques pays occidentaux, et même de quelques personnes dans quelques pays occidentaux, sur le reste du monde. Pour défendre le profit de quelques uns dans nos pays, on porte la guerre dans les pays pétroliers (il viendra certainement un moment où ce seront plutôt les pays comme le Niger, qui possède de l’uranium, qui seront visés). Et je dis de quelques-uns parce que, au final, ce sont les mêmes qui exploitent dans leur propre pays d’autres personnes pour faire grossir leurs fortunes déjà colossales.
Les manifestations anti-Otan dénoncent cet outil de domination politique, mais aussi industrielle, que constitue l’Otan et, de manière générale, le lobby militaro-industriel.
Comme les manifestations organisées lors du sommet de l’Otan à Strasbourg-Kehl (31 mars – 5 avril 2009), auxquelles tu as participé.
Oui. L’oppression, la domination, l’exploitation s’internationalisent, se globalisent (firmes transnationales, domination évidente des Etats-Unis notamment au travers de l’Otan...). Donc, de mon point de vue, la résistance doit également s’internationaliser et se globaliser. Cela veut dire agir localement mais avec une vue large, globale, de ce qui ne va pas et de ce qui va. Cela signifie aussi penser aux intérêts des autres peuples et aux conséquences larges de ses actions. Ces manifestations internationales permettent de créer des liens utiles entre les différents groupes, et c’est toujours merveilleux de rencontrer des personnes qui trouvent aussi que les choses ne vont pas, qui pensent aussi qu’un autre monde est possible. Il y a toujours des petites différences entre les gens, forcément, chacun a sa vision d’une société meilleure, mais on retrouve beaucoup de points communs avec des personnes qui viennent des quatre coins du monde et on se rend compte que, finalement, les aspirations de liberté, de fraternité, d’égalité sont universelles.
D’ailleurs, outre la contestation pure, les rencontres et l’expérience de vie unique sont une autre motivation. On loge dans un village auto-géré et, pour quelques jours, on vit dans un autre monde, hors de la sphère marchande puisque tout est à prix libre et les gens s’organisent par eux-mêmes. Et c’est toujours fantastique de voir qu’à plusieurs milliers, on peut vivre cette aventure-là, même si elle ne dure malheureusement que quelques jours. Cela montre qu’un autre monde est possible, en tout cas à une certaine échelle.

Quand la répression engendre la violence
Selon les médias, les manifestations de Strasbourg ont été très violentes. On a beaucoup parlé des "black blocs", des affrontements avec la police et de la casse dans la ville. Comment as-tu perçu cette violence ?
On a en effet essentiellement rapporté des actes violents ou dits violents commis par des manifestants ou des supposés manifestants. Tout d’abord, on ne peut jamais parler d’un événement sans parler de son contexte. Peut-on comparer le fait de détruire un bien matériel au fait de frapper, harceler, lacrymogéner et battre quelqu’un ? Personnellement, je ne le pense pas. Je trouve malhonnête de parler de violence quand des gens ne s’attaquent qu’à des biens (on a parlé d’un ancien bâtiment de douane qui devait être rasé 3 jours après et d’un hôtel qui aurait été incendié soit par les lacrymogènes de la police, soit des manifestants selon les versions - les images montrant quand même que quand les manifestants le quittent, il ne brule toujours pas, il n’y a pas de flamme ni de fumée visible). De la même manière, je trouve scandaleux que l’on traite d’ultra-violents des gens qui cassent un panneau publicitaire alors qu’on est littéralement bombardés par la publicité, à la télé, à la radio, dans la rue, dans les transports en commun, partout, ce qui représente une violence quotidienne bien plus forte.
Ensuite, de manière générale, il y a différents modes d’actions. Certains sont totalement non-violents, comme dans le cadre de la campagne Bomspotting et, pour ma part, je considère que l’action non-violente est la plus efficace. Mais la question ne se pose pas dans ces termes-là pour des manifestations comme à Strasbourg.
Pourquoi ?
A partir du moment où il n’y a pas d’accord sur le parcours, qu’on veut faire défiler les gens le long du Rhin, dans une zone industrielle totalement vidée, où il n’y a rien ni personne, seulement un hôtel totalement vide - on avait même dû installer des sanisettes le long du parcours tellement il n’y avait rien - ce n’est pas manifester, c’est se promener ! Manifester c’est donner son opinion, forcer à la faire connaitre, et donc aller là où il y a des gens pour nous entendre. Confisquer toute visibilité à une opinion, c’est encore une fois un déni de démocratie. Et dans ce cadre, il est nécessaire de sortir du parcours si on veut se faire entendre. Or on sait que quand des manifestants veulent sortir du parcours, la police va les en empêcher. Mais alors, quelle alternative reste-t-il pour pouvoir s’exprimer ? Faut-il considérer comme un acte de violence le fait de forcer un barrage de police, y compris en levant les mains et en avançant lentement pour simplement pousser, comme on a fait à Strasbourg ? La police a répondu en nous matraquant, en nous lacrymogénant et en tirant sur nous à coups de flashballs. A ce moment-là, ce que l’on appelle "le black bloc" devient pour moi légitime. Ce n’est pas légitime pour moi d’agresser un policier seul dans la rue un soir ; ce n’est pas légitime pour moi d’aller détruire l’habitation ou la voiture de quelqu’un qui n’a rien fait - ce que les "black blocs" ne font d’ailleurs pas en général, mais ça ne se dit pas dans les médias pour qui ce sont des casseurs.
C’est quoi le black bloc ?
Il y a des casseurs et des vandales qui viennent parfois dans les manifestations pour le plaisir de casser, il y en a partout, y compris dans la police ! J’ai vu de mes propres yeux des policiers casser des fenêtres. Par contre, il y a aussi des manifestants qui se qualifient ou qu’on qualifie de "black blocs". Il ne s’agit pas d’une organisation mais d’une technique. Ce sont des manifestants qui se soutiennent mutuellement, qui s’habillent noir, oui, pour qu’on ne puisse pas les différencier les uns des autres et pour qu’il soit plus difficile de réprimer leurs actions. Ils sont masqués, oui, comme beaucoup de gens quand il y a des lacrymogènes partout et quand on sait qu’on risque de se faire arrêter le lendemain et d’être condamné sans preuve réelle, sur base de témoignages de gens assermentés qui raconteront n’importe quoi. Et oui, ils forcent le passage, accrochent des cordes aux grilles et jettent des cailloux pour passer.
Encore une fois, le contexte est déterminant. Il y a des vidéos où l’on voit des policiers qui jettent des cailloux sur des rangs de manifestants qui défilent tout à fait calmement ! [4] Donc, à un moment donné, la réaction est pour moi légitime, du moment qu’elle ne met pas en danger la vie des gens. Je pense que le mode d’action dépend fortement de l’action. J’ai vu à Strasbourg beaucoup plus de violence de la part de la police que chez les manifestants. Une violence totalement disproportionnée, aveugle car systématique et s’exerçant autant sur les groupes parfaitement pacifiques et pacifistes que sur les groupes de "black blocs". Et contrairement à ce que croit la police, la répression brutale engendre et légitime bien plus que le contraire ces "black blocs" auprès des autres manifestants. Pour l’anecdote, à un moment donné, on a vu 8 ou 9 "black blocs" quitter notre manifestation et se diriger près de la BAC [5]. On s’est dit : " Ils sont malades, ils vont se faire tuer !". C’étaient des policiers déguisés qui rejoignaient leurs collègues, ils étaient venus casser pour jeter le discrédit sur notre action...

"La répression fait peur. Mais elle radicalise aussi"
Dans quel état d’esprit as-tu vécu ces manifestations ?
Pas rassuré ! La police française est l’une des plus brutales. En France, il n’y a aucune échelle de réponse : soit la police se cache soit elle frappe. A Strasbourg, on a bien vu que le but n’était pas de disperser la manifestation puisque la police chargeait et lacrymogénait des manifestants qu’elle bloquait de toutes parts, sans leur laisser d’issue de secours. Il s’agit d’une répression brutale et aveugle qui a pour but de punir et de dégouter le manifestant. Car quelle que soit son attitude, la réaction policière sera la même.
Cette volonté dont tu parles de mater et de décourager les gens à participer à des manifestations, est-ce que ça marche ? Te sens-tu découragé dans ton engagement ?
Que du contraire ! C’est clair que la répression fait peur. Mais elle radicalise aussi. Je lis dans la presse que la contestation est "ultra", j’attends qu’elle soit giga ou terra ! Je lis "ultra-violence". C’est faux ! Pour moi, l’ultra-violence, c’est virer 1000 salariés qui ont des familles à charge dans une entreprise qui fait du profit. L’ultra-violence, c’est sortir avec une mitraillette et tirer dans la rue. L’ultra-violence, c’est bloquer un groupe de gens pacifiques au départ d’une manifestation et les lacrymogéner pendant trois ou quatre heures sans leur laisser d’issue de secours [6]. Je lis aussi dans la presse que nous sommes des "radicaux" voire des "ultra-radicaux" : pour moi, c’est un compliment qu’on nous fait ! Être radical signifie prendre le mal à la racine, et c’est exactement l’inverse de ce que l’on fait en politique actuellement, où l’on s’emploie à mettre des emplâtres sur des jambes de bois, puis des emplâtres sur les emplâtres. Donc la radicalité est nécessaire. Et les gens se radicalisent parce qu’ils commencent à en avoir vraiment marre, et c’est très bien comme ça !
Propos recueillis par Christine Oisel.
[1] notamment Nato Game Over organisé par Vredesactie : http://www.vredesactie.be/campaign.php?id=26
[2] notamment dans le cadre des campagnes Bombspotting : http://www.vredesactie.be/campaign.php?id=19
[4] Voir les vidéos en ligne sur les manifestations de Strasbourg : http://otanvoir.blogspot.com/
[5] ndlr : Brigade Anti-Criminalité
[6] Lire à ce propos Quand la violence (est) tue
Sitôt le mot violence lâché, des images très concrètes nous viennent à l’esprit : celles des conflits armés bien sûr ; mais aussi les émeutekes [1] à Molenbeek, ce double meurtre vraisemblablement commis par un jeune de 19 ans en IPPJ ou le spectre d’un islamisme radical en Europe.
Pourtant, une autre violence existe. Comme le décrit Christine Oisel, la violence tue et est tue. Mais nous n’y pensons pas spontanément : de la violence sociale qui explique les émeutes ; de la violence économique qui pousse des travailleurs à s’attaquer à leur patron ou à se suicider. Nous n’y pensons pas parce que cette violence est banalisée, admise, intégrée. Mais également parce qu’y répondre est jugé illégal (discréditant ainsi ses auteurs) et génère automatiquement une réaction étatique et donc légale.
La violence légale, c’est le thème de ce numéro 1.
Dans le cadre économique et social particulièrement assassin dans lequel nous nous débattons, l’Etat et les intérêts qu’il représente organise, méthodiquement, la répression de toute contestation, de la plus humble, de la plus pacifique, à la plus organisée et engagée.
La plus humble des mobilisations sociales parce que le simple fait de chercher un refuge n’est plus toléré et que les êtres humains qui demandent des papiers se voient dénier le droit d’exister : pas de logement, pas de revenus, pas de travail, pas de sécurité, pas de vie de famille. Violemment poursuivis par la police dans les rues de Bruxelles (lire l’article de Cédric et celui de Gérard Craan), le droit-même de revendiquer leur est désormais refusé sous prétexte d’une fausse régularisation.
La plus pacifique et innocente des contestations qui soient, quand des altermondialistes organisent une sage manifestation dans le but de contrarier le bon déroulement d’un sommet européen des ministres des finances. Ils s’apercevront un peu plus tard que la police les a mis sur écoute sur demande du parquet et qu’ils sont poursuivis par la justice. Didier, victime directe d’un acharnement juridique nous fait part de son parcours kafkaïen du combattant.
Répression de la plus engagée des résistances, aussi, lorsque sont créées des lois "antiterroristes". Au nom de la lutte contre le terrorisme, les libertés fondamentales sont bafouées. Tandis qu’un discours s’acharne à nous démontrer que seul Oussama Ben Laden et ses fils spirituels pourraient tomber sous le coup de la loi et que même eux ont droit à un avocat, quiconque est en réalité passible de poursuites. Les notions volontairement floues de la loi permettent d’enrayer toute contestation sociale remettant en cause les fondements du capitalisme ou tout acte de résistance à un envahisseur [2]. La récente grève chez Tecteo, distributeur de gaz et d’internet dans la région liégeoise aurait par exemple pu mener à des poursuites judiciaires sur base de la loi sur les infractions terroristes. Il n’en a rien été, non pas parce que les poursuites étaient juridiquement impossibles, mais bien parce que la résistance syndicale ne permet pas (encore) d’amalgamer grévistes et terroristes. A travers un dossier de fond [3], Fiona Wallers démonte les mécanismes de ces lois liberticides.
D’où l’importance, aussi, de soutenir les luttes et d’œuvrer à la création d’un rapport de force global qui puisse penche un peu plus en notre faveur. C’est ce que nous faisons modestement par ce journal et par ses journalistes, qui, parallèlement à l’écriture, participent à la construction d’un futur libre, solidaire et émancipateur. Dans la rue, dans leur quartier, au travail. Et c’est également ce que font beaucoup d’autres dont Stéphane, interviewé par Christine Oisel, qui nous narre ses mobilisations anti-Otan et sa détermination.
La dernière touche à cette organisation de la violence légale consiste, bien entendu, à enfermer. Qu’il s’agisse d’actes déstructurés, comme ceux liés à la petite délinquance, ou de résistance politiquement organisée, Fifi Brindacier revient sur la seule voie possible que se sont choisi, et que s’obstinent à choisir, les institutions. La peine de prison demeure un moyen inefficace, mais on lui attribue de plus en plus de fonctions : contention, protection de la société, réinsertion, normalisation, réparation, réhabilitation, réadaptation. Faut-il dès lors redéfinir la prison ou songer à son abolition, écrit-elle ?
Si nos luttes pour la construction d’un avenir non-capitaliste, émancipé et solidaire ne sont pas toujours légales, elle n’en sont pas moins compréhensibles, excusables, justifiables. Et en fait, légitimes. Se battre contre un licenciement, pour un meilleur salaire ou simplement un job, lutter pour pouvoir vivre en Belgique, ou pour sortir définitivement du capitalisme et l’abattre, c’est non seulement légitime, mais également nécessaire.
Gérard, pour l’équipe de JIM
-
Dès le 18 octobre, commencera la parution du numéro 2. Son thème ? Ecologie et capitalisme. L’écologie est elle compatible avec le capitalisme ? Le green washing, la croissance verte, les quotas carbone, la voiture verte sont-ils réellement des outils qui permettront à la Flandre de ne pas être inondée ?
Le thème est ardu, nous avons donc décidé de commencer par du concret : un article sur la voiture verte suivi d’un autre consacré à la société de fret B-Cargo. Un peu de théorie ensuite avec le concept de développement durable. Beaucoup de théorie après avec un article de fond sur l’écologie et le capitalisme. Les autre sujets seront à découvrir au fil des jours.
Remercions encore pour leur collaboration au numéro 1 : Cédric, Céline, Chris, Christine, Didier, Fifi, Fiona, Gerard, et Ode.
[1] Pour reprendre les propos d’une criminologue à l’émission radio Face à l’Info le 21/09/2009
[2] Sans partager les objectifs des islamistes, Irak et Afghanistan sont, quoi qu’on en dise, des pays envahis militairement par les puissances occidentales. Et dont la résistance des peuples passe par bien d’autres vecteurs que le fondamentalisme religieux
[3] Lire aussi un article explicatif et les interviews de Laurent Bonelli et de Jean-Claude Paye.
